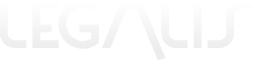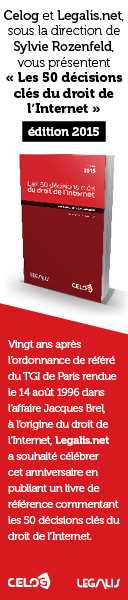Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Paris, Arrêt du 26 janvier 2000
France Télécom / SA Transtélé Canal France International (ci-après " CFI ")
Faits et procédure
La société Transtélé Canal France International (ci-après désignée » CFI « ) a été créée pour fournir par satellite des programmes français aux télévisions francophones.
Pour accomplir cette mission, elle a, notamment, passé deux contrats : l’un lui permettant d’utiliser les satellites Arabsat de deuxième génération ; l’autre, conclu avec la société France Télécom (exploitant public depuis le 1er janvier 1991), devenu société anonyme depuis le 31 décembre 1996), ayant pour objet la transmission des programmes à destination de ces satellites.
Ainsi, normalement, en exécution de ces contrats, le programme CFI qui quitte la régie finale de son studio par fibre optique analogique, est reçu par le centre France Télécom » Poncelet » qui le transmet au centre France Télécom » Bercenay » au moyen d’une fibre optique numérique spécialisée.
Ce dernier centre procède alors à l’émission hertzienne du signal en direction du satellite Arabsat 2A.
Le 19 juillet 1997, une manœuvre d’un technicien du centre » Poncelet » a eu pour effet de substituer à l’émission prévue » Va savoir » la diffusion pendant environ 20 à 40 minutes d’un film pornographique.
Tirant argument de cet incident, par exploit du 15 octobre 1997, CFI a saisi le tribunal de commerce de Paris pour solliciter la condamnation de France Télécom au paiement de la somme de 123 millions de francs, à titre de dommages-intérêts.
Le 30 janvier 1998, cette juridiction a rendu sa décision dont le dispositif est rédigé comme suit :
» Qualifie de faute lourde la substitution de programme opérée par l’agent de France Télécom et dit applicables les dispositions de l’article 9.5 du contrat conclu entre France Télécom et CFI.
Dit établi le lien de causalité entre la faute lourde et le dommage subi par CFI.
Donne acte à la société CFI de ce qu’elle entend expressément réserver tous ses droits quant à la garantie que France Télécom serait tenue de lui fournir en cas d’action de la société Arabsat.
Condamne France Télécom à payer à CFI la somme de vingt-quatre millions cent quatre-vingt-six mille francs à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ordonne l’exécution provisoire, avec constitution de garantie bancaire.
Condamne France Télécom à payer à CFI la somme de cent mille francs HT au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens » ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par France Télécom ;
Vu les conclusions de cette société en date du 30 novembre 1999 par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
à titre principal,
– dire que CFI a renoncé à la réparation de son préjudice ;
– par voie de conséquence, débouter de plus fort CFI de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
– constater que l’obligation de France Télécom, rémunérée par CFI, était de moyens ;
– dire et juger que seul un manquement à cette obligation de moyens pourrait être reproché à France Télécom, à supposer qu’il constitue une faute lourde ;
– constater l’absence de faute lourde ;
– par voie de conséquence, débouter CFI de toutes ses demandes ;
à titre plus subsidiaire,
– dire que la preuve d’un lien causal direct entre la prétendue faute lourde de France Télécom et le préjudice allégué n’est pas rapportée ;
– dire que CFI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un préjudice réparable ;
à titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger que la preuve du préjudice n’est pas rapportée ;
– constater, en tout état de cause, que le préjudice allégué a déjà été réparé par l’Etat et qu’il n’existe aucun préjudice réparable ;
Sur l’appel incident,
– écarter comme nouvelles les demandes formulées par CFI visant à obtenir la réparation d’un préjudice non invoqué en première instance ;
– la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en toutes hypothèses,
– condamner CFI à lui rembourser la somme de 24 186 000 F avec intérêts légaux à compter de la date de son versement ;
Vu les conclusions du 16 novembre 1999 de CFI par lesquelles cette société demande à la cour de :
– constater que France Télécom n’a répondu à aucune des sommations de communiquer ; en tirer toutes les conséquences ;
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris entrepris en ce qu’il a :
* qualifié de faute lourde la substitution de programme opérée par France Télécom,
* donné acte à CFI de ce qu’elle entend expressément réserver tous ses droits quant à la garantie que France Télécom serait tenue de lui fournir en cas d’action de la société Arabsat,
* condamné France Télécom à payer à CFI les sommes suivantes en réparation de l’ensemble des préjudices subis :
. au titre des dommages-intérêts, la somme de 24 186 000 F,
. au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 100 000 F ;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de CFI, statuant à nouveau ;
– dire que l’article 9.5 du contrat entre CFI et France Télécom est inopposable à CFI ;
– condamner, en conséquence, France Télécom à verser à CFI la somme de 73 801 502 F en réparation de l’intégralité de l’ensemble des préjudices subis par CFI ;
– ordonner la publication de la décision à intervenir par voie de presse écrite dans dix quotidiens nationaux français et arabes (Arabie Saoudite, Koweit, Emirats Arabes Unis, Liban) ainsi que par voie de presse audiovisuelle (chaînes de télévision diffusant dans la zone de couverture de satellite Arabsat), à son choix et aux frais de la société France Télécom ;
– condamner France Télécom à payer à CFI la somme de 399 148 F HT au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur ce :
Sur la recevabilité de certaines demandes relatives aux droits de diffusion
Considérant que France Télécom se fondant sur les dispositions de l’article 564 du nouveau code de procédure civile, soulève l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation formées en raison de la perte de droits de diffusion pour les contrats qui n’ont pas été allégués devant les premiers juges ;
Mais considérant que la demande de CFI en appel n’est pas différente de celle soumise aux premiers juges en ce qu’elle tend, comme en première instance, à obtenir l’indemnisation de l’entier préjudice subi suite à l’incident du 19 juillet 1997, ce qui englobait virtuellement l’indemnisation de tous les droits de diffusion devenus, en raison dudit incident, sans exploitation possible, selon CFI ; que, dès lors, les demandes relatives aux contrats de diffusion produits pour la première fois en cause d’appel sont recevables ;
Sur la renonciation
Considérant que, pour invoquer la renonciation de CFI à la réparation du préjudice par celle-ci allégué, France Télécom soutient que le contrat qui porte la date du 15 décembre 1996 a été, en réalité, signé postérieurement au 19 juillet 1997, puis antidaté pour entrer en vigueur rétroactivement le 1er octobre 1996 ;
Qu’elle estime qu’en acceptant de conférer un effet rétroactif au contrat, CFI a ainsi englobé rétroactivement l’incident et accepté de limiter ses prétentions indemnitaires à ce qui est expressément stipulé à l’article 9.5 du contrat ;
Considérant que CFI s’oppose à ces affirmations ;
Considérant que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que, pour être retenue, elle doit être exempte d’équivoque ;
Considérant qu’il est certain qu’un contrat portant la date du 15 décembre 1996 a été conclu entre les parties et que, de la commune volonté expressément exprimée dans celui-ci, il a vocation à régir leurs rapports à compter du 1er octobre 1996 ;
Que de cette constatation, il se déduit que les stipulations de cette convention sont nécessairement applicables à la solution à donner à l’incident du 19 juillet 1997, soit parce que celui-ci est survenu postérieurement à la signature de la convention et entre naturellement dans son champ et sa durée d’application ; soit, en admettant que le contrat ait été en réalité conclu postérieurement à l’incident, pour n’avoir pas été exclu du champ de son application rétroactive expressément décidée ;
Considérant que l’article 9.5 du contrat du 15 décembre 1996 est rédigé comme suit :
» La responsabilité de France Télécom dans l’exécution du Service ne pourra être engagée qu’en cas de faute lourde établie à son encontre.
En toute hypothèse, le droit à réparation de CFI sera limité au préjudice direct, à l’exclusion des dommages ne résultant pas directement ou indirectement de l’inexécution totale ou partielle du service, tels que les préjudices commerciaux, les atteintes à l’image de marque, les pertes d’exploitation » ;
Considérant, dans ces conditions, que la clause susmentionnée, claire et dépourvue d’ambiguïté, doit recevoir application notamment en ce qu’elle exclut que la responsabilité de France Télécom puisse être recherchée en dehors de l’existence d’une faute lourde ;
Sur la limitation de la réparation
Considérant, selon l’article 1150 du code civil, que le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ;
Considérant que la faute lourde s’assimilant au sol, il s’en déduit que la limitation de la réparation instituée par le second alinéa de l’article 9.5 ci-dessus mentionné doit être réputée non écrite ;
Sur l’existence d’une faute lourde
Considérant que, deux jours après l’incident, France Télécom a écrit à CFI une lettre contenant le passage suivant :
» A la suite d’une erreur de manipulation de France Télécom, la diffusion du programme de CFI Moyen-Orient a connu un très grave incident samedi 19 juillet 1997. En effet, en début d’après-midi, le programme de CFI sur le répéteur 12 du satellite Arabsat 2A à destination des pays du Moyen-Orient a été interverti avec un programme en clair d’une autre chaîne destiné à être cryptée.
Le contrôle effectué par les équipes de France Télécom portant principalement sur la qualité technique du signal et non sur son contenu, cette anomalie n’a pas été décelée. L’émission du programme de CFI a été interrompue à 13 h 42 GMT, suite à l’intervention d’Arabsat auprès du CTS. A ce jour, les transmissions n’ont pas été rétablies.
Devant la gravité des conséquences, j’ai immédiatement diligenté deux enquêtes :
– d’une part, des investigations techniques destinées à identifier la chronologie et les cause de l’incident. Dès mardi 22 juillet, je vous transmettrai le rapport d’expertise qui me sera remis ;
– d’autre part, un audit interne à France Télécom, afin de déterminer les responsabilités et de définir les mesures nécessaires pour éviter qu’un tel dysfonctionnement ne se reproduise. Les conclusions de cet audit seront remises à la fin de la semaine et vous seront également communiquées.
France Télécom assume l’entière responsabilité de cette inversion de programmes et, en son nom, je vous présente toutes nos excuses.
Bien entendu, nous étudions les solutions de remplacement qui devraient permettre à CFI et aux radios associées de reprendre la diffusion dans des conditions satisfaisantes. » ;
Considérant que le » service » dû par France Télécom à CFI en exécution de leur convention consiste » en la transmission permanente sur une capacité satellite des programmes télévisuels fournis par CFI » (articles 1 et 2) ; que, selon l’annexe 1 dudit contrat, il comprend la transmission du signal jusqu’au satellite et la supervision du servce de transmission 24 heures sur 24 ;
Considérant que l’incident du 19 juillet 1997 démontre que la supervision du service qui aurait dû avoir pour premier objectif de vérifier la conformité du programme transmis avant même de s’assurer de la qualité de la transmission, était, en réalité, totalement absente en ce qui concerne la première de ces deux missions, ce que révèlent l’aveu sur ce point contenu dans la lettre susmentionnée et l’absence de preuve de l’existence d’un tel contrôle ;
Qu’il n’est point besoin de souligner à ce sujet que l’incident n’a pas pris fin en raison d’un contrôle tardif qui aurait pu avoir été effectué par un préposé de France Télécom mais seulement en raison de la plainte émanant d’Arabsat ;
Considérant que la faute, en l’espèce, n’est pas seulement constituée par la transmission, en raison du comportement, involontaire ou non, d’un préposé de France Télécom, d’un programme autre que celui de CFI mais surtout par l’absence de toute procédure de contrôle en vue de pallier de tels incidents dont la survenance était normalement prévisible ;
Que force est de constater que France Télécom, en ne prévoyant aucun contrôle entre le programme effectivement transmis et celui dont la transmission était commandé par le client, n’a pas satisfait à son obligation de moyens prévue par la convention et a fait preuve d’une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l’accomplissement de la mission qu’elle avait acceptée ;
Que cette faute est d’autant plus grave que France Télécom ne pouvait ignorer que les programmes à elle adressés par CFI, puis transmis par elle au satellite Arabsat étaient destinés aux Proche et Moyen-Orient ; que la substitution réalisée est d’autant plus révélatrice d’une carence grave dans la mesure où elle est intervenue avec un programme pornographique dont l’émission, en tous pays, est soumis à des restrictions telles que le cryptage ou des horaires nocturnes ;
Considérant, dans ces conditions, que CFI réclame à bon droit, dans son principe, la réparation du préjudice que lui a causé la faute lourde de France Télécom ;
Que cette dernière n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir sollicité un système dit » secouru « , option prévoyant un double réseau de transmission, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’un tel système lui ait été proposé ; d’autre part, que si un système » secouru » présente des avantages en cas d’incidents techniques, il n’est pas démontré qu’il accroisse les garanties en cas de substitution de programme ; enfin, que le système proposé par France Télécom et retenu par CFI devait être adapté à la mission que la première avait acceptée ;
Sur le lien de causalité
Considérant qu’il est établi que la rupture du contrat entre CFI et Arabsat est intervenue le lendemain de l’incident ; qu’il est manifeste qu’il a eu un rôle déterminant pour convaincre Arabsat de rompre les relations qvec CFI ainsi qu’il résulte de la télécopie du 20 juillet 1997 rédigée comme suit, adressée à M. Baudillon, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, assurant la présidence de la société CFI :
» Cher Monsieur Baudillon,
Arabsat a le regret de vos infirmer qu’Arabsat a décidé d’interrompre l’émission de votre signal TV à compter du samedi 19 juillet 1997 après que vous ayez, de manière grave et répétée, violé le contrat en transmettant des émissions TV qui sont considérées par Arabsat comme des émissions qui contredisent les objectifs généraux de la Charte Arabsat. L’émission en question est d’une nature sexuelle explicite qui n’est pas autorisée sur une quelconque chaîne publique en clair, par câble ou par satellite, dans la zone de couverture Arabsat. Cela s’est produit en dépit des avertissements répétés que nous vous avons adressés ces dernières années (remontant jusqu’à novembre 1993) et des accords subséquents que nous avions conclus avec vous (la dernière visite de notre délégation à votre bureau date de mai 1997).
Arabsat vous a donné plusieurs chances de corriger vos procédures afin que CFI se conforme à son contrat de location de transporteur avec Arabsat et au Code éthique accepté pour la diffusion TV et qui vous a été expliqué par Arabsat et pour l’application duquel vous avez donné de fréquentes assurances que les précédentes violations ne seraient pas renouvelées.
En considération de l’émission transmise hier soir, Arabsat n’a d’autre alternative que de résilier le contrat de location de transpondeur pour » violation de l’un des objectifs principaux de la Charte Arabsat « , en l’espèce le respect des valeurs morales et culturelles des spectateurs de la zone de couverture Arabsat. Nous annulons et résilions en conséquence notre contrat de location de transpondeur à compter du samedi 19 juillet 1997. Arabsat se réserve le droit d’engager toute action en justice du fait de toute atteinte à sa réputation qui pourrait influencer négativement nos activités et du fait de toute perte ou dommage que nous pourrions subir, consécutivement à la violation, de votre fait, et à la résiliation, de notre fait, de votre contrat de location de transpondeur et des accords subséquents. » ;
Considérant que l’on doit donc retenir que l’incident du 19 juillet 1997 a cristallisé les griefs qu’Arabsat nourrissait à l’encontre de CFI accusée d’une programmation » osée « , ce qui n’était pas ignoré de CFI, cette faiblesse étant relevée en page 20 d’un rapport rédigé bien avant l’incident par MM. Coutant et Belchi (CFI études 11/96) sur l’estimation du potentiel de ressources publicitaires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la rupture des relations entre Arabsat et CFI a deux causes : d’une part, la programmation osée de CFI antérieurement diffusée au 19 juillet 1997, entièrement imputable à cette dernière ; d’autre part, l’incident survenu à cette date et seul imputable à France Télécom ;
Que, d’ailleurs, si l’incident du 19 juillet 1997 n’avait pas été précédé d’autres difficultés avec Arabsat imputables à CFI, cette dernière n’aurait pas aussi facilement accepté la résiliation de son contrat, dès lors qu’elle aurait pu faire valoir, devant l’arbitre conventionnellement prévu, sa totale bonne foi et mettre en valeur le fait qu’il n’était que le résultat de la faute de France Télécom qu’elle ne pouvait empêcher ;
Considérant, dans ces conditions, que si la faute de France Télécom n’est pas sans lien de causalité avec la rupture des relations CFI-Arabsat, celle-ci est due aussi, pour moitié, à la faute de CFI ;
Sur le préjudice
Considérant que, pour contester le droit à indemnisation de CFI, France Télécom prétend que le préjudice de cette dernière, société à capitaux publics, a été indemnisé par l’Etat ; que cette seule affiramtion, assortie d’aucun élément de preuve, ne saurait priver la société appelante du droit reconnu à toute personne physique ou morale d’être indemnisée par l’auteur du préjudice subi ;
Considérant que le jugement entrepris a condamné France Télécom à payer à CFI la somme de 24 186 000 F, soit 19 236 000 F au titre des programmes fabriqués en vain et 4 950 000 F correspondant à la perte de la caution versée à Arabsat ;
Que, dans ses conclusions, l’appelante présente la réclamation suivante :
– droits de diffusion F 6 519 399
– doublage, sous-titrage et frais techniques F 1 402 596
– contrats de partenariat et commandes de droits F 3 867 550
– caution Arabsat F 533 772
– chaîne arabe F 2 075 521
– études d’audience sur la zone PMO F 379 748
– licenciements F 296 829
– frais de personnel F 2 248 219
– frais de régie F 2 558 716
– frais de structure F 1 940 448
– perte budget publicitaire F 2 518 704
– perte de parts de marché panarabe F 48 846 000
– préjudices organisationnel et moral F 20 000 000
soit au total la somme de 97 987 475 F ;
Considérant que cette évaluation est, au regard des éléments versés aux débats, très excessive ; qu’il convient, en effet, de souligner d’abord que des postes de réclamations font double emploi : telles les demandes pour » préjudice organisationnel « , aussi élevées que floues, qui recoupent, au moins en partie, les réclamations pour » frais de personnel « , » frais de régie « , » frais de structure » ;
Que la réclamation dot être aussi appréciée au regard de l’activité de CFI telle qu’elle résulte de son bilan, son chiffre d’affaires étant en 1991 de 105 203 323 F et ayant atteint 166 267 121 F en 1995 ;
Considérant, ensuite, que la plupart des postes sont surévalués ; qu’ainsi, l’importance de la demande au titre des droits de diffusion est le résultat d’une imputation arbitraire par zones de droits de diffusion acquis ;
Qu’en effet, CFI procède à une imputation des droits acquis à égalité pour chaque zone couverte (par exemple, Afrique, Proche et Moyen-Orient, Extrême-Orient, soit par exemple 1/3 pour chaque zone) alors qu’il est plus conforme à la réalité de retenir que sur une population de 619 millions de téléspectateurs dans les zones couvertes par CFI, la zone Moyen-Orient concernant 80,5 millions de téléspectateurs, ce qui permet d’admettre qu’en règle générale les droits acquis l’ont été à raison de 13 % pour la zone en cause ;
Qu’il convient de noter, en ce qui concerne l’amortissement des droits de diffusion que jusqu’en 1995 CFI considérait elle-même, ainsi qu’il ressort de la lecture de son bilan, que les droits de diffusion étaient amortis dès la première diffusion ; que, depuis cette époque, elle estime que la première diffusion correspond à un amortissement de 60 % des droits ; que ce changement d’appréciation, même s’il n’est pas blâmable en lui-même, est révélateur de la fragilité et de l’arbitraire d’une telle appréciation ;
Considérant, de plus, qu’il n’est pas démontré que la rupture du contrat avec Arabsat devait entraîner nécessairement la perte certaine et totale des droits de diffusion dans la zone Proche et Moyen-Orient ; qu’en effet, tous les contrats soumis à la cour ne sont pas identiques, certains, peu nombreux, prévoient expressément la diffusion par l’intermédiaire d’Arabsat ; que, néanmoins, cette stipulation ne faisait pas obstacle à la recherche d’une négociation en vue d’une diffusion par un autre satellite ou un autre moyen tel la diffusion directe ; qu’en outre, pour les contrats ne contenant pas une telle limitation, la cession étant même parfois clairement autorisée (par exemple, contrat du 7 octobre 1996 avec la société IO Production) ou pouvant à tout le moins être recherchée avec l’accord du cédant (contrats avec TF1 International) une utilisation de certains des droits de diffusion restait possible ;
Considérant, certes, que la rupture des relations avec Arabsat a créé une difficulté de gestion pour CFI et généré momentanément un surcoût de gestion, les équipements et le personnel n’étant plus employés comme il avait été prévu, préjudice ouvrant droit à indemnisation ;
Considérant, en revanche, que l’existence d’un lien entre l’incident et les indemnisations sollicitées n’est pas démontré en ce qui concerne :
– le projet de chaîne franco-arabe, projet indépendant du contrat Arabsat dont l’abandon dépend d’une décision de politique de CFI mais aussi de son seul réel actionnaire, l’Etat ;
– le coût des études d’audience,
– le coût des licenciements, les lettres de licenciements démontrant que ceux-ci font suite » à d’importantes divergences de vues » avec la Direction ;
– la perte du marché panarabe, celle-ci ne résultant que de conjectures ;
Considérant, dans ces conditions, que le préjudice lié à la rupture des relations avec Arabsat doit être évalué comme suit :
– droits de diffusion 2 400 000 F
– sous-titrage, frais généraux, frais techniques, … 1 000 000 F
– contrats, perte de budgets 1 000 000 F
– préjudice d’organisation 700 000 F
– caution Arabsat 5 333 772 F,
soit au total 10 433 772 F, dont seulement 5 216 886 F en rapport avec la faute de France Télécom ;
Considérant qu’en outre, la diffusion d’un film pornographique a causé un préjudice moral certain à CFI même si celle-ci passait déjà, antérieurement à l’incident du 19 juillet 1997, aux yeux de téléspectateurs arabes pour diffuser des productions osées ; qu’il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 000 F ;
Considérant qu’il convient d’allouer, en outre, à CFI la somme de 50 000 F TTC pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens sans qu’il y ait lieu d’ordonner les mesures de publication sollicitées, le préjudice de CFI se trouvant intégralement indemnisé par les allocations ci-dessus ordonnées ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la somme de 24 186 000 F a été versée à CFI au titre de l’exécution provisoire dont est assortie la décision des premiers juges ; que les sommes trop perçues devront donc être restituées à France Télécom avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
La décision
La cour, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :
. réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamné la société France Télécom à payer à la société Transtélé Canal France International la somme de 24 486 000 F ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
. condamne la société France Télécom à payer à la société Transtélé Canal France International :
– la somme de 5 716 886 F TTC à titre de dommages-intérêts,
– la somme de 50 000 F TTC en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. condamne la société Transtélé Canal France International à restituer à la société France Télécom la somme de 24 186 000 F perçue en exécution de la décision des premiers juges sous déduction des sommes allouées par la présente décision, la somme restant due portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
. confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
. rejette toutes les autres demandes ;
. condamne la société France Télécom aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal : Mme Claire Favre (président), Mme Geneviève Bregbon et M. Dominique Garban (conseillers).
Ministère public : Mme Brigitte Gizardin (subsitut du procureur général).
Avocats : Mes Emmanuel Rosenfeld et François Stefanaggi.
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Emmanuel Rosenfeld est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître François Stefanaggi est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Claire Favre est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Dominique Garban est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Geneviève Bregbon est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.