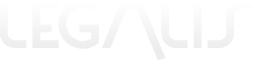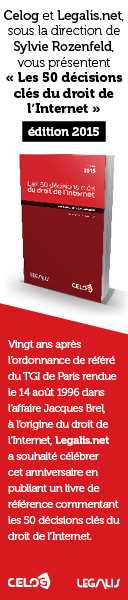Actualités
Commentaire de l’arrêt du 10 février 1999 de la Cour d’appel de Paris, par maître Maître Joël HESLAUT
La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée, par un arrêt attendu du 10 février 1999, dans l’affaire opposant Estelle H. au responsable d’un site « alternatif » qui avait laissé diffuser, par un des sites personnels qu’il héberge, des photographies privées du mannequin dénudé. Cet arrêt a immédiatement donné lieu à de nombreux commentaires à chaud dans la presse nationale qui ont pu jeter une certain trouble parmi les professionnels de l’Internet. Ces commentaires se faisaient en effet l’écho, qui d’un contrôle approfondi du juge sur l’Internet, qui de la fin de la liberté sur le réseau des réseaux, qui enfin de l’obligation nouvelle pour les professionnels de surveiller activement les données qu’ils transportent ou stockent. La Cour aurait ainsi remis en cause les fondements de la décision prise naguère dans l’affaire UEJF.
Or, loin de remettre en cause la jurisprudence dominante qui se dégage aujourd’hui sur l’Internet, cette décision va dans le sens de la construction prévisible des règles de droit applicables en ce domaine qui sont indubitablement dans la continuation des principes qui gouvernent notre droit positif.
Après avoir rappelé que toute personne peut demander au Juge des Référés de prendre les mesures aptes à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte à un droit fondamental (en l’occurrence son droit à l’image) la Cour se prononce ensuite sur l’engagement de responsabilité du prestataire en raison du contenu des sites qu’il héberge.
Pour fonder sa décision, la Cour retient des critères précis : « en hébergeant de façon anonyme sur le site ALTERN.ORG qu’il a créé et qu’il gère, toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondances privées, Valentin L. excède manifestement le rôle technique d’un simple transmetteur d’informations et doit, d’évidence, assumer à l’égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d’une activité qu’il a, de propos délibérés, entrepris d’exercer dans les conditions susvisées et qui, contrairement à ce qu’il prétend, est rémunératrice et revêt une ampleur que lui-même revendique »
Comme on le voit, la Cour insiste sur les circonstances particulières de fait qui entourent cette affaire et, notamment, le caractère délibérément anonyme voulu par l’hébergeur. Celui-ci est ici sanctionné car il n’a pas agi comme un simple transmetteur d’informations, mais comme une entreprise qui a, de propos délibéré, choisi d’offrir, anonymement, un hébergement d’informations ou de données accessibles au public sans les soumettre à aucun contrôle tout en tirant bénéfice commercial, direct ou indirect, de cet hébergement.
Peu importe dès lors que l’anonymat revendiqué soit réel ou non, qu’il ait une justification politico-philosophique ou pas, il est source d’un trouble anormal pour des tiers et fonde l’engagement de responsabilité retenu par la Cour.
Cette décision n’apporte pas de bouleversement profond, c’est la simple application de la théorie du risque née dès la fin du XIXème siècle et développée sous l’influence de Josserand. L’hébergeur, entreprise commerciale, exerce, pour en tirer un profit, une activité qui fait naître un risque pour autrui, il est donc responsable des préjudices qu’il peut causer aux tiers. Le juge d’appel a ainsi apprécié in concreto le risque pris par cet hébergeur et l’a condamné à en assumer les conséquences.
Cet arrêt ne doit pas être considéré comme posant un principe général de responsabilité de l’hébergeur à raison des sites qu’il héberge. Mais il ne doit pas non plus être réduit à un simple arrêt d’espèce. Il est utopique de croire que l’hébergeur peut contrôler en permanence ce qui se trouve sur son site. L’étendue du champ des infractions qui peuvent être commises et la multitude des causes d’engagement de responsabilité qui peuvent être rencontrées rendent ce contrôle techniquement, économiquement et juridiquement impossible. C’est aussi le sens de la proposition de Directive Européenne du 18 novembre 1998 relative au commerce électronique laquelle mentionne, dans son article 15, que les Etats Membre ne peuvent imposer aux prestataires » une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou qu’ils stockent, ou une obligation de rechercher activement des faits ou circonstances indiquant des activités illicites. »
Dès lors, et faute de dispositions législatives particulières, l’hébergeur doit se comporter en « bon père de famille » et donc prendre toutes précautions propres à limiter le risque inhérent à son activité. Il devra en particulier, aux termes du contrat qu’il passera avec les personnes physiques ou morales hébergées, d’une part, s’assurer d’être civilement garanti pour toute condamnation qui serait la conséquence de leur fait et, d’autre part, se réserver la possibilité d’interrompre son service sans préavis dans tous les cas où il serait porté à sa connaissance des faits de nature à engager sa responsabilité. L’hébergeur devra également, à notre avis, veiller à ce que les tiers qui s’estimeraient victimes des agissements d’un site hébergé puissent l’en informer rapidement. Enfin, comme dans toute activité industrielle ou commerciale qui présente un risque, il serait économiquement fondé de rechercher dans la voie de l’assurance les moyens de protéger l’entreprise d’hébergement.
Si cette décision n’apporte pas de bouleversement, elle constitue, en revanche, une pierre importante de l’édification d’un droit prétorien de l’Internet. Après les décisions Queneau et Brel, assurant la protection des auteurs, après les décisions ESIG et F., au sujet des infractions commises par voie de presse, cette décision, fondée sur la protection du droit à l’image et de la vie privée, vient montrer une fois de plus que l’Internet n’est pas un espace de « non-droit » mais qu’il doit être appréhendé comme un moyen, moderne s’il en est, d’exercice des activités humaines soumis en cela à la règle commune.
Maître Joël HESLAUT, Avocat , Cabinet Salans, Hertzfeld & Heilbronn / FG Associés