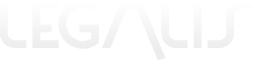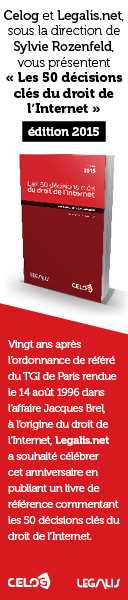Actualités
Commentaire du jugement du Tribunal de grande instance de Valence du 2 juillet 1999
Les croyances populaires ont la vie dure, y compris dans le domaine juridique, et l' »à-peu-près » peut devenir, par la magie du langage médiatique, une vérité pour des milliers de citoyens en l’espace d’une émission de télévision.
C’est ainsi que les spectateurs de l’émission Capital, diffusée sur la chaîne M6 en février dernier et consacrée à l’industrie de la copie, ont pu admirer le génie d’un jeune chef d’entreprise ayant fait commerce de reproduire CD audio, cédérom et cassettes pour le compte de son prochain.
Et l’ingénieux, transporté par le succès de son exploitation « tout ce qu’il y a de plus légale » à l’entendre, se drapait dans le code de la propriété intellectuelle, sous couvert d’une part, du droit à copie privée et d’autre part, du droit à copie de sauvegarde pour les logiciels. Repoussant les (perfides) questions du journaliste à ce sujet, il brandissait les articles L. 122-5 et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, qu’il avait fait imprimer sur des sacs à pain lui servant de support publicitaire, comme d’autres gravent des lois sur des tables de pierre.
Magie médiatique toujours, tout juste neuf jours plus tard après, la justice se penchait sur l’affaire à l’initiative de plusieurs sociétés d’auteurs ou de producteurs (APP, SPPF, SCPP, SDRM et SNEP), d’un groupement d’éditeurs de logiciels (SELL), et de la société Sony. Prévenu de faits de contrefaçon sur le fondement des articles L. 335-2 et suivants du CPI, l’impudent copieur se vit lourdement condamner par le Tribunal correctionnel de Valence le 2 juillet 1999 : un an de prison avec sursis, 500 000 F d’amende, et 250 001 F de dommages et intérêts alloués au différentes parties civiles.
Avant de s’attarder sur quelques uns des points abordés par le tribunal, on rappellera que le droit de copie à usage privé (article L 122-5 du CPI) vise comme son nom l’indique « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Cette exception, souvent ressentie par les copieurs comme une brèche dans le système, a pourtant toujours été strictement appréciée par les tribunaux. Le terme « privé » doit être entendu comme « familial », ou « personnel ».
Il convient également de rappeler que le droit à copie privée ne vaut pas pour les logiciels (contrairement à ce que suggère la présentation des textes faite par le Tribunal correctionnel). L’article L 122-6 l’exclut en effet expressément, réservant uniquement la possibilité d’effectuer une copie de sauvegarde. Quant à la copie de sauvegarde, celle-ci doit être entendue, comme le souligne le Tribunal, comme une reproduction « nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel ». Il ne saurait donc être question que cette copie soit utilisée ou même détenue par une autre personne que l’utilisateur légitime du logiciel original, ni qu’elle soit faite en plusieurs exemplaires.
En l’espèce, le tribunal correctionnel a écarté l’exception de copie privée tout comme celle de copie de sauvegarde, comme on pouvait légitimement s’y attendre. Toutefois, l’examen des motivations adop-tées montre un léger flou, sinon un recul, par rapport à la sévérité observée dans le domaine voisin de la photocopie.
Vers une appréciation plus stricte de la notion de copie de sauvegarde ?
Jusqu’alors, le droit à copie de sauvegarde était automatiquement reconnu au détenteur légitime du logiciel original, sans que l’on ait à se poser de question sur la qualité du support de ce logiciel. Tout au plus quelques éditeurs avaient-ils pris le parti de couper l’herbe sous le pied des copieurs en fournissant eux-mêmes à leurs clients une copie de sauvegarde « originale » ( ! ), allant parfois même jusqu’à facturer cet exemplaire au prix coûtant du support. Depuis l’apparition du CD ROM, une partie des éditeurs a décidé d’interdire purement et simplement la copie de sauvegarde, ce support numérique n’étant pas susceptible de dégradation sans intervention extérieure.
Dans notre affaire, le tribunal entérine ce raisonnement, soulignant dans son exposé préliminaire des faits que la copie de sauvegarde n’est pas « effectivement nécessaire » pour le CD ROM, « qui n’est exposé, comme tout autre bien, qu’aux dommages accidentels ou par manque de soins et non aux risques de dégradation logicielle ». Cependant, il n’en tire aucune conclusion dans le raisonnement qui suit cet exposé des faits : il aurait pu en effet indiquer que la copie de sauvegarde de cédéroms n’étant pas nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel, l’exploitant ne pouvait invoquer sur cette exception.
Au lieu de cela, le tribunal reproche plus loin à l’exploitant d’avoir « accepté la copie multiple d’un cédérom », ce qui suppose a contrario que la copie d’un seul lui aurait semblé légitime… Il semble donc, pour l’instant, que cette évolution restrictive de la notion de copie de sauvegarde ne soit pas formellement consacrée.
Une définition économique du « copiste »
Dans la petite entreprise du prévenu, le client pouvait soit effectuer lui-même la copie, en utilisant le matériel mis à sa disposition, soit confier les supports afin qu’ils soient copiés pour son compte.
En théorie, selon les articles L. 121-4 et suivants du nouveau code pénal, le chef d’entreprise se trouvait donc soit complice par fourniture de moyens (si le client travaille lui-même), soit co-auteur (lorsqu’il réalise matériellement la reproduction pour son client). Cette distinc-tion se heurte, dans le premier cas, à l’éventualité que la demande du client soit effectivement légitime (copie privée ou de sauvegarde), et donc à un risque de contestations sans fin (pas de complice sans auteur principal).
C’est sans doute pourquoi le tribunal a préféré simplifier le schéma et mettre en cause le seul exploitant, en indiquant : « Que le client réalise lui-même sa copie, ou que la tâche soit matériellement exécutée par l’exploitant ne change que les modalités d’accomplissement de l’acte et non son économie ». « L’économie » est décrite comme une organisation permettant la mise à disposition de matériel de reproduction, aisément accessible à des personnes n’ayant pas payé de droits d’auteur ou de licence d’utilisation. La gravité est renforcée par le fait que cette organisation permet plus d’une reproduction à la fois (Il est admis que la copie privée, et la copie de sauvegarde surtout, doivent par nature rester uniques), et par le fait d’avoir détruit les systèmes de protection de certains jeux. Ainsi, ce n’est pas tant le fait même de reproduction qui est ici l’élément matériel du délit, mais bien la mise à disposition de matériel permettant la reproduction massive potentiellement contefaisante.
Le même raisonnement économique avait déjà été adopté dans le domaine voisin de la photocopie de livres, (C. Cass., 1ère civ. 7/03/1984 Bull. civ. I n° 90 ; CA Paris, 4ème ch A 25/06/1997 BRDA 97/17 p. 6), où le « copiste », au sens du CPI, était non pas le client, mais bien la société de reprographie elle-même, agissant dans le cadre de son activité commerciale. L’exploitant étant « le copiste » au sens de la loi, la copie ne pouvait pas être privée puisqu’elle était par définition faite pour un tiers (le client) et non pour son propre usage. Le raisonnement a le mérite de la simplicité : l’élément matériel du délit est la reproduction ou la mise à disposition de matériel de reproduction. L’élément intentionnel est le fait pour l’exploitant de ne pas avoir obtenu l’autorisation des titulaires de droits, étant précisé qu’il ne pouvait bénéficier d’aucune exception de copie privée.
Dans notre espèce, le tribunal correctionnel a également désigné l’exploitant comme « le copiste », mais n’en a pas tiré de conséquences aussi radicales : au lieu d’examiner l’élément intentionnel sous l’angle du copiste lui même (le copiste avait-il obtenu le droit de reproduction, ou à défaut, avait-il réalisé une copie privée ou de sauvegarde pour son propre usage ?), le tribunal a dévié vers la connaissance qu’il avait de l’usage du client (le copiste pouvait-il ignorer que la copie n’était pas privée ou de sauvegarde pour son client ?) :
Le flou dans la définition de l’élément intentionnel :
Depuis l’avènement du nouveau code pénal (article L121-3), il a été clairement postulé « qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». En matière de contrefaçon, où l’intention était auparavant très édulcorée (on admettait communément que l’intention puisse se déduire de la réalisation matérielle de l’infraction), il a donc fallu développer la méthode des faisceaux de présomptions pour caractériser un élément intentionnel pas toujours évident.
Le délit de contrefaçon est constitué par le fait, pour toute personne, de procéder à l’un des actes prévus par les articles L 122-1 et suivants du CPI, tout en sachant que les autorisations des titulaires de droits ne lui sont pas acquises. En l’espèce, le tribunal a pris soin de souligner que l’exploitant avait mis à disposition du public une infrastructure permettant la reproduction massive d’œuvres de l’esprit, sans solliciter l’autorisation des propriétaires, et « en sachant qu’il rendait ces moyens matériels aisément accessibles à des personnes n’ayant pas acquitté les droits d’auteurs ou n’ayant pas acquis de licence d’utilisation ».
Le tribunal renforce encore cette première présomption en indiquant que l’exploitant ne pouvait ignorer la nature illicite des copies, puisqu’il avait « accepté la copie multiple d’un cédérom ». Il ajoute que l’exploitant a volontairement supprimé les protections de certains logiciels afin de les reproduire. Il indique enfin que l’exploitant ne s’était pas seulement livré comme il le prétendait à une « prestation purement matérielle », ce qui supposerait que le client aurait été seul responsable de l’utilisation des outils mis à sa disposition. En effet, il pratiquait une différence importante de prix selon la nature du support copié (CD Audio ou cédérom), alors que l’opération et le support vierge sont exactement les mêmes dans les deux cas. Si on examine les arguments choisis par le tribunal, on comprend que pour lui, l’élément intentionnel est le fait que l’exploitant connaissait le caractère illégitime, pour ses clients, de leur demande de copie.
Comme on l’a vu, la cour d’appel avait été nettement plus stricte dans l’affaire précitée du 25 juin 1997 à l’égard de la société de reprographie. Dans ce cas, la reproduction aurait pu être légitime si elle avait été faite par l’étudiant lui-même, puisqu’il s’agissait d’un seul exemplaire et pour son propre usage. Pourtant, la cour d’appel avait estimé que la société de reprographie, qui agissait en tant que copiste, ne pouvait se prévaloir pour elle-même de l’exception de copie privée qui bénéficiait le cas échéant à l’étudiant. Dans le cas présent, le jugement du tribunal correctionnel laisse supposer que notre exploitant pourrait théoriquement poursuivre son affaire s’il prenait à l’avenir toutes précautions pour s’assurer de la légitimité des demandes de copie faites par ses clients. En pratique, il est à peu près certain que le goût d’entreprendre lui sera passé, du fait de l’importance des peines et réparations mises à sa charge, sans compter la confiscation de son matériel et de ses stocks.
Cette juste sévérité ne fera pas oublier l’absence totale de mise en cause des clients, bien que certains d’entre eux aient été interceptés pour les besoins de la police. De plus, lors de la fameuse émission Capital, il était très clair que parmi les clients interrogés sur la légitimité de leur copie, bien peu semblaient dupes !
Il est dommage que l’occasion d’un procès aussi médiatique, mobilisant des parties civiles aussi représentatives, n’ait pas été saisie pour éradiquer chez monsieur Tout-le-Monde, un sentiment d’impunité persistant vis à vis du piratage.
Véronique BEAUJARD
Avocat à la cour