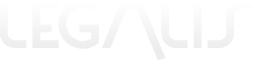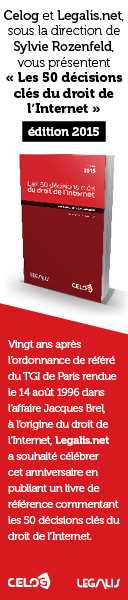Actualités
Constat sur internet : la jurisprudence rappelle les conditions rigoureuses de validité
 En matière civile, la preuve est libre. Mais les constats réalisés sur internet doivent obéir à des conditions de validité rigoureuses afin de prouver l’existence d’un acte de contrefaçon. Ainsi, dans un jugement du 7 février 2007, le TGI de Mulhouse a considéré que le manque de rigueur d’établissement du procès verbal de constat lui enlevait toute force probante et a débouté la société Groupe Philippe Bosc de son action en contrefaçon et parasitisme. Elle invoquait la reprise de sa marque « Bosc Office » dans les méta-tags du site d’un concurrent, la société Shiva. Elle avait mandaté un huissier pour réaliser un constat qui en apporterait la preuve. Il s’était rendu sur le moteur de recherche Google pour démontrer que Shiva apparaissait dans les premiers résultats lorsqu’une requête était effectuée sur les termes litigieux et prouver ainsi qu’ils étaient repris dans les codes sources. Mais les juges vont relever plusieurs éléments montrant qu’aucune méthodologie stricte n’avait été suivie pour la réalisation du constat qui perdait alors toute force probante. Les magistrats ont estimé que la recherche effectuée par l’huissier était incomplète car il n’avait pas cliqué sur le lien affiché dans la page de résultats. Or il s’avérait que ce dernier renvoyait à un site n’ayant aucun rapport avec la société Shiva. De plus, le constat ne précisait pas comment l’huissier avait trouvé et imprimé deux pages mises en annexe. Enfin, les juges ont souligné le fait que le constat n’indiquait pas que la mémoire cache avait été vidée. Cette absence de mention avait déjà conduit la cour d’appel de Paris à remettre en cause la force probante d’un constat, dans un arrêt du 17 novembre 2006.
En matière civile, la preuve est libre. Mais les constats réalisés sur internet doivent obéir à des conditions de validité rigoureuses afin de prouver l’existence d’un acte de contrefaçon. Ainsi, dans un jugement du 7 février 2007, le TGI de Mulhouse a considéré que le manque de rigueur d’établissement du procès verbal de constat lui enlevait toute force probante et a débouté la société Groupe Philippe Bosc de son action en contrefaçon et parasitisme. Elle invoquait la reprise de sa marque « Bosc Office » dans les méta-tags du site d’un concurrent, la société Shiva. Elle avait mandaté un huissier pour réaliser un constat qui en apporterait la preuve. Il s’était rendu sur le moteur de recherche Google pour démontrer que Shiva apparaissait dans les premiers résultats lorsqu’une requête était effectuée sur les termes litigieux et prouver ainsi qu’ils étaient repris dans les codes sources. Mais les juges vont relever plusieurs éléments montrant qu’aucune méthodologie stricte n’avait été suivie pour la réalisation du constat qui perdait alors toute force probante. Les magistrats ont estimé que la recherche effectuée par l’huissier était incomplète car il n’avait pas cliqué sur le lien affiché dans la page de résultats. Or il s’avérait que ce dernier renvoyait à un site n’ayant aucun rapport avec la société Shiva. De plus, le constat ne précisait pas comment l’huissier avait trouvé et imprimé deux pages mises en annexe. Enfin, les juges ont souligné le fait que le constat n’indiquait pas que la mémoire cache avait été vidée. Cette absence de mention avait déjà conduit la cour d’appel de Paris à remettre en cause la force probante d’un constat, dans un arrêt du 17 novembre 2006.
Cette même juridiction a d’ailleurs rendu un autre arrêt le 25 octobre 2006, invalidant également un procès verbal. Elle a considéré que le fait d’aspirer un site dépassait le cadre du constat qui permet seulement de procéder à des captures d’écran. Elle est même allée beaucoup plus loin et a analysé ce procédé en une saisie-contrefaçon qui devait respecter les formalités prévues à l’article 332-1 du code de la propriété intellectuelle. Cela voudrait dire que l’aspiration d’un site devrait être autorisée par un juge : cette première décision à aller dans ce sens apparaît très ou trop sévère. Néanmoins le demandeur a obtenu gain de cause en produisant une lettre envoyée par un tiers à laquelle étaient annexées deux impressions du site en cause. Les juges ont admis cette preuve alors que les conditions de validité requises n’étaient pas remplies. En effet, il n’y avait aucune mention de la manière dont les pages avaient été imprimées. Mais la preuve étant libre, les juges ne peuvent statuer sur sa validité que si le défendeur la met en cause.