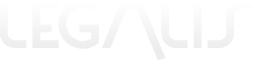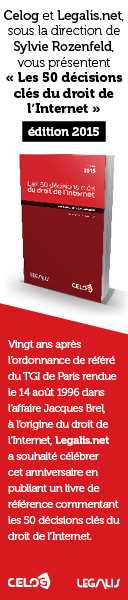Actualités
Le journaliste, l’historien et le droit au respect de la vie privée
Depuis longtemps, la jurisprudence reconnaît à l’auteur le droit « de puiser dans la vie les matériaux nécessaires à son oeuvre»[1]. Pour autant si universel « que soit le royaume des muses, il y a chez chaque personne étrangère que l’artiste y prend à son gré comme sujet, des choses trop intimes pour que son art puisse en disposer librement »[2]. L’auteur engagera sa responsabilité civile et pénale chaque fois qu’il divulguera une information couverte par le droit au respect de la vie privée.
Il existe pourtant deux catégories d’auteurs qui bénéficient du privilège d’abaisser le mur de la vie privée. Elles tirent ce privilège de l’article 11 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme qui pose le principe de la liberté d’expression en proclamant que la « libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». Article, qui fera naître son corollaire « le droit de savoir du citoyen »[3].
La première catégorie est celle de l’historien. C’est en vertu de ce droit de dire et de savoir, que très tôt en effet les tribunaux ont admis à son profit un véritable droit à raconter la petite histoire[4]. Ainsi est-il devenu classique de lui reconnaître la liberté pleine et entière « d’exposer les faits et d‘apprécier selon ses vues personnelles, les actes, l’attitude et le caractère des hommes qui ont joué un rôle dans les événements dont il entend fixer le souvenir »[5].
A la liberté de l’historien est venue s’ajouter celle du journaliste dont le propre est de s’intéresser à l’actualité[6]. Sans doute, comme le relève Nerson, parce qu’il « n’y a pas de limites précises entre le journaliste et l’historien »[7]. D’ailleurs, la distinction devient vite impraticable lorsque l’on quitte l’actualité du moment. Qui, comme le relevait Savatier, « saurait déterminer le nombre d’années à partir duquel le passé devient historique »[8] ? La difficulté de distinguer entre les deux genres se poserait aujourd’hui avec d’autant plus d’acuité « [..] qu’autrefois les livres d’histoire étaient composés et publiés avec un recul qui contribuait à la sérénité, [.. alors que] maintenant les livres dits d’histoire [..] servent l’actualité au plus près »[9].
En fait ces deux catégories bénéficient d’un même « intérêt légitime d’information »[10]. Intérêt qui prend directement sa source dans le droit de savoir et le droit de dire ce qui est ou a été. L’œuvre journalistique ou historique, poursuit ainsi une même « volonté de renseigner »[11].
Ainsi, les journalistes et les historiens pourront divulguer des informations normalement protégées par le droit au respect de la vie privée sur toutes les personnes mêlées à un événement public passé ou présent. Les hommes politiques, les vedettes du show-business, les membres des familles royales, les sportifs reconnus seront particulièrement concernés[12] même si à l’occasion d’un drame (catastrophe aérienne, prise d’otages, maladie etc.) des anonymes sortent du rang pour être placés, souvent malgré eux, sous la lumière de l’actualité. Cet abaissement de la vie privé touche également la catégorie particulière des justiciables[13]. Mais ce n’est plus alors au nom de leur activité publique que le droit de dire et de savoir s’impose, mais parce que « c’est au nom du peuple que la justice est rendue »[14].
Reste que la liberté accrue de l’historien ou du journaliste ne doit « pas aboutir à méconnaître les droits de la personnalité »[15]. La jurisprudence en est ainsi venue très rapidement à poser un certain nombre de limites de façon à éviter les dérives. Le droit d’informer le public ne saurait justifier en effet toutes sortes d’atteintes dans la vie privée.
La révélation de faits intimes poursuivre un but utile d’information (I), être mesurée, prudente et objective (II) .
I) La révélation de faits intimes doit poursuivre un but utile d’information :
A partir du moment où l’on justifie la liberté accrue du journaliste ou de l’historien par le besoin d’informer le public, on comprend aisément que la jurisprudence condamne toute divulgation qui ne permet pas de mieux comprendre les événements rapportés. C’est ainsi, nous dit M. Agostinelli, « qu’au-delà de l’émergence d’un critère de délimitation tel que le droit à l’information ou l’intérêt du public à être informé, [.. il faut] que la diffusion de l’information, pour être licite, présente une réelle utilité tenant, soit à la connaissance du personnage lui-même, soit de manière plus générale, à son activité »[16]. On parle également du principe de « stricte nécessité »[17].
Ainsi, la révélation d’une opération chirurgicale subit par un comédien a pu être jugée comme « nullement nécessaire pour l’annonce de la préparation d’un film »[18]. De la même manière, la publication de la photographie d’une personne exerçant des fonctions officielles, aux seules fins d’illustration, ne rentre pas dans le cadre des nécessités de l’information et sort du contexte spécifique dans lequel la photographie a été prise[19].
Les juges imposent parfois que le fait divulgué soit « directement lié » à l’actualité[20]. Il a notamment été jugé que la publication d’anciens clichés, ne se rattachant pas aux événements traités dans l’article où ils apparaissaient, ne poursuivait pas le but d’information du public sur des événements d’actualité[21].
Est-il nécessaire de préciser que cette « utilité » s’apprécie en toute logique au regard des nécessités de l’information et que tout détournement à des fins publicitaires ou plus généralement commerciales constitue un abus sanctionnable ? Ainsi, la publication d’une photographie du chef de l’état dans un bateau pneumatique s’inscrit certes dans le cadre d’une information légitime sur ses loisirs mais comme a pu le relever le Tribunal de Grande Instance de Paris lorsque cette information est délivrée à des fins « essentiellement publicitaires »[22] le droit à l’information ne saurait légitimer une telle publication. Enfin, les attaques personnelles, le dénigrement gratuit ou l’intention de nuire[23] sont de la même manière sanctionnés.
Plus tard, le fait ne concernera plus l’actualité. Il entrera alors dans le domaine de l’histoire, fut-elle l’histoire contemporaine. A ce niveau, tant que la personne dont la vie privée fait l’objet d’investigation est vivante le critère de l’utilité trouvera à s’appliquer pour l’historien comme pour le journaliste.
A sa mort, on sera tenté de ne plus appliquer ce critère en considérant que le droit au respect de la vie privée n’est plus applicable. La question est sur ce point controversée. Il convient simplement de noter ici, que dans tous les cas de figure, lorsque les juges refusent d’admettre que la vie privée survit à la mort, ils accordent ce droit aux héritiers si leur propre vie privée fait elle-même l’objet d’une atteinte. Ainsi, la cour d’appel de Paris a pu retenir : « si l’article 9 du code civil confère à chacun le droit d’interdire toute forme de divulgation de sa vie privée, cette faculté n’appartient qu’aux vivants [..], les héritiers d’une personne décédée sont uniquement fondés à défendre sa mémoire contre l’atteinte que lui porte la relation de faits erronés ou déformés, publiés de mauvaise foi ou avec une légèreté excessive. [..] . Les dispositions de l’article 9 du code civil – comme celles de la loi du 29 juillet 1881 – cessent dès lors de limiter la liberté d’information et d’expression de l’historien et du critique, qui peuvent seuls engager leur responsabilité dans les termes du droit commun, s’ils viennent à manquer au respect de la vie privée qu’ils doivent à la vérité »[24].
C’est donc en toute hypothèse au moment où les contemporains du défunt auront disparu, où les liens familiaux commenceront à se diluer, que l’historien pourra réellement s’affranchir du critère de l’information utile. Liberté que ne connaîtra jamais le journaliste.
II) La révélation de faits intimes doit être mesurée, prudente et objective :
Si les juges se défendent de « juger l’histoire » [25] et ne dénient pas le droit pour l’historien d’écrire une œuvre historique engagée et partisane, ils lui imposent de se montrer « prudent, avisé et conscient des devoirs d’objectivité qui lui incombe». Ainsi « l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli, soit, en vertu d’une obligation légale, réglementaire, conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel, s’il s’agit notamment d’un historien, en vertu des exigences d’une information objective »[26].
De la même manière, un même souci d’objectivité s’impose aux journalistes[27]. Il a cependant pu être précisé qu’il serait irréaliste, voire inéquitable d’exiger d’un journaliste qu’il fasse abstraction de ses opinions, de ses sympathies et de ses antipathies, en d’autres termes qu’il soit parfaitement objectif. Il doit simplement s’efforcer d’être intellectuellement honnête et donc les sentiments qu’il éprouve ne doivent pas altérer ni la pureté de ses intentions, ni la sincérité de sa démarche[28].
Enfin, le récit doit également avoir été guidé par un « souci constant d’exactitude »[29]. La vérification des sources s’impose. Le journaliste ne peut donc se dispenser « de l’obligation impérieuse de ne livrer au lecteur que des faits exacts, vérifiés par lui-même et d’apporter une circonspection particulière, dès lors qu’il porte à la connaissance du public des informations qui mettent en cause la vie privée ou professionnelle des particuliers »[30].
Cette condition est à relier à « l’obligation de prudence, et de circonspection objective »[31] qui s’impose à l’historien et qui permet ainsi aux juges de sanctionner la divulgation d’informations erronées[32].
Synthèse jurisprudentielle réalisée par Ambroise Soreau
[1] CA Paris, 24 avril 1936, D., 1936, p.319. (A. France, La révolte des anges) ; V. également Trib. Civ. Seine, 8 déc. 1938, D., 1939, p. 176.
[2] R. SAVATIER , Le droit de l’art et des lettres , Paris, LGDJ, 1953, p. 83.
[3] V. C. BIGOT, Les exigences de l’information et la protection de la vie privée , LP, Nov. 1995, n°126. ; La Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 19, proclame le droit de recevoir des informations et des idées. De la même manière, l’article 10 de CEDH proclame « la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ». ; Comp. C. ATIAS, et l’idée « d’un droit à ne pas être informé » in La protection pénale de la vie privée , in Liberté de la presse et Droit pénal , PUF Aix-Marseille, 1994, p. 90.
[4] V. T. Seine, 10 mars 1897, DP, 1897, 2, p. 135.
[5] T. Seine, 3 janv. 1934, Gaz. Pal., 1934, 1, p. 541.
[6] Sur la notion d’actualité voir TGI Nanterre 17 juin 1998, LP avr. 1998, p.35. ; TGI Nanterre, 3 mars 1999, LP 1999, p. 68.
[7] V. R. NERSON, Le respect par l’historien de la vie privée de ses personnages , op. cit., p. 450. ; Contra CA Paris, 28 mai 1903 :« le privilège de l’historien ne peut être confondu avec le droit du journaliste et étendu à des articles de controverses contemporains [..]», , D., 1906, 2, p. 226. ; Comp. TGI Paris, 1re ch., 7 juill. 1993, J-DATA, doc. 048540 : « La publication d’un groupe de personne, même reconnaissable au sein d’une manifestation publique, peut être justifiée par les nécessités de l’information ou de l’histoire, [..] ».
[8] R. SAVATIER, op. cit., p. 171.
[9] R. LINDON, TGI Paris (réf.) 12 nov. 1976, JCP, 1977, 18695.
[10] V. J. RAVANAS, op. cit., p. 201.
[11] Cass. Crim. 17 févr. 1949, Gaz. Pal., 1949, 1, p. 127.
[12] Réserve faite des mineurs. Les articles 39 bis et 39 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse interdisent toute publication relative à des mineurs, sans l’autorisation des personnes exerçant l’autorité parentale.
[13] V. CA Paris 24 mai 1994, J-Data doc 022205. « Les dispositions de l’article 9 du code civil relatif à la protection de la vie privée ne peuvent faire obstacle au principe de la publication des débats judiciaires en matière correctionnelle dans les conditions prescrites par l’article 38 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881 » (affaire du sang contaminé). Il n’existe pas en droit Français, de droit à l’oubli en matière judiciaire en ce sens Cass. Civ., 20 nov. 1990, JCP, 1992, II, 21908, note J. RAVANAS. ; Sur la question V. C. COSTAZ, Le droit à l’oubli , Gaz. Pal., 26 et 27 Juill. 1995, p. 2. Sur le principe de publicité des décisions de justice, principe reconnu comme un principe général du droit V. CE, 4 oct. 1974, Rec. du Conseil d’Etat, 1974, 464, conclusion GENTOT. ; V. les articles 22 et 433 NCPC et 306 et 400 CPP : V. également G. LEVASSEUR, Liberté de la presse et justice pénale , Revue Pénale Suisse, 1961, p. 265. ; Sur le cas particulier des juridictions disciplinaires V. P. KAYSER, p. 300 et s. ;V. enfin A. VITU, Le principe de la publicité dans la procédure pénale , Annales de la faculté de droit de Toulouse, p. 255 et s. et sur l’image de personne, impliquée dans un procès V. J. RAVANAS, op. cit. p.148.
[14] E. DERRIEUX, Les comptes rendus d’audience , in Liberté de la presse et Droit pénal , PUF Aix-Marseille 1994, p. 271.
[15] A. FRANCON, Des limitations que les droits de la personnalité apportent à la création littéraire et artistique , RIDA, 1972, p 153.
[16] A. AGOSTINELLI, op. cit., n°331.
[17] C. BIGOT, Les exigences de l’information et la protection de la vie privée , LP, Nov. 1995, n°126.
[18] TGI Paris, 4 juill. 1984, D., 1985, Somm., p. 16, obs. R. LINDON. ; Dans le même sens TGI Paris 8 nov. 1989, Gaz. Pal., 1990, 1, Somm., p. 20.
[19] CA Paris, 1re ch., J-DATA, doc. 023071.; Sur l’appréciation du lien de pertinence entre un article et la photographie qui l’illustre TGI Paris 24 mars 1997, LP sept. 1997, n°144-1, p. 99.
[20] TGI Paris, 3 juillet 1974, op. cit., : La reproduction d’une photographie « n’est admissible, pour les nécessités de l’information, que si celle-ci a été prise dans des circonstances ayant un rapport direct avec les événements en cause ou les faits qui en ont été la suite ». V. dans le même sens TGI Paris, 13 juin 1991, J-DATA, doc. 047458. ; TGI Paris, 17 nov. 1993, J-DATA, doc. 047243 . ; TGI Paris 29 janv. 1986, Gaz. Pal., Recueil des sommaires, p. 127.
[21] TGI Paris, 8 nov. 1989, LP, 1990, n°77, I, p. 90.
[22] TGI Paris, 4 avr. 1970, JCP, 1970, 16938, note R. LINDON.
[23] V. Crim. 13 fév. 1990, Bull. Crim., n°75.
[24] CA Paris, 1re ch. , 3 nov. 1982, D. 1983, p. 248, obs. R. LINDON.
[25] TGI Paris, 6 mai 1983, D. 1984, p. 14. Ils rappellent ainsi qu’ils n’ont pas reçus « de la loi mission de décider comment doit être représenté ou caractérisé tel ou tel épisode de l’histoire nationale ou mondiale ». ; V. également TGI Paris 14 févr. 1990, Gaz. Pal., 1991, 2, 452, note DOMINGO.
[26] Cass. Civ., 27 févr. 1951, D., 1951, p. 329, note H. DESBOIS ( Affaire Branly).
[27] V. CA Douai, 22 nov. 1963, JCP, 1964, 13482. ; CA Rouen, 20 avr. 1971, Gaz. Pal., 1971, jp., p. 447 ; CA Paris, 12 nov. 1897, D., 1898, 2, p. 119 ; Comp. Crim. 27 janv. 1949, bull. Crim., n° 37 ; Crim 5 nov. 1970, D. 1971, p. 90 ; Crim. 12 oct. 1993, Bull. Crim., n° 289. (sur le devoir d’objectivité du journaliste)
[28] TGI Paris 4 juill. 1985, D. 1986, p. 5, note AGOSTINI.
[29] TC. Seine, 20 nov. 1957, Gaz. Pal., 1958, 1, jp, p. 94.
[30] TC Paris, 17eme ch., 7 oct. 1969, Gaz. Pal., 1970, 2, jp, p. 90. ; Cass. Crim. 14 mars 1962, Bull. Crim., n°131, Cass. Crim. 8 nov. 1962, Bull. Crim., n° 313 ; TGI Paris 29 juin 1994, JCP 1994, II, 22348, note D. BECOURT.
[31] V. TGI Paris, 8 juill. 1981, D., 1982, p. 59, note EDELMAN.
[32] TGI Paris, 16 janvier 1991, Gaz. Pal., 1991, 2, Samedi 3 août 1991, p. 25.