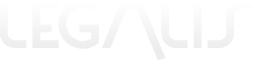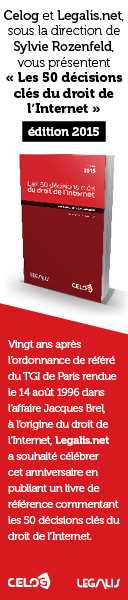Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre, chambre de la presse Jugement du 2 novembre 2000
Françoise V., Marc F. et Hans H. / ministère public, Tareg Al B.
contenus illicites - correspondance privée - courrier électronique - sécurité du réseau
Arrêt du 17 décembre 2001 de la Cour de Paris
Procédure
Par ordonnance rendue le 14 mars 2000 par l’un des juges d’instruction de ce siège, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal, sous la prévention :
1°/ Hans H.
d’avoir, à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1996 et 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en ayant la qualité de personne chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de cette mission, ordonné et facilité, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, en l’espèce des messages à caractère privé de la messagerie électronique de Tareg Al B. ;
fait prévu et réprimé par l’article 432-9 du code pénal ;
2°/ Françoise V. et Marc F.
d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en ayant la qualité de personne chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de cette mission, commis, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, en l’espèce des messages à caractère privé de la messagerie électronique de Tareg Al B.,
fait prévu et réprimé par l’article 432-9 du code pénal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2000, puis renvoyée à celle du 28 septembre 2000 pour laquelle les prévenus ont été régulièrement cités.
Le 28 septembre 2000, Hans H., Françoise V. et Marc F. ont comparu, assistés de leurs conseils, Me Iweins pour le premier et la seconde, et Me Normand-Bodard pour le troisième ; la partie civile, Tareg Al B., était également présente et assistée de son avocat, Me Fleury.
Le président a procédé au rappel des faits, à l’interrogatoire des prévenus, à l’audition de la partie civile et à celle du témoin cité à sa requête.
Le conseil de la partie civile a pris la parole et a demandé la condamnation solidaire de Françoise V., de Hans H. et de Marc F. à lui payer la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 F en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions tendant à la condamnation pénale des prévenus.
Les conseils de ces derniers ont été entendus en leurs moyens de défense ;ils ont plaidé la relaxe de Françoise V., de Hans H. et de Marc F., et ont sollicité l’octroi à chacun d’entre eux la somme de 30 000 F sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 novembre 2000, dont connaissance a été donnée aux parties, conformément à l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Faits
Sur l’action publique
Les faits sont les suivants :
Le 19 juillet 1997, Tareg Al B. a porté plainte contre personne non dénommée et s’est constitué partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Paris pour vol, atteinte à la vie privée, violation et détérioration de correspondances privées et discrimination à son encontre.
Il exposait qu’il était étudiant en informatique et préparait, dans le cadre de l’université Paris VI, la soutenance d’une thèse sur le cerveau dans les systèmes connexionnistes en intelligence artificielle.
Pour ce faire, il avait effectué des travaux de recherche au sein du Laboratoire de Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (PMMH) de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle (ESPCI) sise à Paris (75005) 10 rue Vauquelin, où il disposait d’un ordinateur qui lui avait été attribué et se trouvait protégé par un code d’accès.
Dans le courant du mois de septembre 1996, il avait constaté la disparition de certaines des informations qu’il avait enregistrées dans cet ordinateur, parmi lesquelles ses publications scientifiques figurant dans son courrier électronique, dont une partie avait été subtilisée, ce qui, selon lui, signifiait nécessairement que l’auteur de cette soustraction avait » piraté » le système de protection du réseau et avait modifié par suppression les textes existants.
La partie civile indiquait, de surcroît, qu’au début de l’année 1997, deux membres du laboratoire PMMH avaient été surpris en flagrant délit de violation de son courrier électronique, lequel contenait des correspondances privées.
Par ailleurs, il estimait qu’il était victime de discrimination de la part du directeur du laboratoire, Hans H., qui le soupçonnait d’être l’auteur d’une lettre ayant eu pour objet de retirer de la publication un article rédigé par une autre élève du groupe et avait refusé de le réinscrire en classe préparatoire de thèse, procédant ainsi à son éviction de fait.
Une information des chefs d’atteinte à l’intimité de la vie privée, accession frauduleuse à un système de traitement automatisé, suppression, modification de données, discrimination et atteinte au secret des correspondances, était ouverte le 20 juillet 1997.
Les investigations effectuées sur commission rogatoire du magistrat instructeur ont établi les éléments qui suivent :
à leur retour des vacances, début septembre 1996, Anne T., étudiante en préparation de thèse comme Tareg Al B., et celui-ci s’étaient plaints que certains de leurs fichiers avaient disparu de leur répertoire informatique ;
la jeune femme, qui avait observé que le « log-in » (signature informatique) de Tareg Al B., soit » T.L.J. « , apparaissait dans ses fichiers, en avait avisé Françoise V., ingénieur système du laboratoire, afin qu’elle l’aide à récupérer les travaux qu’elle avait perdus, ce qui avait pu être fait, et en avait également parlé à la partie civile, laquelle lui avait affirmé qu’elle n’était pour rien dans cette disparition ;
le 3 décembre 1996, Anne T. s’était aperçue qu’un article, intitulé « Memory effects in elastic fiction over correlated surface », qu’elle avait rédigé en collaboration avec le Docteur Roux et qui devait paraître à New York, en février 1997, dans la Physical Review, avait été retiré de la publication à la suite d’une correspondance qu’elle aurait prétendument envoyée, le 19 novembre 1996, au directeur de la revue pour demander ce retrait, et qui s’avérait être un faux, sa signature ayant été imitée ;
elle s’en était émue et en avait aussitôt averti tant le responsable de la revue en cause, de manière à ce qu’il procède, en dépit de ce courrier, à la publication de son article, que les policiers du commissariat du 4e arrondissement de Paris, auprès desquels elle effectuait une déclaration de main courante, et, enfin, Hans H., directeur du laboratoire PMMH ;
le 16 décembre 1996, ce dernier avait convoqué Tareg Al B., en présence d’Anne T. et du Docteur Roux, afin de lui faire part des soupçons que celle-ci nourrissait à son endroit ; la partie civile avait dénié toute implication dans cette affaire, qu’il s’agisse de disparition des fichiers enregistrés dans son ordinateur ou de la fausse lettre adressée au nom de la jeune femme à la Physical Review et avait refusé sa proposition concernant la poursuite éventuelle de ses recherches dans un laboratoire allemand que Hans H. dirigeait également ;
Anne T. avait alors publiquement déclaré qu’elle retirait ses accusations contre Tareg Al B. et avait écrit en ce sens à Hans H. le même jour ;
au retour des vacances de Noël, Françoise V. devait informer le directeur du laboratoire PMMH de ce qu’elle avait constaté que la moitié du courrier électronique de l’établissement – qui comprenait 70 personnes, dont 28 étudiants en thèse – concernait la seule partie civile, qu’elle en fût l’expéditeur ou le destinataire ;
Hans H. avait alors décidé de faire surveiller la messagerie de Tareg Al B. ; une semaine plus tard, un texte lui avait été apporté consistant en un message électronique, intitulé « International crime claimed in famed ivory tower french research lab », adressé, le 23 janvier 1997, à Tareg Al B. et destiné, selon les indications qui étaient contenues dans la lettre qui l’accompagnait, à être envoyé à divers journaux diffusés sur Internet ; ce courrier relatait qu’Anne T., en proie à un dépit amoureux, avait, à tort, accusé de faux l’un de ses collègues et lui avait ainsi causé un préjudice très important du fait que la direction du laboratoire PMMH s’était associée à ses accusations sans fondement et avait pris fait et cause pour la jeune femme, en proposant à l’étudiant injustement dénoncé de partir poursuivre ses travaux en Allemagne ;
au vu de ce message mettant en cause le laboratoire PMMH, Hans H. avait décidé de fermer sur le champ le compte informatique de la partie civile et l’avait informé par écrit de ce qu’il souhaitait la rencontrer pour évoquer avec elle l’ensemble de ces difficultés ;
Tareg Al B. ne s’était pas présenté à l’ESPCI ;
il portait plainte, le 28 avril 2000, pour vol de données informatiques auprès des fonctionnaires de police du commissariat du 5e arrondissement de Paris ; néanmoins, les documents informatiques visés dans cette plainte ayant été mis à sa disposition au cours de l’enquête, celle-ci faisait l’objet d’un classement sans suite ;
enfin, ayant sollicité d’être réinscrite au sein du laboratoire PMMH en préparation de thèse, la partie civile avait appris par Hans H., en mai 1997, que celui-ci avait donné un avis négatif à ce sujet, qui avait été suivi par le directeur de l’Ecole, Pierre-Gilles de Gennes.
Entendus par les enquêteurs, les responsables du laboratoire ont fait les déclarations suivantes :
Françoise V., ingénieur au CNRS, indiquait qu’elle était administrateur des systèmes et réseaux informatiques au sein du laboratoire PMMH depuis 1984.
Elle confirmait les soupçons portés sur Tareg Al B. à l’occasion des diverses modifications des fichiers appartenant à Anne T., puis de l’envoi, au nom de cette dernière, d’une correspondance portant sa signature falsifiée ; précisant avoir, dès lors, surveillé l’utilisation, par la partie civile, du réseau informatique de l’établissement, laquelle lui avait paru considérable ; elle reconnaissait qu’elle avait, à la demande de Hans H., » espionné » durant une dizaine de jours la messagerie électronique de Tareg Al B., dont elle s’était aperçue qu’elle était, pour 90 %, composée de messages d’ordre privé, et ce dans le but de découvrir la trace de la fausse lettre adressée au nom d’Anne T..
Elle déclarait, en outre, que le 23 janvier 1997, un chercheur du laboratoire et également administrateur du réseau, Marc F., avait découvert dans la messagerie de la partie civile le courrier intitulé » International crime claimed in famed ivory tower french research lab » mentionné ci-dessus, à l’archivage duquel tous deux avaient procédé, après en avoir informé le directeur du laboratoire qui leur en avait donné l’ordre.
Hans H., chercheur au CNRS et directeur du laboratoire PMMH, indiquait, pour sa part, qu’il était également directeur de thèses de certains des étudiants inscrits à l’ESPCI et qu’il avait, à ce titre, recommandé l’inscription de Tareg Al B., dans cette école, en 1994 ; précisant que celui-ci lui avait rapidement paru manquer de rendement pour parvenir à soutenir sa thèse dans le temps qui lui était imparti ; il déclarait qu’il avait cependant accepté d’émettre un avis favorable à sa réinscription en 1995 et 1996, non sans attirer l’attention de l’intéressé sur la nécessité dans laquelle il se trouvait d’avoir à faire un effort sérieux ; il confirmait qu’avisé, courant décembre 1996, des difficultés rencontrées par Anne T. avec celui-ci, et notamment de l’envoi d’une lettre apocryphe sollicitant le retrait d’une de ses publications particulièrement importante, il avait, dans un premier temps, essayé d’apaiser les antagonistes en proposant notamment à Tareg Al B. de partir en Allemagne ; celui-ci ayant protesté de son innocence devant sa collègue, qui ne l’avait, en définitive, pas mise en doute, il avait pensé que l’incident était clos.
Il reconnaissait qu’ayant appris de Françoise V. que la moitié du courrier électronique du laboratoire concernait la partie civile, il avait demandé à l’ingénieur système de l’établissement de surveiller la messagerie de Tareg Al B. dans le but de contrôler la provenance et la nature des messages reçus ou adressés par celui-ci et dans l’intérêt de la sécurité et du bon usage de son réseau informatique, qui ne devait pas être utilisé à des fins privées. Il avait ainsi été mis au courant de la découverte de la dépêche intitulée » International crime claimed in famed ivory tower french research lab » qu’il considérait comme diffamatoire pour le laboratoire. Il avait, en conséquence, donné l’ordre de fermer le compte informatique de l’étudiant. Par la suite, il n’avait pu entrer en contact avec Tareg Al B. malgré son souhait, le jeune homme ne venant au laboratoire que très tard le soir, mais avait laissé l’ensemble de ses travaux à sa disposition. Il confirmait, enfin, qu’il avait émis un avis défavorable quant à sa réinscription à l’ESPCI, lequel avait été suivi par la direction de l’école.
Quant à Marc F., fonctionnaire de la Ville de Paris et maître de conférences à l’ESPCI, il indiquait qu’il avait été administrateur système du site informatique du laboratoire, avant l’arrivée de Françoise V., et avait conservé ces responsabilités comme adjoint, lors de la prise de fonctions de cette dernière. Ayant eu connaissance des difficultés relationnelles existant entre Anne T. et Tareg Al B., il avait également appris qu’Hans H. avait demandé à Françoise V. de surveiller la messagerie électronique de la partie civile, soit le volume et les destinations de ce courrier. Il admettait qu’à la suite du blocage de la messagerie du réseau, il avait, un jour de janvier 1997, été amené à débloquer le système en intervenant sur les messages en attente ; il avait, à cette occasion, constaté la présence d’un document dont l’intitulé lui avait paru surprenant et sans lien avec la physique, s’agissant de délit commis dans un laboratoire français, et en avait parlé aussitôt à Hans H. qui leur avait alors demandé, à Françoise V. et à lui-même, d’archiver ce message, ce qu’ils avaient fait.
Il ajoutait que les messages arrivant sur un système informatique se trouvaient dans une zone dite » tampon » avant d’être adressés vers les boîtes à lettres, et qu’une intervention pouvait être nécessaire sur cette zone pour permettre la remise en état du système, observant, toutefois, que seul un examen des messages archivés peut lever le doute sur leur teneur professionnelle ou non. Il concluait qu’il était dans le rôle et les prérogatives d’un administrateur système de débloquer le fonctionnement d’un réseau informatique, ces responsabilités entraînant la prise de connaissance de messages destinés aux utilisateurs du réseau.
Tous trois indiquaient que le système informatique du laboratoire PMMH était relié, depuis 1993, au réseau mondial par le système Renater, lequel est dédié à la recherche et à l’enseignement et dont la charte déontologique, versée à la procédure, précise qu’il ne doit être utilisé qu’à des fins strictement professionnelles et que ses règles d’usage s’imposent à tout utilisateur du réseau.
Respectivement mis en examen, le 30 avril 1999, du chef d’atteinte au secret des correspondances prévu et réprimé par l’article 432-9 du code pénal, pour les deux premiers, et de complicité de ce délit, pour le troisième, Françoise V., Marc F. et Hans H. ont confirmé devant le magistrat instructeur les déclarations qu’ils avaient faites aux enquêteurs, reconnaissant ainsi avoir, pour des raisons tenant au piratage informatique ayant affecté le réseau du laboratoire PMMH, dont Anne T. était notamment utilisatrice, consulté ou donné l’ordre de consulter d’abord le contenu des fichiers, puis celui de la messagerie électronique de Tareg Al B., qui n’en avait pas été informé, compte tenu de ses horaires de venue dans l’établissement. Ils ont insisté, toutefois, sur le fait que des consignes étaient systématiquement données depuis novembre 1994 aux étudiants du laboratoire, lors de leur entrée à l’ESPCI, au moyen d’une notice d’utilisation du réseau, dont le message – non daté – était produit aux débats par Françoise V. et qui leur indiquait que l’usage des » ressources informatiques était exclusivement réservé à l’activité professionnelle de recherche et d’enseignement « , leur mot de passe garantissant la sécurité du système qui, par ailleurs, ne devait pas être encombré par des programmes inutiles.
Questionnés à ce sujet, les mis en examen ont déclaré qu’ils n’étaient intervenus dans la messagerie de la partie civile que pour préserver la sécurité du réseau, celle-ci en abusant visiblement, à des fins privées, et pouvant le mettre en danger par des actions pirates effectuées à partir de son ordinateur personnel. Marc F. a admis néanmoins que la manipulation informatique, à laquelle il avait dû procéder lors de son intervention visant à débloquer le système, avait finalement consisté à déplacer des fichiers, et non à supprimer des messages, et que sa prise de connaissance de la lettre intitulée » International crime claimed in famed ivory tower french research lab » n’était pas liée à cette mesure de déblocage, même si elle avait eu lieu à cette occasion.
La partie civile a maintenu les termes de sa plainte, en soulignant, d’une part, que ses messages privés, enregistrés sur disque dur, et notamment envoyé le 23 janvier 1997 par Anne-Laura Smale et ayant donné lieu à la fermeture de son compte informatique, avaient été lus et que, d’autre part, il n’avait jamais eu connaissance de consignes d’utiliser à des fins personnelles l’ordinateur qui lui était attribué, chaque étudiant s’en servant pour faire sa correspondance privée.
Entendus à leur tour à propos des instructions données sur ce oint, les élèves se trouvant actuellement à l’ESPCI ont indiqué qu’ils étaient désormais informés du caractère strictement professionnel de l’utilisation des ordinateurs mis à leur disposition et de l’existence de procédure de contrôle de leur utilisation du réseau informatique, y compris de celui de la messagerie électronique.
Les travaux informatiques réalisés par Tareg Al B. et sauvegardés par la direction du laboratoire PMMH lui ont été restitués par ordonnance du 5 mai 1998.
Lors de l’audience, les prévenus ont soutenu, à l’appui de leurs conclusions tendant à leur relaxe, qu’à supposer l’élément légal de l’infraction de violation du secret de correspondances par personne dépositaire de l’autorité publique constitué, ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de ce délit n’étaient, en l’espèce, caractérisés.
Prétendant que les messages e-mails ne pouvaient bénéficier des règles de confidentialité qui s’attachent à une correspondance postale, puisque ces courriers, non cryptés, sont confiés à des serveurs intermédiaires qui les véhiculent à découvert avant de les acheminer vers leur destinataire et qu’ils doivent pouvoir être contrôlés à leur arrivée sur un réseau, compte tenu des dommages qu’ils sont susceptibles d’y causer, ils ont fait valoir qu’ils n’avaient pas agi de mauvaise foi, leur seul souci étant d’assurer la sécurité du réseau informatique du laboratoire PMMH et son utilisation conforme à la charte Renater.
Marc F. a relevé, en outre, que le seul message dont il avait pris connaissance, soit la lettre intitulée » International crime claimed in famed ivory tower french research lab « , avait été publié sur le Net quelques jours après son intervention et diffusé à 2 000 personnes, ce qui leur enlevait tout caractère de confidentialité.
Discussion
L’article 432-9 du code pénal incrimine le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances et étend cette incrimination, en son alinéa 2, au fait, pour une personne visée ci-dessus ou un agent d’un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d’un fournisseur de services de télécommunications, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, dans les mêmes conditions, l’interception ou le détournement de correspondances émises, transmises, ou reçues par la voie des télécommunications, ou l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.
La commission de cette infraction suppose, outre l’élément légal, la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
Sur l’élément matériel
L’élément matériel est caractérisé au regard de la qualité de l’auteur de l’infraction, de l’objet de l’infraction, ou de la nature de l’objet protégé, et des actes délictueux incriminés.
La personne désignée par le texte susvisé doit, d’une part, être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et, d’autre part, avoir agi dans l’exercice de ses fonctions.
La personne dépositaire de l’autorité publique est celle qui est titulaire d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et les choses dont elle use dans l’exercice des fonctions desquelles elle est investie par délégation de la puissance publique, tandis que la personne chargée d’une mission de service public est celle qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement découlant de l’autorité publique, est chargée d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général.
En l’espèce, Hans H., chercheur au CNRS et directeur du laboratoire PMMH, Françoise V., ingénieur d’études au CNRS et administrateur du système informatique du même laboratoire, et Marc F., fonctionnaire de la Ville de Paris et maître de conférences audit laboratoire, oeuvrent tous trois au sein de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle, laquelle est placée sous la double tutelle du CNRS et de la Ville de Paris.
Ce faisant, ils sont indéniablement chargés d’une mission de service public d’enseignement dans l’intérêt de la collectivité, ce que, d’ailleurs, ils ne contestent pas.
De même, il apparaît que les reproches qui leur sont faits concernent des actes qu’ils ont accomplis dans l’exercice de cette mission, puisqu’il leur est fait grief d’avoir mis à profit leur maîtrise du réseau informatique du laboratoire PMMH pour procéder à des investigations dans la messagerie électronique de Tareg Al B., en commettant ainsi un abus de pouvoir.
Dès lors, les dispositions de l’article 432-9 du code pénal leur sont applicables.
L’objet de l’infraction visée aux termes de ce texte est constitué, soit de correspondances écrites, soit de celles échangées par voie de télécommunications.
En l’espèce, il résulte, à l’évidence, de l’information et des débats que, bien que la présente poursuite soit fondée sur les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 432-9 du code pénal, les messages incriminés par la partie civile doivent être analysés comme étant susceptibles d’être des correspondances échangées par voie de télécommunications, dont la violation est prévue et réprimée par l’alinéa 2 du même texte.
En effet, on entend par télécommunication » toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radio électricité ou autre système électromagnétique « , conformément à la définition qu’en donne l’article L. 32 du code des postes et télécommunications.
Cette énumération inclut toutes les communications à distance actuellement connues, qu’il s’agisse des communications téléphoniques, ou de celles effectuées par minitel, par télécopie et par satellite réseau Internet.
Le réseau mondial du Net et l’intégralité des services qu’il offre, comme celui de la messagerie électronique, entrent donc dans le champ d’application de la législation relative aux télécommunications.
Il apparaît, par ailleurs, que le terme » correspondance » désigne toute relation par écrit existant entre deux personnes identifiables, qu’il s’agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou ouverts.
Cette relation est protégée par la loi, dès lors que le contenu qu’elle véhicule est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à disposition du public.
Le secret en est aménagé suivant les dispositions figurant dans le code pénal sous ses articles 226-13 et 432-9, lesquels reprennent, pour ce qui concerne les télécommunications, la règle posée aux termes du premier alinéa de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1991, qui édicte que » le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est garanti par la loi « .
Ces dispositions consacrent, en droit interne, le principe que rappelle l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel la correspondance est un attribut de la vie privée qui justifie la protection légale dont elle est l’objet.
En l’espèce, il convient de déterminer si la messagerie de Tareg Al B. se trouvait protégée par le secret de la correspondance.
Il est nécessaire de rappeler, à ce sujet, que la messagerie électronique permet de transmettre un message écrit d’une personne à une autre, de manière analogue au courrier.
Chacune des personnes désireuses d’effectuer une transmission doit, à cette fin, posséder une adresse électronique dont les deux composantes – son nom et celui de l’entité à laquelle elle est rattachée – définissent son identité informatique qui est unique. A partir de là, l’une d’elles peut adresser à l’autre tout message qu’elle souhaite lui faire parvenir, son correspondant consultant alors sa boîte à lettres – dont l’accès peut être protégé par un mot de passe – afin d’y lire les communications qui y ont été envoyées et s’y trouvent en attente.
Le message ainsi transmis revêt les caractéristiques suivantes :
il est exclusivement destiné à une personne physique ou morale,
il s’adresse à une personne individualisée, si son adresse est nominative, ou déterminée, si son adresse est fonctionnelle, le destinataire final du message n’étant pas précisé en ce cas, mais son récepteur ayant qualité pour recevoir ledit message,
il est personnalisé en ce qu’il établit une relation entre l’expéditeur et le récepteur, laquelle fait référence à l’existence d’un lien les unissant qui peut être familial, amical, professionnel, associatif, etc.
Il en résulte que l’envoi de message électronique de personne à personne constitue de la correspondance privée.
Il convient donc de considérer que la messagerie électronique de la partie civile, à laquelle il n’était, en l’occurrence, possible d’accéder qu’en utilisant son mot de passe, était protégée par le secret de la correspondance émise par voie de télécommunications, dont la violation tombe sous le coup de la loi pénale.
Il importe peu, à cet égard, que l’un des messages dont Tareg Al B. a été destinataire ait été ultérieurement publié dans la presse ou diffusé sur Internet, dès lors qu’il lui avait été, au préalable, adressé personnellement, le caractère privé, et donc confidentiel, de cette correspondance résultant de la nature même de cet envoi.
Les actes délictueux incriminés par l’article 432-9 alinéa 2 du code pénal consiste à intercepter ou détourner des correspondances émises, transmises, ou reçues par la voie des télécommunications ou encore à utiliser ou divulguer des communications interceptées ou détournées par autrui. Le mode opératoire tient au fait de commettre, d’ordonner ou de faciliter ces actes.
En l’espèce, il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, que Françoise V. et Marc F. ont intercepté – c’est-à-dire pris connaissance par surprise – certains des messages personnels adressés à Tareg Al B. et contenus dans sa messagerie électronique.
Françoise V. a reconnu avoir, pendant quelques jours, surveillé, en l’ouvrant, le courrier informatique de la partie civile, afin, d’une part, de recenser les messages ayant trait à sa vie privée par rapport aux messages à caractère professionnel et, d’autrepart,de rechercher la fausse lettre adressée au nom d’Anne T.. Elle a également admis avoir, de concert avec Marc F.,archivéletexte adressé à Tareg Al B., intitulé » International crime claimed in famed ivory tower french research lab « , ce qui implique que tous deux aient, au préalable, intercepté ce message.
Marc F. a également reconnu avoir intercepté ce courrier, alors que, cherchant à débloquer le système informatique du laboratoire PMMH, non sans se souvenir des difficultés ayant récemment opposé la partie civile à Anne T., il avait contrôlé les messages adressés ou émis par les étudiants de l’établissement se trouvant encore dans la zone » tampon » et avait pris connaissance dudit document.
Enfin, Hans H. n’a pas dénié avoir donné à ses deux collaborateurs des ordres précis tendant à l’interception des courriers destinés à Tareg Al B..
Il apparaît, en conséquence, que l’élément matériel de l’infraction de violation de correspondances par voie de télécommunications par personnes chargées d’une mission de service public et agissant dans l’exercice de leurs fonctions reprochée aux trois prévenus, est constituée.
L’élément intentionnel
L’élément intentionnel s’entend, au sens de l’article 432-9 du code pénal, de la volonté des auteurs de l’infraction de commettre les actes délictueux qui y participent, lesquels sont l’interception ou le détournement de correspondances par voie de télécommunications, ou encore l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.
Cette volonté est manifestée par le comportement de l’auteur du délit qui, ayant connaissance de ce que la correspondance litigieuse ne lui est pas destinée, s’en empare, ou s’informe de son contenu à l’insu de son destinataire.
Si la mauvaise foi n’est pas expressément requise ici, contrairement à ce qui est exigé par la loi pour ce qui est de l’infraction prévue et définie à l’article 226-15 du code pénal qui concerne les mêmes faits délictueux commis par des particuliers, il demeure que l’intention délictueuse de l’auteur ne peut être retenue que dans la mesure où elle s’est clairement exprimée au travers de ses actes.
Enfin, l’intention coupable est indépendante des mobiles auxquels l’auteur prétendrait avoir obéi.
En l’espèce, Françoise V., Marc F. et Hans H. ont manifesté sans équivoque leur volonté, pour les deux premiers, de prendre connaissance par surprise des correspondances contenues dans la messagerie électronique de Tareg Al B. et, pour le troisième, d’ordonner les investigations auxquelles se sont livrés ses collaborateurs.
Ils savaient incontestablement que les courriers qui se trouvaient dans la boîte à lettres de la partie civile ne leur étaient pas destinés, puisque, soit ils avaient été adressés par celle-ci à des tiers connus d’elle, soit ils lui avaient été envoyés par des personnes de son entourage, comme c’est le cas du message émanant d’Anne-Laura Smale intitulé » International crime claimed in famed ivory tower french research lab « .
Les prévenus invoquent, au soutien de leur absence d’intention coupable, le fait que le comportement de Tareg Al B., lequel utilisait abusivement, à des fins privées, la messagerie dont il disposait, au mépris des obligations mises à charges par la charte Renater – d’où il résulte que les utilisateurs du réseau s’obligent à un usage strictement professionnel – constituait un cas de force majeure qui légitimait leur intervention dans la messagerie de l’intéressé, dans la mesure où son utilisation abusive du réseau du laboratoire PMMH mettait en cause la sécurité de son système informatique.
Outre que ces circonstances ne constituent pas les cas légaux prévus au texte de l’article 432-9 du code pénal, qui concernent les interceptions faites pour les nécessités d’une bonne administration de la justice, ou celles dites de sécurité, ou encore celles tombant sous le coup de dispositions légales particulières (postales, douanières ou en rapport avec le fonctionnement des établissements pénitentiaires, …), le tribunal relève, à cet égard, que :
la charte Renater, à laquelle a adhéré le laboratoire PMMH, si elle prévoit que les utilisateurs du réseau qu’elle met à leur disposition doivent en faire un usage strictement professionnel, précise également que la consultation des fichiers (lesquels ne peuvent, par nature, être considérés comme confidentiels, contrairement à la correspondance) d’un utilisateur par un autre doit être autorisée par le propriétaire de ces fichiers et que, de même, les administrateurs système ne peuvent, sauf exception tenant à la sécurité du réseau, intervenir dans ces fichiers sans l’autorisation de leur propriétaire. En outre, il y est mentionné que ces administrateurs s’interdisent, pour des raisons déontologiques, d’intervenir dans les messageries des étudiants.
Il n’est pas établi que ces règles d’utilisation strictement professionnelle, dont Françoise V. prétend qu’elle les a fait connaître aux utilisateurs du réseau dès novembre 1994 et en veut pour preuve les notes personnelles qui figurent sur son agenda de cette année-là, ont été portées à la connaissance de Tareg Al B. au moment de son entrée à l’ESPCI. La partie civile dénie avoir reçu ces instructions et les investigations effectuées sur commission rogatoire, en 1998, auprès des étudiants du laboratoire alors présents ne sont pas concluantes sur ce point, puisqu’elles portent sur une période postérieure à celle des faits.
L’application de ce principe d’usage exclusif ne peut, en tout état de cause, justifier le fait que les administrateurs système du laboratoire et son directeur aient pris connaissance, à son insu, du courrier électronique de la partie civile, au motif qu’elle y contrevenait, fût-ce dans des proportions importantes, alors qu’il eut été aisé de lui rappeler les règles d’utilisation du réseau, en l’invitant à s’y conformer.
Contrairement à ce qu’affirment les prévenus, la sécurité du système informatique du laboratoire PMMH n’était pas mise en cause lors de leur intervention dans la messagerie électronique de Tareg Al B., courant janvier 1997. Il n’existait, à cette époque précise, aucun piratage du réseau, comme cela avait été le cas en septembre 1996, au moment de la disparition des fichiers appartenant à Anne T.. Par ailleurs, le fait que la partie civile ait été éventuellement à l’origine de l’envoi à la Physical Review d’une lettre apocryphe ne mettait nullement en danger le système, même si cette grave circonstance pouvait inquiéter la direction de l’établissement, cet incident étant sans rapport avec la sécurité du réseau. Celle-ci, enfin, n’était pas davantage en question lorsque Marc F. avait été amené à débloquer le système du laboratoire, aux alentours du 23 janvier 1997, puisque le seul déplacement de certains fichiers avait permis, selon son propre aveu, le retour au fonctionnement du réseau, sans qu’il soit nécessaire d’intervenir sur les messageries des étudiants et que le prévenu pouvait, d’ailleurs, assurer la surveillance du volume et de la destination du courrier de la partie civile par le seul contrôle du répertoire de la messagerie, sans y pénétrer.
Le souci de la sécurité du système informatique du laboratoire PMMH que Françoise V., Marc F. et Hans H. invoquent pour légitimer les interceptions qu’ils ont commises ou ordonnées n’est donc pas à l’origine de celles-ci et ne saurait les excuser.
Il apparaît, au contraire, que le mobile ayant inspiré leurs actes tient à la recherche de la lettre écrite et signée en lieu et place d’Anne T., ainsi que Françoise V. l’a admis au cours de l’information, et, au-delà, à la volonté de limiter les conséquences que l’antagonisme existant entre la jeune femme et la partie civile était susceptible d’engendrer pour l’établissement.
Les prévenus doivent, au vu de l’ensemble de ces éléments, être déclarés coupables des faits qui leur son reprochés.
Il y a lieu, toutefois, de leur faire une application bienveillante de la loi pénale, eu égard au fait que les actes délictueux retenus à leur encontre ont été commis dans le contexte particulier d’un laboratoire de recherche scientifique de haut niveau dont la vie a été perturbée par des conflits de personnes, compliqués de certains phénomènes de fraude, auxquels les responsables de cette unité ont tenté maladroitement de trouver une solution.
Il convient, dès lors, de condamner Hans H. et Françoise V., dont les agissements sont d’une gravité similaire, à une peine d’amende de 10 000 F, et Marc F., dont la participation aux faits délictueux est moindre, à une peine d’amende de 5 000 F.
Sur l’action civile
Il apparaît que le préjudice de la partie civile, qui tient aux conséquences de la violation de sa correspondance électronique, est exclusivement moral, contrairement à ce qu’elle soutient. Celui-ci sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 F.
En outre, les prévenus seront condamnés à lui verser la somme de 15 000 F en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’encontre de Françoise V., Marc F., Hans H., prévenus, à l’égard de Tareg Al B., partie civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
. requalifie le délit de violation de correspondances par personne chargée d’une mission de service public reproché à Hans H., Françoise V. et Marc F., en délit de violation de correspondances effectuée par voie de télécommunications par personne chargée d’une mission de service public prévu et puni par l’article 432-9 alinéa 2 du code pénal ;
. les en déclare coupable, le premier pour avoir ordonné l’interception de messages se trouvant dans la messagerie électronique de Tareg Al B., et les second et troisième pour avoir commis lesdites interceptions ;
. condamne Hans H. à payer une amende de 10 000 F, Françoise V. à payer une amende de 10 000 F et Marc F. à payer une amende de 5 000F ;
. reçoit Tareg Al B. en sa constitution de partie civile ;
. condamne solidairement Hans H., Françoise V. et Marc F. à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;
. les condamne chacun à lui verser une indemnité de 5 000 F sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 600 F dont est redevable chaque prévenu.
Le tribunal :
– à l’audience du 28 septembre 2000 : Mme Edith Dubreuil (vice-président), Mmes Isabelle Pulver et Anne Depardon (juges), Mme Béatrice Angelelli (substitut du procureur de la République) ;
– à l’audience du 2 novembre 2000 : Mme Edith Dubreuil (vice-président), Mmes Isabelle Pulver et Anne Depardon (juges), M. Michel Lernout (premier substitut du procureur de la République).
Avocats : Mes Iweins, Normand-Bodard et Marianne Fleury.
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Iweins est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Maître Marianne Fleury est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Maître Normand Bodard est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Anne Depardon est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Béatrice Angelelli est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Isabelle Pulver est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Michel Lernout est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.