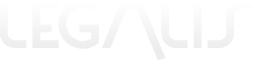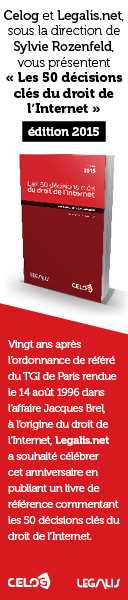Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Presse-civile Jugement du 06 juillet 2005
Cdca et autres / Editions Robert Laffont, Encyclopédies Quid
contenus illicites
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en date du 27 mai 2003 que les associations :
1) Comité de défense de la cause arménienne (Cdca),
2) Comité de coordination des organisations arméniennes de France,
3) Mémoire 2000,
4) « J’accuse » – Action internationale pour la justice (Aipj)
5) Union des étudiants juifs de France (Uejf)
ont fait délivrer à la société Les Editions Robert Laffont et à la société des Encyclopédies Quid, pour voir dire et juger, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que les sociétés défenderesses auraient commis une faute en ayant diffusé en 2002 et 2003 une édition du Quid présentant au sujet de la question arménienne « des thèses et propos négationnistes tendant à remettre en question la reconnaissance par la France et le Parlement de Strasbourg de la réalité du génocide arménien de 1915 et, à tout le moins, [en présentant] cet événement comme une interprétation « arménienne » de l’histoire de ce pays, en contestant le nombre de victime qui en est résulté et [en mettant] sur le même plan « la position arménienne » et « la position turque » sur la question et sollicitant, en conséquence :
– leur condamnation à payer à chacune d’elles un euro à titre de dommages-intérêts,
– la suppression sous une astreinte de 1000 € par infraction constatée de plusieurs passages incriminés – qui seront précisés dans la suite de la décision,
– la suppression des mêmes passages de l’édition en ligne, sous une astreinte de 1500 € par jour de retard,
– l’insertion dans la plus prochaine édition du Quid d’un paragraphe « faisant état de la prochaine décision à intervenir, et figurant dans la notice chronologique et historique de 20ème siècle, dans les termes suivants : « La question arménienne est aujourd’hui réglée par la reconnaissance du génocide de 1915 par les historiens et par le vote de la loi susvisée. Néanmoins, la Turquie continue de nier sa responsabilité dans le génocide arménien »,
– l’insertion, aux frais des sociétés défenderesses, d’un communiqué judiciaire sur un quart de page chacune des publications suivantes : Le Monde, le Figaro, Libération, Paris Match, L’Express et Marianne,
– outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du ncpc,
Vu les dernières conclusions des associations demanderesses qui maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales en les étendant aux nouvelles éditions parues au cours de l’instance, soit les éditions 2004 et 2005, et en portant l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du ncpc aux sommes de 2500 € pour l’association Mémoire 2000 (dernières conclusions de cette association en date du 3 novembre 2004) et pour le Cdca (ses dernières conclusions en date du 16 février 2005), 1500 € pour l’Uejf (ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2004) l’association Aipj ne sollicitant rien pour elle-même de ce chef (ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2004).
Vu les dernières conclusions de la société Les Editions Robert Laffont et de la société des Encyclopédies Quid en date du 13 avril 2005 :
– excipant de la nullité de l’assignation délivrée à la société Les Editions Robert Laffont au motif que la forme sociale et le capital de la société assignée n’y sont pas mentionnés,
– invoquant l’irrecevabilité des demandes, à l’exception de celles qui sont présentées par l’association Mémoire 2000, au motif que les statuts des associations demanderesses ne prévoient pas expressément leur capacité d’ester en justice,
– concluant, au fond, à l’absence de base légale de l’action engagée, laquelle n’aurait pu l’être, s’agissant d’une faute alléguée à raison de la publication d’un ouvrage, que sur le fondement ou, pour le moins, aux conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 qui permet seule de sanctionner les abus de la liberté d’expression,
– faisant valoir, subsidiairement, l’absence de faute au sens de l’article 1382 du code civil dans la présentation historiographique du génocide arménien, laquelle au demeurant, ne saurait, sans risque pour la liberté d’expression, être abandonnée à l’appréciation d’une juridiction,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 janvier 2005 faisant valoir au fond que le génocide arménien de 1915 n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 24 bis de la loi sur la presse, lequel ne vise que la contestation des crimes contre l’humanité commis pendant la seconde guerre mondiale, l’action engagée par les associations demanderesses sur le fondement de l’article 1382 du code civil est recevable, mais estimant, en l’espèce, qu’aucun manquement des sociétés défenderesses à leur devoir de prudence et d’objectivité n’est caractérisé et concluant, en conséquence, au débouté.
DISCUSSION
Le champ du litige
1) L’édition 2002 du Quid comporte, dans la partie « Etats » de l’encyclopédie, à l’entrée « Arménie », le passage suivant contesté par les associations demanderesses :
« Déportation des arméniens de l’Empire ottoman (à pied ou en chemin de fer) vers déserts de Syrie, d’Iraq ; meurent d’épuisement et de privations, d’épidémies, de massacres : selon certains arméniens : 1 200 000 à 1 500 000 morts ; selon d’autres : 40 à 50 % de la population arménienne de l’Empire ottoman ; selon les Turcs : 300 000 morts ; selon Jusem Mac Carthy (démographe américain) : 500 000 ; pour le « Tribunal permanent des peuples » [qui a siégé à la Sorbonne (Paris) du 13 au 16-4-1984] les arméniens ont été incontestablement victimes d’un génocide ».
Le paragraphe se poursuit par ces autres indications, non visées par les associations demanderesses :
« 27-5 loi turque favorisant l’extermination -1-6 le gouvernement ottoman ordonne le transfert des arméniens d’Anatolie centrale et orientale vers la Syrie. Ceux d’Istanbul et d’Izmir en sont exclus- juin/oct. Résistance arménienne à Chabine-Karahissar, Mussadagh, Karahussar (djebel Moussa), Ourfa »
Ce texte qui demeurera inchangé dans les éditions 2003 et 2004 sera modifié dans l’édition 2005 pour devenir :
« Déportation des arméniens de l’Empire ottoman (à pied ou en chemin de fer) vers déserts de Syrie, d’Iraq ; meurent d’épuisement et de privations, d’épidémies, de massacres : évaluation du nombre de victimes : en unités 1 000 000 à 1 200 000, en % de la population arménienne de l’Empire ottoman : 40 à 50. Voir la position officielle turque qui refuse le terme de « génocide » utilisé couramment et reconnu par plusieurs instances nationales et internationales ».
2) L’entrée « Turquie » comporte, dans l’édition 2002 du Quid, le passage suivant relatif à la première guerre mondiale [le passage contesté est figuré en caractère gras dans la présente décision] :
« 1914-1918 : 1ère guerre modiale-20-10 Russie déclare guerre à T.-31-10 entre en guerre. Anglais prennent Bassorah-23-11 T. appelle au djihad (guerre sainte) contre Triple-entente. 1915-18-3 Cannakkale : défaite navale anglo-française. 25-4 Anglais et français débarquent à Gallipoli, port des Dardanelles, mais doivent évacuer en août devant résistance turque dirigée par Mustapha Kemal (214 000 britanniques et 27 000 français hors de combat). Australo-néozélandais débarquent près de Canakkale (bataille de Gallipoli). Massacres et transfert d’arméniens vers les provinces méridionales de l’Empire ottoman (collaborent avec la Russie) (voie encadré p1281).-18-5 France, G.-B. et Russie font savoir qu’elles tiendront personnellement responsables des crimes de la T. (contre l’humanité et la civilisation) tous les membres du gouvernement ottoman et ceux de ses agents impliqués dans de pareils massacres.21-8 Italie déclare guerre à T. 1917-15-12 armistice avec Russie. 1918-3-3 traité de Brest-Litivsk rétablit frontière de 1876 » ;
Dans les éditions 2003, 2004 et 2005, le passage visé par les associations demanderesses sera ainsi rédigé :
« Transferts d’arméniens vers les provinces méridionales de l’Empire ottoman (collaborent avec la Russie), nombreux décès (épidémie, maladie) pendant le voyage (voir encadré p 1305).
L’encadré auquel il est fait référence dans l’une et l’autre version renvoie au passage ci-dessous.
3) Un encart sur fond rose est inséré dans les pages relatives à l’entrée « Turquie » sous le titre « Quelques problèmes ». Sous le sous-titre « Arménie. Position turque sur le problème arménien » figure, dans l’édition 2002, le passage suivant contesté par les associations demanderesses :
« Le 24-4-1915 plusieurs centaines d’arméniens, intellectuels, journalistes, membres des professions libérales, hommes d’affaires, membres du clergé sont arrêtés. Beaucoup seront fusillés. Pillages et massacres de la population locale dus à des attaques d’arméniens par des militaires (sous payés et sous alimentés) ou des irréguliers s’ensuivirent. Le gouv. ottoman décida le 27-5-1915 de transférer les arméniens vers le sud, ce qui, pour une population d’environ 1 300 00 personnes causa la mort de 300 000 d’entre eux, massacrés ou morts de faim, de froid, de maladie, 700 000 arméniens quitteront la T., 180 000 y resteront. Position arménienne, voir Arménie p.1989 c.
Accusation génocide.1945 la notion de génocide apparaît dans l’acte d’accusation de Nuremberg ; définie 1948-9-12 par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, elle est adoptée à l’unanimité de l’Ass générale de l’Onu et ratifiée par la Turquie. 1984 avril génocide arménien reconnu par le Tribunal permanent des peuples, qui a succédé au tribunal Bertrand Russel. 1985-29-8 rapport Onu, présenté par sous commission des droits de l’homme. 1987 juin, Parlement européen adopte une résolution dans le même sens. 1998-29-5 France Ass. nationale : 1er vote unanime. 2000-26-10 Sénat Adrien Gouteyron (sénateur et secr. général du RPR) dépose un texte. 8-11 sénat : 164 voix pour, 40 contres et 4 abstentions. 2001-18-1 assemblée nationale adopte définitivement cette loi (article unique) : « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915″ 29.1 promulguée. La contestation du génocide arménien ne pourra être sanctionnée en France, la loi Gayssot de 1990 qui punit la négation des crimes contre l’humanité, ne s’appliquant qu’aux faits commis pendant la seconde guerre mondiale ».
Ce texte demeurera inchangé à l’exception de la mention « 1987 juin Parlement européen adopte une résolution dans le même sens » qui deviendra dans les éditions 2003, 2004 et 2005 : « 1987 juin Parlement européen discute du sujet ».
En outre, dans l’édition 2005, le sous-titre de la rubrique sera modifié et deviendra « Arménie. Voir Arménie p.1123. Position officielle truque sur les événements touchant les arméniens ». La rubrique sera en outre complétée par une référence faite à la délibération, « prise à l’unanimité », par le conseil de Paris de faire ériger un monument à la mémoire des « A. [pour arméniens selon la typographie adoptée par le Quid s’agissant des pays ou des nationalités] massacrés en 1915 à 1917 ».
Sur les exceptions de procédure
1 – C’est à tort que la société Les Editions Robert Laffont invoque la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée au motif que n’y seraient mentionnés ni sa forme sociale, ni le montant de son capital, ni encore son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, alors que de telles mentions ne sont exigées par l’article 648 du ncpc que des personnes morales requérantes et non de celles qui sont assignées, ces dernières n’ayant à être identifiées que par leur dénomination et leur siège social, précisions qui sont portées dans l’assignation.
2 – Les sociétés défenderesses soutiennent également dans la partie de leurs conclusions qui s’intitule « sur le défaut d’intérêt à ester en justice des associations demanderesses » que quatre des cinq associations en cause ne justifieraient pas de leur capacité à agir en justice, laquelle ne serait pas formellement prévue dans leurs statuts.
Ce moyen est inopérant dès lors que la capacité d’une association à agir en justice résulte de la personnalité morale qu’elle tient de la loi, et précisément des articles 2, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 qui disposent que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs et que toute association régulièrement déclarée pourra, sans autorisation spéciale, ester en justice. Chacune des associations en cause justifiant de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 5 de cette loi, à savoir la déclaration en préfecture et l’insertion au journal officiel rendant son existence publique, ce moyen sera rejeté.
3 – Enfin, bien qu’aucune fin de non recevoir ne soit explicitement opposée aux associations demanderesses tiré du défaut d’intérêt à agir -qui est cependant allusivement évoqué par les sociétés en défense- il revient au tribunal, dans un litige de cette nature, de s’assurer, pour chacune d’entre elles, en application de l’article 125, alinéa 2, du ncpc, de cette condition de recevabilité de l’action.
Il sera rappelé qu’une association est recevable à engager une action civile destinée à assurer la défense des intérêts collectifs de ses membres si elle justifie qu’une telle action relève de son objet statutaire.
Les statuts du comité de la défense de la cause arménienne disposent que l’objet de l’association est « de maintenir la spécificité arménienne culturelle et historique et d’obtenir d’une part la reconnaissance « de jure » par les instances internationales du génocide perpétré contre la nation arménienne en 1915 et, d’autre part, la reconnaissance officielle par le gouvernement turc des responsabilités engagées dans ledit génocide par l’Etat turc et, par là même d’aboutir à la réparation des préjudices moraux et matériels qui en découlent ».
La référence faite par ses statuts, à la fois, à la « spécificité arménienne », notamment « historique », à l’objectif d’une reconnaissance du génocide arménien tant au niveau international que par l’Etat turc et au souci de réparation des « préjudices moraux » en résultant confère à cette association intérêt à agir à raison de la présentation qu’elle estime fautive, et contraire aux objectifs qu’elle assigne, faite par le Quid du génocide arménien de 1915.
Le conseil de coordination des organisations arméniennes de France (Ccaf) a notamment pour objet statutaire de « soutenir le combat contre le négationnisme et le révisionnisme par la prévention de tous les crimes contre l’humanité », « de soutenir les actions menées pour la reconnaissance par la Turquie du génocide arménien et des conséquences qui en découlent » et « de coordonner les actions des organisations arméniennes de France lorsque les intérêts de la communauté arménienne de France ou bien ceux du peuple arménien sont concernés ». Un tel objectif statutaire justifie l’intérêt à agir du Ccaf dans le cadre de la présente instance.
L’association mémoire 2000 a notamment pour objet « d’entretenir auprès de la génération qui atteindra sa 20ème année en l’an 2000 et au-delà, la mémoire des crimes contre l’humanité et des atteintes aux droits de l’homme provoquées par le racisme et l’antisémitisme en Europe dans les années 40 et d’une façon générale la discrimination et la haine entre individus et les groupes de personnes à raison de leur origine aussi bien en France, en Europe, en Afrique, dans les pays du Maghreb, au Moyen Orient que dans le reste du monde » et » d’être vigilant à toute atteinte aux droits de l’homme et en particulier à toute manifestation et résurgence du négationnisme de manière à être en mesure de les dénoncer et de réagir rapidement et efficacement par tous moyens appropriés ». La référence faite, au-delà des « crimes contre l’humanité » qui ne concernent que les crimes commis « dans les années 40 » – et ne saurait donc inclure le génocide des arméniens de 1915 – à la « discrimination et la haine entre individus et les groupes à raison de leur origine » – sans alors cantonner de telles manifestations à telle ou telle période de l’histoire – ainsi qu’en termes généraux, à la « vigilance à l’égard du négationnisme » sous toutes ses formes et sur tous les continents, établissent à suffisance l’intérêt à agir de cette association dans le cadre de la présente instance.
Il en est de même pour l’association « J’accuse » – action internationale pour la justice (Aijp) qui vise dans ses statuts le combat contre le « racisme, l’antisémitisme et le négationnisme sous toutes ses formes » et se propose, notamment « d’assister ou représenter les victimes de génocides et crimes contre l’humanité, de défendre leurs intérêts moraux, leur honneur et leur mémoire ».
Les statuts de l’Uejf précisent ainsi qu’il suit les buts de l’association :
– grouper les étudiants juifs de France dans les sections locales,
– coordonner les activités des sections,
– représenter les étudiants dans la vie universitaire et développer la connaissance de la culture juive auprès de l’ensemble des étudiants,
– promouvoir l’Alya et la centralité d’Israel dans le judaisme,
– développer l’action sociale,
– lutter contre l’antisémitisme et le racisme sous toutes ses formes et préserver la mémoire,
– mieux faire connaître la réalité sociale du judaisme français auprès de l’ensemble des citoyens de notre pays,
– permettre aux étudiants juifs de découvrir et d’observer les pratiques culturelles du judaïsme,
– défendre les intérêts moraux et patrimoniaux des étudiants,
– soutenir l’Etat d’Israël et promouvoir le sionisme.
Au regard des objectifs que cette association s’assigne – essentiellement centrés, outre la promotion du sionisme et la défense de l’Etat d’Israël, sur la vie étudiante en France, la culture juive en France, la connaissance du judaïsme par les français – les références faites à la lutte « contre l’antisémitisme et le racisme » et à « la mémoire » s’entendent comme ne visant, à la différence des objectifs beaucoup plus généraux des associations Mémoire 2000 et J’accuse, que le racisme et l’antisémitisme qui ont été ou sont à l’œuvre en France, et la seule mémoire du génocide des juifs.
Aussi, l’action engagée à raison de la présentation jugée fautive du génocide des arméniens de 1915 par l’encyclopédie Quid ne saurait-elle être regardée comme justifiée par la défense de l’intérêt collectif des membres de l’Uejf, tel qu’il ressort de l’objet statutaire de cette association.
Le fait que l’Uejf ait, par le passé, intenté, avec d’autres, une action en justice contre les mêmes éditeurs et à raison de la même publication, mais s’agissant alors d’un commentaire du Quid relatif au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, ne saurait davantage lui conférer intérêt à agir, au sens de l’article 31 du ncpc, cet intérêt ne pouvant s’apprécier qu’au regard de l’objet du litige, cette fois-ci étranger au crime contre l’humanité dont ont été victimes les juifs d’Europe, et parmi eux de nombreux juifs de France, au cours de la seconde guerre mondiale.
L’Uejf sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur l’application de l’article 1382 du code civil
Les sociétés éditrices récusent, en se prévalant des infléchissements jurisprudentiels des dernières années – tels qu’ils avaient pu être anticipés par le doyen Carbonnier dans sa chronique « Le silence et la gloire » relative à l’arrêt dit « Branly » – l’invocation de l’article 1382 du code civil au soutien d’une action dirigée contre un ouvrage et relevant, en tant que tel, de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, à laquelle il ne pourrait être dérogé, au regard des exigences de ce dernier texte, que dans les cas et aux conditions précisément définis par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il convient de relever, d’abord, qu’aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881, ni aucune autre disposition légale n’édictent au bénéfice des auteurs ou responsables de publications écrites, quelle qu’en soit la nature, de dérogation explicite aux principes généraux de la responsabilité civile et tout particulièrement au principe de la responsabilité délictuelle de l’article 1382.
Il sera souligné à cet égard que tel n’était pas – en tout cas lors de l’adoption de la loi de 1881 puis au début du siècle – l’intention du législateur comme en font foi les discussions parlementaires, notamment, sur l’article 34 de la loi sur la presse relatif aux atteintes à la mémoire des morts, ensuite modifié par la loi du 29 septembre 1919. Ainsi le rapporteur de la commission des lois de la Chambre des députés, en 1881, comme le Garde des sceaux lors de la modification de ce texte, en 1919, ont l’un et l’autre précisé, le premier , que « ce n’est, en effet, que la répression pénale que dénie le texte nouveau [aux héritiers vivants qui ne seraient pas personnellement visés par l’atteinte], ce n’est pas la réparation qui prend sa source dans la simple faute et le préjudice causé, abstraction faite de toute intention criminelle » (JO 1881, Annales de la Chambre des députés, T.II p.93), le second « qu’il allait sans dire [que ce texte] ne faisait pas obstacle à une action en dommages-intérêts ou à toute autre basée sur l’article 1382 du code civil ». De même, s’agissant de la diffamation publique envers les particuliers, le rapporteur du texte initial s’interrogeait devant la Chambre des députés en ces termes : « Nous nous sommes demandés si la diffamation telle qu’elle est définie par notre projet de loi doit encourir des peines correctionnelles, c’est-à-dire d’autres responsabilités que celles de l’article 1382 du code civil ». (JO 1881, ibid, p. 8304) confirmant ainsi, par la référence faite aux « autres responsabilités », l’intention initiale du législateur de faire coexister le nouveau corpus de délits spéciaux de presse avec les règles du droit commun de la responsabilité civile.
Les premières évolutions du droit toucheront à l’action ouverte aux victimes d’un délit de presse devant les juridictions civiles – hors certains cas particuliers précisément circonscrits par la loi de 1881 dans ses articles 30, 31 et 46. Elles ont conduit à étendre progressivement à l’action civile, en réparation des préjudices résultant d’un délit de presse l’ensemble des règles, aussi bien de procédure que de fond, que cette loi édictait, le procès fût-il conduit séparément de l’action publique devant la juridiction civile. Ainsi, il est désormais établi que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Les associations demanderesses soutiennent que le recours à l’article 1382 du code civil est cependant possible lorsque le préjudice résulte d’un fait qui n’est pas incriminé par la loi sur la presse. Tel serait le cas en l’espèce, dès lors que le préjudice invoqué résulte d’une présentation arguée fautive du génocide arménien qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la contestation de l’existence des seuls crimes contre l’humanité commis au cours de la seconde guerre mondiale.
Les sociétés défenderesses considèrent, quant à elles, que faute pour la loi sur la presse d’avoir étendu le délit de contestation des crimes contre l’humanité à d’autres crimes que ceux perpétrés durant la seconde guerre mondiale, le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme devrait seul prévaloir en sorte que, comme le suggérait le doyen Carbonnier, il conviendrait de considérer « que les lois sur la liberté de la presse […] avaient entendu instituer, pour toutes les manifestations de la pensée, un système juridique clos, se suffisant à lui-même, arbitrant une fois pour toutes tous les intérêts en présence, y compris les intérêts civils- et enlevant du même coup l’article 1382 une portion de sa compétence diffuse ».
S’agissant des intentions du législateur de jadis, il n’est pas sûr, comme cela a déjà été souligné, que celles qui lui ont été prêtées aient été aussi univoques qu’il a pu être soutenu.
S’agissant de la convention européenne des droits de l’homme dont il est souligné qu’elle pourrait contraindre à une telle évolution du droit interne, plusieurs observations s’imposent.
L’article 10 de la convention dispose que le droit à la liberté d’expression « comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques » et, dans son deuxième paragraphe, que l’exercice de ces libertés qui comporte « des devoirs et des responsabilités » peut être « soumis à certaines restrictions qui constituent des mesures nécessaires, notamment à la protection des droits d’autrui ». Sur le fondement de ce texte, la cour de Strasbourg s’assure de la nature des ingérences des autorités publiques dans l’exercice de cette liberté, de la prévisibilité des restrictions pouvant lui être apportées et de leur caractère nécessaire dans une société démocratique.
Il sera relevé à cet égard que, d’une part, le texte même de la convention fait référence aux « devoirs et responsabilités » qui s’attachent à l’exercice de la liberté d’expression et que, d’autre part, la Cour européenne apprécie différemment, pour juger du caractère proportionné des ingérences des autorités publiques -et en l’espèce celles du juge- l’instance pénale et l’instance civile.
Ainsi, s’agissant du caractère « nécessaire » de l’ingérence, la cour de Strasbourg a souligné, dans l’affaire Lehideux et Isorni c/ France (décision du 23 septembre 1998) « La gravité d’une condamnation pénale pour apologie des crimes ou délits de collaboration » qu’elle a jugée « disproportionnée et, dès lors, non nécessaire dans une société démocratique » « eu égard à l’existence d’autres moyens d’interventions et de réfutation, notamment par les voies de droit civil » (souligné par la présente décision) consacrant ainsi la distinction de nature, en l’espèce essentielle, entre les ingérences pouvant résulter d’une instance civile et celles que peut caractériser une instance pénale.
S’agissant, par ailleurs, de la prévisibilité de la loi, il ne saurait être sérieusement soutenu que l’article 1382 du code civil français, tel qu’il est éclairé par une jurisprudence bi-séculaire, manquerait, à cet égard, et en lui-même, aux exigences de la convention sans remettre alors en cause, tout à la fois, un des fondements les mieux établis du droit français, l’exigence de responsabilité que le texte européen attache à l’exercice de la liberté d’expression et les caractéristiques propres de la voie civile que la Cour européenne a mises en exergue dans sa décision Lehideux et Isorni c/ France.
En outre, il n’est pas sans intérêt de relever qu’en l’état actuel du droit, marqué par l’évolution récente de l’interprétation par la Cour de cassation des dispositions en cause, l’article 1382 du code civil ne peut plus être invoqué, non seulement lorsque le préjudice trouve sa cause dans un fait incriminé par la loi du 29 juillet 1881, mais encore lorsqu’il se rattache à un fait qui en relèverait par nature.
Ainsi il est jugé que le dénigrement des personnes vivantes ou celui des morts ne pouvait ouvrir un droit à réparation que dans les cas et aux conditions prévus par la loi sur la presse, la définition d’un comportement fautif qui trouve son siège dans cette loi épuisant toutes actions en réparation de faits qui, à défaut d’un élément constitutif, ne caractériseraient pas le délit incriminé, en sorte que le recours à l’article 1382 en matière de publication jugée fautive ne peut, en cet état du droit, trouver à s’appliquer qu’hors ces hypothèses et, dès lors, très résiduellement.
Or, le maintien de cette possibilité résiduelle s’impose en droit et parait essentiel en fait.
Il s’impose en droit, au regard des exigences constitutionnelles en matière de droit à réparation et de droit en recours effectif, lesquelles sont parfaitement conformes aux normes européennes, telles qu’interprétées par la cour de Strasbourg.
S’agissant des exigences constitutionnelles, dès sa décision DC du 22 octobre 1982 le Conseil constitutionnela relevé que si le législateur avait, « en certaines matières, institué des régimes de réparation dérogeant partiellement au principe que tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, notamment en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l’auteur du dommage la responsabilité ou la garantie d’une autre personne physique ou morale, le droit français ne comporte, en aucune matière, de régime soustrayant à toute réparation les dommages résultant de fautes civiles imputables à des personnes physiques ou morales de droit privé, quelle que soit la gravité de ces fautes » (souligné par la présente décision).
Le Haut conseil a, ensuite, dans sa décision DC 99-419 du 9 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité consacré le droit pour la victime d’une faute civile d’obtenir réparation de son préjudice comme une garantie fondamentale « mettant en œuvre l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » [« la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »].
Dès lors que ce droits et libertés, parmi lesquels figurent la liberté d’expression, consacrée par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mais aussi, désormais, le droit à réparation sont « constitutionnellement protégés » en ce qu’ils sont « nécessaires à la protection de principes de valeur constitutionnelle », il résulte de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (ainsi dans sa décision DC 2003-467 du 13 mars 2003 relative à la loi sur la sécurité intérieure) qu’il relève du législateur d’en assurer la conciliation sous le contrôle constitutionnel de son caractère non « manifestement déséquilibrée ».
Certes, le souci de la conciliation de ces objectifs contradictoires a-t-il pu conduite ces dernières années, et sans intervention législative nouvelle, à considérer que l’article 1382 du code civil ne pouvait pas être invoqué par les personnes se prévalant du préjudice résultant d’un dénigrement non constitutif d’une diffamation ou d’une injure, seules spécialement incriminées par la loi de 1881, ni par les héritiers arguant d’un préjudice personnel résultant d’une atteinte à la mémoire des morts exempte de toute intention de porter atteinte à leur honneur ou à leur considération propres – atteinte qu’en l’occurrence la loi sur la presse n’a pas entendu incriminer. Diverses analyses intrinsèques des textes en cause, éclairées par la jurisprudence européenne, et animées d’un légitime souci de précaution juridique au regard de conséquences qui pouvaient s’attacher à des solutions en sens opposé ont pu conduite à de telles solutions.
Ce même souci de conciliation ne saurait cependant, hors disposition législative expresse, priver de recours, dans le silence de la loi, ceux qui trouveraient à se plaindre sur le fondement de l’article 1382 du code civil d’une présentation mensongère, dénaturée, fallacieuse ou gravement négligente de faits historiquement établis dès lors qu’elle leur causerait un préjudice direct.
Une telle manière de voir n’est en rien contrariée par les standards européens en matière de liberté d’expression, dont l’article 10 de la Convention européenne précise qu’elle comporte des « devoirs et responsabilités ». Elle paraît en outre trouver une justification entière dans l’article 6 de la Convention qui dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » et à l’article 13 du même texte selon lequel « toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente convention aurait été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale ».
Or, à soutenir que dans le silence de la loi sur la presse, l’article 1382 du code civile ne saurait être invoqué par quiconque quelles que soient la nature, la portée et l’effet d’une publication, et nonobstant le préjudice direct susceptible d’en résulter, on prive les parties de tout recours effectif au juge en contravention avec les droits fondamentaux reconnus dans l’ordre interne et consacrés par la Convention européenne.
Il y a lieu de souligner en outre que le secours résiduel des dispositions de l’article 1382 du code civil et de la voie civile d’accès au juge, y compris dans certaines hypothèses mettant en cause des publications, est essentiel en fait.
A cet égard, le juge n’apparaît pas le mieux qualifié pour arbitrer et trancher des polémiques ou controverses liées à des événements qui relèvent de l’histoire, l’absence de recours judiciaire, dans le silence de la loi de 1881, aurait immanquablement pour effet d’abandonner les parties intéressées à leur propre désarroi ou à des campagnes d’opinion à la pédagogie dépourvue de nuance et aux résultats aléatoires alors que, du seul fait des règles qui président à son déroulement, une instance civile paraît propice à l’échange raisonné et contradictoire des arguments, dans des conditions d’égale publicité pour les parties, dont aucune n’est, ensuite, privée de recours, sous l’arbitrage de la Cour de cassation.
L’emprunt de la voie civile par le truchement de l’article 1382 du code civil ne signifie nullement que la faute serait, pour les plaideurs -lesquels doivent préalablement justifier de leur intérêt à agir et donc d’un préjudice direct- aisée à caractériser dans une matière qui est toute entière placée sous le signe de la liberté d’expression et de communication des idées et qui conduit nécessairement à ce que la faute à caractériser soit au contraire appréciée restrictivement, notamment, au regard de la nature de la publication et du champ intellectuel dans lequel elle prend place, limitant l’engagement de la responsabilité aux seuls cas de manquements grossiers ou de fautes intentionnelles.
Enfin, tenir pour hermétiquement clos le champ des responsabilités édictées par la loi sur la presse dès lors qu’un fait n’y serait pas spécialement incriminé risquerait de conduire le législateur, au gré des émotions ou des revendications légitimes de tel ou tel secteur de l’opinion, à réexaminer, sinon compléter -comme une doctrine autorisée l’a déjà suggéré- la liste des infractions de presse, incitant en définitive à une pénalisation des comportements sociaux souvent déplorée, ou en consacrant, pour le moins, le tropisme pour le procès pénal au détriment du règlement civil des litiges.
Pour l’ensemble de ces motifs, le fondement de l’action engagée par les associations demanderesses sera jugé pertinent.
Sur l’examen du caractère fautif de la présentation des faits se rapportant au génocide des Arméniens
Il convient de souligner, en premier lieu, que le litige dont est saisi le tribunal n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de soumettre à l’appréciation d’une juridiction l’existence d’un fait historique, en l’espèce l’extermination des arméniens par les autorités de l’Empire ottoman en 1915, ni la qualification de ce fait, sous le terme de génocide, très communément admise tant par la communauté des historiens, comme en témoignent les pièces versées aux débats, que par la communauté internationale qui a entendu le voir consacrer comme tel.
Il sera, en tout état de cause, relevé qu’il résulte des pièces versées aux débats :
– que le massacre des arméniens par les ottomans figure parmi les génocides du XXème siècle que la sous commission de l’ONU a recensé dans son étude sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide, adoptée le 29 août 1985,
– que le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 18 juin 1987, a reconnu la réalité du génocide arménien en ces termes : « L’extermination des populations arméniennes par la déportation et par le massacre constitue un crime imprescriptible de génocide au sens de la convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide » et considéré que le refus persistant de la Turquie de l’admettre constituait un obstacle à l’entrée de ce pays dans la Communauté européenne,
– que l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe a exposé, dans une déclaration écrite en date du 24 avril 1988 : « le 24 avril 1915 a marqué le début de l’exécution du plan visant à l’extermination des arméniens vivant dans l’empire ottoman,
– que la loi française du 29 janvier 2001 dispose que « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 » ;
Ce mouvement de reconnaissance internationale du génocide des arméniens par les ottomans avait été inauguré par le « Tribunal permanent des peuples », composé d’éminentes personnalités internationales, qui s’est réuni à Paris le 29 août 1984. Cette instance a considéré comme bien fondée l’accusation de génocide portée contre les autorisées turques en ces termes : « l’extermination des populations arméniennes par la déportation et par le massacre constitue un crime imprescriptible de génocide au sens de la convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide ».
Il sera enfin noté que dans un message adressé au « Tribunal permanent des peuples », et qui constitue désormais la préface de l’édition des actes de cette manifestation (« Le crime contre le silence/le génocide des arméniens », édition Champs Flammarion, déc. 1984) Pierre Vidal Naquet, soutient que « le discours turc de dénégation » s’est constitué « par étapes » comme « un sous produit de l’Etat Turc, unitaire et centralisé », faisant valoir que le sultan avait d’abord reconnu les crimes commis par les responsables de certains groupes, notamment, Union et progrès, en les ayant fait comparaître, en 1919, devant le tribunal militaire de Constantinople- lequel devait prononcer plusieurs condamnation à mort- avant que les autorités turques ne distinguent la déportation des arméniens, tenu pour légitime, des massacres, eux condamnés, pour finir par ne plus évoquer que la déportation, les massacres désormais tenus sous silence, état soustrait à l’histoire.
M. Vidal Naquet rappelait, à ce propos, les termes de la déposition de Mustapha Kemal, alors général, lors de son audition en qualité de témoin devant la cour militaire en 1919 :
« Nos compatriotes ont commis des crimes inouïs, eu recours à toutes les formes concevables de despotisme, organisé la déportation et le massacre, brûlé vifs des nourrissons arrosés de pétrole, violé des femmes, des jeunes filles… Ils ont mis les arméniens dans des conditions insupportables comme aucun peuple n’en a connu dans toute l’histoire » ;
Pas davantage le tribunal n’est-il sollicité de se faire l’arbitre d’une controverse qui opposerait des historiens entre eux, lesquels ont toute liberté pour exposer leurs vues personnelles sur les faits, les actes et les attitudes des hommes, des groupes ou des Etats ayant pris part ou qui ont été mêlés à tel événement relevant de l’histoire et dont il doit être nécessairement admis qu’ils puissent le faire avec subjectivité, sans tenir pour acquises les idées ou les interprétations établies, en ne soumettant essentiellement qu’au jugement de leurs lecteurs, de leurs homologues ou de la postérité le fruit de leurs recherches, leur interprétation d’une histoire revisitée serait-elle militante, partiale, contestable ou choquante.
L’ouvrage litigieux ne relève pas d’un tel registre.
Le Quid se présente, depuis sa première édition en 1963, comme une « encyclopédie » en un volume, tous les ans actualisée, ouvrage généraliste qui a pour slogan « tout sur tout et un peu plus que tout ».
Sa présentation commerciale, l’abondance et la précision de son contenu comme le caractère de sa typographie, laquelle recourt fréquemment à des abréviations ou au style télégraphique, confèrent au Quid le crédit de l’exactitude des informations publiées, et l’apparence de l’objectivité (« des faits, des dates, des chiffres » comme le proclame sa documentation publicitaire). Le commentaire superflu, comme le jugement de valeur, en paraît banni ; l’esprit militant ou polémique lui être étranger. Vendu à des centaines de milliers d’exemplaires (400 000 pour l’édition 2003), le Quid est un ouvrage de référence consulté à tout age, une sorte de vademecum consultable dans les bibliothèques de nombreuses familles et dans un grand nombre de centres de documentations des établissements d’enseignement.
Aussi, est-ce au regard des caractéristiques particulières de cette publication, que doivent s’apprécier les griefs qui lui sont faits, s’agissant de la présentation du génocide arménien.
C’est à tord que les associations demanderesses soutiennent à cet égard que le seul fait de présenter la « position turque » dans une rubrique figurant sous l’entrée « Turquie » consacrée « à quelques problèmes » serait fautive au motif que l’exposé du point de vue turc « [participe] du génocide lui-même qui engendre sa propre négation ».
En effet, le refus des autorités turques de reconnaître le génocide des arméniens est un fait, dont la connaissance est au demeurant utile à la compréhension d’événements ou de débats du temps, telle les conditions posées à l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. En outre, le Quid présente cette « position » en tant que telle, la faisant suivre d’un renvoi à la page de l’ouvrage consacrée à la « position arménienne » puis de développements sur « l’accusation de génocide » en sorte qu’aucune ambiguïté ne saurait, à la lecture de cette seule rubrique, et sous les réserves à venir, donner à penser au lecteur que cette version des faits aurait une valeur historique supérieure à celle que l’on accorde généralement au témoignage de qui souhaite se défaire d’une grave accusation.
En revanche, le tribunal relève que le fait de présenter, sous l’entrée « Arménie », et au titre de l’énumération de diverses estimations du nombre de victimes des massacres et déportations de 1915 (« selon certains arméniens : 1 200 000 à 1 500 000 morts ; selon d’autres : 40 à 50 % de la population arménienne de l’Empire ottomans ; selon les Turcs : 300 000 morts ; selon Jusem Mac Carthy (démographe américain) : 500 000) -en fin de liste, comme si celle-ci devait, faute d’autre ordre de présentation logique, prévaloir- l’estimation de Jusem Mac Carthy qui est présenté comme « démographe américain », précision qui lui confère naturellement, au regard des estimations attribuées à « certains arméniens » et « à certains turcs », sinon une qualité d’arbitre du moins une apparente neutralité, sans indiquer alors que ce professeur d’histoire, tenu pour négationniste, s’est fermement et publiquement opposé à la reconnaissance du génocide arménien par la sous commission des droits de l’homme de l’ONU, est hautement critiquable.
De même, l’absence dans la partie de l’ouvrage consacrée à l’histoire de l’Arménie de toute référence à la reconnaissance du génocide par les organisations internationales et par de nombreux Etats, et sans aucun renvoi à la rubrique qui permettrait au lecteur d’en être informé, constitue une grave négligence, le fait historique étant résumé par la seule indication que les arméniens déportés -et dont il est précisé qu’ils l’ont été « à pied ou en chemin de fer »- sont morts « d’épuisement et de privations, d’épidémies, de massacres », une telle présentation donnant à penser que l’aléa (faiblesse physique, disette générale en temps de guerre, maladies) y tient une part déterminante. Dans ces conditions, et venant après les divergences d’estimations du nombre de victimes, lequel se fixe sur le chiffre donné par un négationniste, l’indication selon laquelle « pour le Tribunal permanent des peuples […] les arméniens ont été incontestablement victimes d’un génocide », ne peut que conduire le lecteur à tenir cette phrase pour l’expression d’une opinion non étayée.
Il sera souligné en outre que ce passage (de dix lignes et demi dont cinq sont consacrées aux divergences d’appréciation du nombre de victimes) constitue la totalité de « la position arménienne » appelée à être lue -comme y invite le renvoi qui y est fait depuis les pages « Turquie »- en contrepoint de « La position turque sur le problème », laquelle est traitée avec précision et comporte de nombreux développements.
Enfin, c’est non sans pertinence que les associations demanderesses font valoir que le rapprochement de l’exposé de « la position turque » avec celui qui se présente comme étant le récit objectif de l’histoire turque par les auteurs de l’ouvrage révèle une saisissante parenté.
Ce dernier qui n’est pas la position prêtées à la Turquie mais celle des rédacteurs du Quid est rédigé comme suit :
« Transferts d’arméniens vers les provinces méridionales de l’Empire ottoman (collaborent avec la Russie), nombreux décès (épidémie, maladie) pendant le voyage (voir encadré p 1305). »
Une telle présentation, en laissant à penser que la collaboration avec l’ennemi russe était le seul mobile des « transferts d’arméniens », lesquels transferts sont présentés comme n’ayant concerné que des personnes accusées de trahison, en imputant les décès à des causes naturelles (« épidémie, maladie ») et en évoquant leur survenance « pendant le voyage » -une telle expression étant singulièrement inappropriée-, manque incontestablement à l’exigence de sérieux, de neutralité et d’objectivité dont se prévaut la publication en cause à l’égard de ses lecteurs. Ni le caractère nécessairement ramassé de l’exposé des faits, ni le renvoi du lecteur à une rubrique plus abondante- laquelle ne développe cependant que la seule « position turque » et « l’accusation de génocide » renvoyant le lecteur à une autre page pour être informé de « la position arménienne »- n’autorisaient une telle manière de faire.
Elle constitue, en réalité, comme le soulignent avec justesse les associations demanderesses, un résumé, non présenté comme tel, de la position turque sur le sujet, laquelle figure à la page suivante.
Au regard de tels manquements, le fait, souligné par les sociétés éditrices, que le Quid fasse, par ailleurs, état de la reconnaissance du génocide arménien n’est pas de nature à persuader le lecteur qu’une telle reconnaissance serait justifiée au regard des informations données.
Cette impression s’en trouve encore renforcée par l’indication, qui suit la référence faite à la loi française de reconnaissance du génocide arménien, aux termes de laquelle « la contestation du génocide arménien ne pourra être sanctionnée en France, la loi Gayssot de 1990 qui punit la négation des crimes contre l’humanité, ne s’appliquant qu’aux faits commis pendant la seconde guerre mondiale ». Sans constituer explicitement une invitation à contester les termes de la loi, une telle affirmation peut surprendre dans un ouvrage où le souci de donner le plus grand nombre d’informations possibles au lecteur contraint généralement à une présentation très ramassée, où chaque mot est compté et le style, quelquefois, télégraphique.
En définitive, les rédacteurs des rubriques en cause, s’ils n’occultent pas la reconnaissance par certaines organisations internationales ou par certains Etats du génocide arménien :
– croient devoir souligner que la qualification de génocide peut être impunément contesté en France,
– ne livrent aucun fait pouvant convaincre du bien fondé d’une telle reconnaissance,
– se référent, au contraire, parmi d’autres mais sans préciser la particularité d’une telle source d’information, à l’estimation grossièrement sous estimée du nombre de victimes faite par un ardent défenseur de la position turque, tenu pour négationniste,
– juxtaposent de manière particulièrement déséquilibrée la position turque sur le sujet, fort précise et développée, et la position arménienne, sommairement exposée,
– recourt, enfin, à un vocabulaire approximatif, banalisant et relativisant la réalité et la portée historique du fait commenté (« voyage » au lieu de déportation, « collaborateurs » arméniens plutôt que « les femmes, les jeunes filles et les nourrissons » évoqués par Mustapha Kemal lui même ; mise en valeur des causes de décès non directement imputables à un projet planifié d’extermination).
Un tel cumul de manquements et de graves négligences dans les éditions 2002, 2003 et 2004 du Quid est exclusif de tout caractère fortuit. Il constitue une faute au regard des exigences attendues d’un ouvrage à vocation pédagogique qui se prévaut d’un souci d’exactitude et de neutralité et en revendique d’autre objectif que de donner « des faits, des dates, des chiffres », étranger à toute vocation – ou alors qui aurait dû être annoncée comme telle- de défense d’une thèse, d’une idéologie ou d’un parti pris militant.
Cette faute, eu égard à l’ensemble des circonstances qui caractérisent l’espèce, engage sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la responsabilité des sociétés éditrices.
Elle cause incontestablement aux proches et aux héritiers de cette communauté, ainsi qu’aux groupements qui ont pour objet de maintenir la mémoire de ces événements, un trouble et une douleur morale d’autant plus vifs que le souvenir et l’attention historique venaient à peine de triompher de décennies de silence.
Sur les mesures de réparation
Les associations demanderesses sollicitent un euro de dommages-intérêts à titre de réparation morale. Il leur sera fait droit.
Elles sollicitent, par ailleurs, que soit ordonnée la suppression des passages qu’elles incriminent (et qui figurent en caractère gras en début de jugement) tant dans les éditions en ligne du Quid que, pour ceux qui y subsisteraient, dans l’édition papier du Quid 2005.
Il sera relevé, au préalable, sur ce dernier point, que plusieurs modifications ont été apportées aux passages initialement incriminés dans la dernière édition du Quid parue en cours d’instance (Quid 2005, paru en 2004). Ces modifications ont été notées en début de décision et ne seront rappelées, ici que pour mémoire :
– le passage, figurant en rubrique « Arménie » a été entièrement refondu, les estimations du nombre de victimes ont été ramassées, celle de J. Susem Mc Carthy a été supprimée ; il y ait fait désormais référence à la reconnaissance du caractère de génocide « par plusieurs instance nationales ou internationales ».
– l’encadré figurant en rubrique « Turquie » consacré à « quelques problèmes » a vu ses titres et sous titre modifiés ; le renvoi à la rubrique « Arménie » est désormais apparent et sans ambiguïté, le texte a été complété.
Comme les associations demanderesses le soulignent, à juste titre, la phrase figurant, non pas dans l’exposé de la position turque mais dans le récit chronologique de l’histoire de la Turquie (« Transferts d’arméniens vers les provinces méridionales de l’empire ottoman (collaborent avec la Russie), nombreux décès (épidémie, maladie) pendant le voyage (voir encadré p.x) n’a pas été modifiée dans l’édition 2005. Le tribunal relève cependant, sur ce point, que ce passage qui figurait dans les éditions du Quid parues avant l’introduction de l’instance n’a pas été visé dans l’assignation initiale en sorte que s’il a pu être cité dans les conclusions ultérieures des parties -et à ce titre pris en compte dans la présente décision comme élément contextuel- il ne saurait être regardé comme entrant dans le champ du litige, dont les limites sont, en cette matière, définitivement fixées par les termes de l’assignation.
S’agissant enfin de l’exposé de la position turque, tel qu’il figure dans l’encart « quelques problèmes », et qui est présenté comme tel aux lecteurs, le tribunal rappelle qu’il ne le considère pas comme fautif.
Ces observations faites -qui ne se rapportent qu’à la seule édition papier du Quid 2005 et sont sans effet sur les éditions électroniques en ligne des éditions précédentes également visées en demande- le tribunal estime qu’il ne lui appartient pas dans un litige de cette nature d’ordonner la suppression des passages visés dans l’assignation, qui excéderait ce que commandent les exigences de mesure, de nécessité et de proportionnalité tirées de l’article 10 de la Convention européenne et le souci d’une juste et équitable réparation qui lui parait essentiellement satisfait par la nature même de la présente décision.
Pour les mêmes motifs, l’insertion dans l’édition du Quid 2005 d’un paragraphe indiquant, comme le souhaiteraient les associations demanderesses, que « La question arménienne est aujourd’hui réglée par la reconnaissance du génocide de 1915 par les historiens et par le vote de la loi sus visée. Néanmoins, la Turquie continue de nier sa responsabilité dans le génocide arménien », ne lui parait pas devoir être ordonnée.
En revanche, il sera fait droit à la demande d’insertion d’un communiqué judiciaire dans les termes retenus au dispositif de la présente décision.
L’exécution provisoire ne serait pas conforme à la nature du litige. Elle ne sera pas prononcée.
Les sociétés éditrices seront condamnées à payer aux associations demanderesses ce que l’équité commande au titre de l’article 700 du ncpc.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 6, 10, 13 de la convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 1382 du code civil,
. Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société Les Editions Robert Laffont,
. Rejette l’exception de nullité tirée du défaut de capacité à agir des associations demanderesses,
. Déclare l’Uejf irrecevable, faute d’intérêt à agir,
. Condamne in solidum la société Les Editions Robert Laffont et la société des Encyclopédies Quid à payer un euro de dommages-intérêts à chacune des associations suivantes : Comité de défense de la cause arménienne (Cdca), Comité de coordination des organisations arméniennes de France, Mémoire 2000, « J’accuse » – Action internationale pour la justice (Aipj),
. Ordonne, à titre de mesure de réparation complémentaire, la publication aux frais des sociétés Les Editions Robert Laffont et des Encyclopédies Quid, et dans les 30 jours qui suivront le jour de la signification de la présente décision, du communiqué suivant dans trois quotidiens et trois hebdomadaires du choix des associations demanderesses, et sous la limite de 5000 € par insertion,
« Par jugement du 6 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Paris (chambre civile de la presse) a jugé fautive la présentation du génocide des arméniens en 1915 faite par le Quid, dans ses éditions 2002, 2003, 2004, aux rubriques « Turquie » et « Arménie », et a, en conséquence, fait droit à la demande en réparation présentée par les associations Comité de défense de la cause arménienne (Cdca), Comité de coordination des organisations arméniennes de France, Mémoire 2000, « J’accuse » – Action internationale pour la justice (Aipj) tendant à voir condamner in solidum la société Les Editions Robert Laffont et la société des Encyclopédies Quid à leur payer un euro de dommages-intérêts »,
. Ordonne aux mêmes sociétés de mettre ce communiqué en ligne sur le site internet www.quid.fr en sorte qu’il soit accessible à tout lecteur consultant les éditions 2002, 2003, 2004 du Quid ou, pour le moins, les entrées « Turquie » et « Arménie » de ces éditions électroniques,
. Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte,
. Déboute les associations demanderesses de toutes leurs autres prétentions,
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. Condamne in solidum la société Les Editions Robert Laffont et la société des Encyclopédies Quid à payer, sur le fondement de l’article 700 du ncpc :
– une somme de 2500 € aux associations, prises ensemble, Comité de défense de la cause arménienne (Cdca), Comité de coordination des organisations arméniennes de France,
– une même somme de 2500 € à l’association Mémoire 2000,
. Condamne la société Les Editions Robert Laffont et la société des Encyclopédies Quid aux entiers dépens.
Le tribunal : M; Boyer (président), M. Jean-Draeher (vice président), M. Bourla (premier juge)
Avocats : Me Bernard Jouanneau, Me Mathilde Jouanneau, Me Richard Sebban, Me Stéphane Lilti, Me William Bourdon
En complément
Maître Bernard Jouanneau est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante :
En complément
Maître Mathilde Jouanneau est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Richard Sebban est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Maître Stéphane Lilti est également intervenu(e) dans les 30 affaires suivante :
En complément
Maître William Bourdon est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Bourla est également intervenu(e) dans les 7 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Boyer est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Jean Draeher est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.