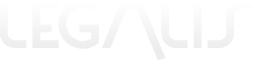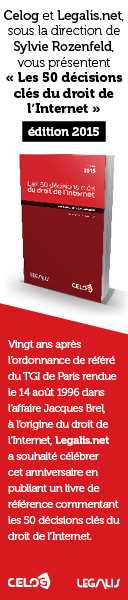Jurisprudence : Marques
Cour de cassation Chambre commerciale, financière et économique Arrêt du 20 mai 2008
Google France, Google Inc / Louis Vuitton Malletier
marques
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Google France, dont le siège est à Paris,
2°/ la société Google Inc., dont le siège est en Californie (Etats-Unis),
contre l’arrêt rendu le 28 juin 2006 par la cour d’appel de Paris (4ème chambre civile), dans le litige les opposant à la société Louis Vuitton Malletier, dont le siège est à Paris, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Google Inc et Google France proposent aux annonceurs un service dénommé Adwords leur permettant, moyennant la réservation de mots-clés, de faire apparaître de manière privilégiée, sous la rubrique liens commerciaux, les coordonnées de leur site en marge des résultats d’une recherche sur internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux contenus dans la requête adressée par un internaute au moteur de recherche ; que ces sociétés proposent à l’opérateur, pour améliorer le choix des mots clés, d’avoir recours à un générateur de mots clés ; que la société Louis Vuitton Malletier, titulaire des marques françaises Louis Vuitton n° 1 627 892, désignant l’ensemble des services des classes 1 à 42, L et V n° 1 540 178, désignant l’ensemble des produits et services des classes 1 à 41, et de la marque communautaire Vuitton n° 1 515 212, désignant tous les produits et services des classes 14, 18, 25 et 38, a fait constater que, lors de l’utilisation du moteur de recherche Google, la saisie des termes constituant ses marques faisait apparaître sur la partie droite, en tête de liste des résultats de la recherche, des annonces pour des sites proposant pour certains des produits contrefaisants ; qu’elle a assigné les sociétés Google France et Google Inc afin de voir constater qu’elles avaient commis des actes de contrefaçon de ses marques françaises et communautaire, de concurrence déloyale, porté atteinte à son enseigne et son nom de domaine, et commis des actes de publicité trompeuse ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis
Vu l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu qu’après avoir constaté, d’une part, que le générateur de mots clés faisait usage, reproduisait et imitait les termes Louis Vuitton, Vuitton et LV, qu’il permettait d’associer aux mots imitation, réplique, copie, d’autre part que lorsque l’on faisait des recherches à partir des marques de la société Vuitton, apparaissaient dans la colonne de droite, sous la rubrique liens commerciaux, des sites proposant des contrefaçons, les juges du fond ont retenu que les sociétés Google avaient commis des actes de contrefaçon de marque ;
Attendu qu’est posée la question de savoir quelle est la responsabilité du prestataire, qui propose un service de référencement payant sur internet tel que celui décrit ci-dessus, et notamment s’il fait un usage de la marque que son titulaire est habilité à interdire, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 891104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ;
Attendu que si, dans un tel service, le mot clé est choisi par l’opérateur, le prestataire met à la disposition de ce dernier l’outil appelé “générateur de mots clés”, destiné à améliorer la pertinence de ses choix, au regard de l’activité qu’il développe sur son site ; qu’il organise par le contrat de référencement l’affichage privilégié des coordonnées du site, sous la rubrique “liens commerciaux », grâce au lien créé à partir du mot clé ;
Attendu qu’il est constant que le prestataire de service de référencement ne fait pas usage du mot-clé reproduisant ou imitant la marque pour désigner ses propres produits et services ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé dans l’arrêt Adam Opel (25 janvier 2007, C-48/05, point 29) que l’interprétation selon laquelle les produits et services visés à l’article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive sont ceux commercialisés ou fournis par le tiers, découle du libellé même de cette disposition, en particulier des termes “usage pour des produits ou des services”, et que l’interprétation contraire aboutirait à ce que les termes “produits et services” employés à l’article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive désignent le cas échéant les produits ou les services du titulaire de la marque, alors même que les termes “produit” et “service” figurant dans l’article 6 paragraphe 1, sous b) et c) de la directive visent nécessairement ceux commercialisés ou fournis par le tiers, conduisant ainsi, contre l’économie de la directive, à interpréter les mêmes termes de façon différente selon qu’ils figurent à l’article 5 ou à l’article 6 ; que la question de savoir si les produits et services pouvaient être ceux d’un autre tiers n’a cependant pas été posée ;
Attendu que la Cour de justice a par ailleurs décidé (affaire Céline, 11 septembre 2007, C-17/06, points 23 et 36) que même en l’absence d’apposition, il y a usage «pour des produits ou des services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers, et que l’usage par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de la dite marque est habilité à interdire conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ; qu’en l’espèce cependant le signe n’est pas utilisé à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne ;
Attendu qu’il existe une difficulté sérieuse quant au point de savoir si le prestataire qui propose un service de référencement payant sur internet tel que celui décrit ci-dessus fait un usage de la marque que son titulaire est habilité à interdire sur le fondement des articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la directive et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement ;
Attendu que la question, qui se pose dans des termes similaires dans tous les Etats membres, reçoit des réponses divergentes ; que l’article 5 de la directive procède à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et qu’il définit ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté (arrêts Zino Davidoff et Levi Strauss, 20 novembre 2001, C-414/99 à C-416/99 point 39, Arsenal Football club, 12 novembre 2002, C-206/01 point 43) ; qu’afin d’éviter que la protection accordée au titulaire de la marque nationale et de la marque communautaire varie d’un Etat à l’autre, il convient que soit donnée une interprétation uniforme de l’article 5, paragraphe 1, de la directive et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement, en particulier de la notion d’usage» y figurant ; qu’il convient donc de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle ;
Attendu que les juges du fond ont par ailleurs constaté que les marques de la société Vuitton étaient renommées, ce qui n’est pas contesté ; qu’il convient donc d’interroger la Cour sur la question de savoir si l’usage que le prestataire de services de référencement fait des marques constitue, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l’article 9, paragraphe 1, sous C) du règlement, un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire ;
Attendu que, dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive ou du règlement, il convient de rechercher à quelles conditions la responsabilité du prestataire de service de référencement peut être engagée ; que les sociétés Google revendiquent le bénéfice des dispositions de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, et soutiennent qu’elles fournissent un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par le destinataire du service, en particulier le texte d’une annonce commerciale et les mots clés qui en déclenchent l’affichage ; qu’il convient également d’interroger la Cour sur ce point ;
DECISION
. Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :
1°) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?
2°) Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s’opposer à un tel usage, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ?
3°) Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur ?
. Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés se soit prononcée ;
. Réserve les dépens ;
. Dit qu’une expédition du présent arrêt ainsi qu’un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, Avocat aux Conseils,
pour les sociétés Google France et Google INC
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises, d’avoir dit que les sociétés Google Inc. et Google France ont commis sur l’ensemble des sites Google français et étrangers des actes de contrefaçon, de concurrence et de publicité déloyales, et d’avoir prononcé des mesures de condamnation et interdit aux sociétés Google tout usage sur l’ensemble de leurs sites français et étrangers des termes “lv”, “louis vuitton” et “vuitton”,
Aux motifs que «les sociétés Google France et Google Inc contestent la compétence des premiers juges et de la cour pour connaître de l’ensemble des faits litigieux résultant de la parution d’annonces générées par l’utilisation à titre de mots clés des marques dont la société Louis Vuitton Malletier est titulaire ; qu’elles font valoir, à cet effet, que le tribunal et la cour ne sauraient prononcer une mesure d’interdiction relative à des sites dont l’audience est réservée à un public étranger ou pour statuer sur des dommages relatifs à de tels sites qui, à les supposer établis, seraient réalisés à l’étranger ; que la seule circonstance que ces différents sites étrangers soient accessibles en France ne saurait constituer un lien de rattachement suffisamment étroit pour conférer une quelconque compétence aux juridictions françaises ;
mais considérant que les premiers juges ont, avec pertinence, justement retenu que la société Louis Vuitton Malletier ne fait pas grief aux sociétés Google France et Google Inc. d’actes de commercialisation de produits contrefaisants perpétrés sur le réseau, mais d’offrir une prestation publicitaire permettant à des annonceurs de promouvoir sur différents sites Google, français et étrangers, des sites marchands qui contrefont les marques et les produits Vuitton ;
qu’en raison du mode de diffusion propre à internet, l’ensemble des sites sont accessibles et visibles depuis le territoire national, ainsi qu’il en est justifié par la production de constats dressés par huissier de justice, notamment celui dressé, les 22 et 28 juillet 2003, par Me Alain Saragoussi, dont la validité est vainement contestée par les sociétés appelantes puisque les captures d’écran sont annexées au procès-verbal daté et signé, et, en tout état de cause, par l’agence pour la protection des programmes, de sorte que les actes de contrefaçon allégués par la société Louis Vuitton Malletier étant, suivant l’appréciation qui doit être portée au fond, susceptibles de causer un préjudice nécessairement subi en France, les juridictions nationales, au rang desquelles le tribunal de grande instance de Paris et la présente cour, sont donc compétents pour connaître de l’action engagée par la société intimée, peu important la langue dans laquelle les sites sont rédigés dès lors que, d’une part, ils reproduisent les produits argués de contrefaçon revêtus des marques en cause et que, d’autre part, il est mis à la disposition des internautes des fonctionnalités de traduction ;
qu’il s’ensuit que, contrairement au moyen invoqué par les appelantes, le lieu du fait générateur de la contrefaçon alléguée ou, conformément à l’article 5.3 du règlement n° 44/2000 du Conseil sur la compétence judiciaire, le lieu où le fait dommageable s’est produit, n’est pas, en l’espèce, situé à l’étranger, mais sur le territoire français puisque la visualisation par les internautes des annonces litigieuses s’effectue à partir de ce territoire, de sorte que le jugement déféré mérite, sur ce point, confirmation» (arrêt attaqué, p. 8, § 3 et ss. et p. 9, § 1) ;
1°/ Alors que la circonstance que la connexion au réseau internet rende de facto visible et accessible toute ressource mise en ligne n’est pas de nature à localiser le fait dommageable d’une contrefaçon de marque ou d’une concurrence déloyale partout où le demandeur aurait requis le constat de la visualisation d’un site internet ; que les actes de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale ne sont commis en France que lorsque l’activité supposée illicite est dirigée vers les consommateurs français auxquels elle est destinée, seule circonstance de nature à établir un lien de rattachement particulièrement étroit avec la juridiction française saisie, qui autorise le demandeur à déroger au principe naturel du forum rei, tout en permettant au défendeur de prévoir raisonnablement la juridiction devant laquelle son activité peut le conduire à être attrait ; qu’en décidant que le fait générateur des actes illicites reprochés sur l’ensemble des sites Google à travers le monde était localisé à Paris puisqu’ils étaient tous visualisables depuis cette ville, la cour d’appel a violé l’article 46 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 530 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ Alors que le fait générateur d’une contrefaçon de marque commise par le truchement d’un site internet ne se produit en France que si l’activité du site vise le public français pour promouvoir auprès des consommateurs du marché français des biens qui leur seraient proposés sous la marque litigieuse ; que, de même, le fait générateur d’une concurrence déloyale n’est commis en France que si l’activité du site est dirigée vers les consommateurs français, afin de se livrer auprès d’eux à une exploitation rivale de celle du demandeur entraînant la confusion avec sa personne ou son commerce ; qu’en s’abstenant de procéder à ces constatations, pour décider que le fait générateur des prestations reprochées sur l’ensemble des sites Google s’était produit à Paris puisque l’ensemble de ces sites y étaient visualisables, la cour d’appel a violé l’article 46 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et l’article 1382 du code civil ;
3°/ Alors qu’en retenant que les faits reprochés portaient sur l’affichage des liens commerciaux référencés à l’occasion d’une recherche lancée sur les différents sites Google qui ont été créés à travers le monde à l’adresse des internautes des pays concernés, tout en condamnant au contraire les sociétés Google à raison du seul emploi des termes des marques “Vuitton” dans le générateur des mots clés du contrat d’indexation que les sites Google permettent de conclure en ligne, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ alors qu’en s’abstenant de rechercher en quoi le fait générateur de la contrefaçon et de la concurrence déloyale qui résulterait de l’utilisation des termes des marques “Vuitton” dans le générateur de mots clés du contrat d’indexation se serait lui-même produit sur le territoire national, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 46 du nouveau code de procédure civile ;
5°/ Alors qu’en tout état de cause, en condamnant les sociétés Google pour avoir commis sur l’ensemble des sites Google répartis à travers le monde des actes de contrefaçon de marques, de concurrence et de publicité déloyales contraires au droit français, sans rechercher à quel titre la loi française aurait été compétente pour régir les faits qu’elle condamnait, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil, ensemble l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;
6°/ Alors qu’en condamnant les sociétés Google sur le fondement du droit français sans répondre à leurs conclusions du 23 mai 2006 qui faisaient valoir (p. 16 à 18) que les droits dont la société Louis Vuitton Malletier reprochait l’usurpation contrefaisante et déloyale étaient strictement limités au territoire national et qu’ils ne pouvaient donc être invoqués à l’encontre des sites du moteur de recherche Google situés à l’étranger, dont l’activité de référencement payant dépend en outre du territoire auquel ils se rattachent et résulte d’un ciblage exprès du souscripteur qui doit définir les pays et les langues des sites Google qui vont appliquer les liens commerciaux, à telle enseigne qu’il n’était pas établi que les biens proposés par les sites ainsi référencés auraient été disponibles pour les consommateurs français, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
7°/ Alors qu’en décidant que les sociétés Google auraient commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à raison de l’utilisation dans le générateur de mots clés du contrat d’indexation conclu en ligne des termes des marques “Vuitton”, sans constater que l’usage effectué par cet appareil eût été perpétré sur le territoire desdites marques parce qu’il aurait visé le public de leurs consommateurs pour promouvoir auprès d’eux l’exploitation de biens désignés par ces marques, ou qu’il aurait été par lui-même, sur le marché des consommateurs français, une exploitation rivale de celle de la société Louis Vuitton Malletier créant une confusion avec sa personne ou son commerce, la cour d’appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 9 du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 et l’article 1382 du code civil.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Google Inc et la Sarl Google France ont commis des actes de contrefaçon de marques, de concurrence et de publicité déloyales et d’avoir prononcé à leur encontre diverses mesures de condamnation,
Aux motifs que « les sociétés Google reprochent aux premiers juges de ne pas leur avoir accordé le régime spécifique de responsabilité instauré par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifié par l’article 6, alinéa 2, de la loi du 21 juin 2004, relative à la confiance dans l’économie numérique, qui a opéré la transposition en droit interne français de la directive 2000/31/CE 8 juin 2000 ; que, à cet effet, elles font valoir qu’elles exerceraient une simple activité de “prestataire de stockage d’information” et que l’activité publicitaire proposée aux annonceurs sous le terme AdWords consisterait en une simple prestation de stockage d’informations, de sorte qu’elle ne pourrait générer une responsabilité que dans l’hypothèse où “ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu” ;
qu’il résulte cependant de l’examen des prestations effectuées par les sociétés Google, telles qu’elles ont été précisément caractérisées par le tribunal, la cour y faisant expressément référence, que celles-ci ne se bornent pas à “stocker” des informations de nature publicitaire qui lui seraient fournies par des annonceurs, mais qu’elles déploient une activité de régie publicitaire, d’abord, en organisant la rédaction des annonces, en décidant de leur présentation et de leur emplacement, ensuite, en mettant à la disposition des annonceurs des outils informatiques destinés à modifier la rédaction de ces annonces ou la sélection des mots clés qui permettront de faire apparaître ces annonces lors de l’interrogation du moteur de recherche et, enfin, en incitant les annonceurs à augmenter la redevance publicitaire “coût par clic maximum” pour améliorer la position de l’annonce ;
que force est de constater que le service AdWords est présenté sur les différents sites Google sous la rubrique et le lien hypertexte “Publicité “, avec le slogan “Votre publicité avec Google” et cette précision : “le ciblage à base de mots clés augmente la pertinence de votre publicité” ; que, en outre, l’activité publicitaire ainsi déployée constitue l’essentiel du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés appelantes qui, au mois de juillet 2004, annonçaient que, “au premier semestre 2004, 98 % du chiffre d’affaires a été généré par les annonceurs publicitaires, que le pourcentage était de 97 % sur l’ensemble de 2003” ; qu’il convient de relever, également, que dans un article paru dans le quotidien Les Echos du 25 juillet 2005, il était fait référence aux “impressionnantes performances financières de Google, qui s’appuient sur ce modèle de publicité en ligne”,
qu’il s’ensuit que les sociétés Google France et Google Inc ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 43-8 précité, dès lors que leur activité dans le domaine publicitaire ne relève pas de celles offertes par les intermédiaires techniques, fournisseurs d’accès, hébergeurs de sites ou prestataires de stockage visés par ces dispositions» (arrêt attaqué, p. 93 et ss. et p. 10, § let 2)
Alors que, conformément à l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, les dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi du 21 juin 2004 doivent être appliquées à toute prestation de stockage pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, de messages de toute nature, sans qu’il importe de distinguer selon la catégorie d’intermédiaire à laquelle appartient le prestataire qui l’accomplit, selon les modalités de sa rémunération ou encore selon qu’il organise le cadre dans lequel les données stockées sont diffusées ou qu’il mette à disposition des outils facultatifs qui ne définissent pas à l’avance le contenu de ces données, que les intéressés sont seuls à établir librement, dont ils conservent l’entière maîtrise et qu’ils peuvent modifier à tout moment ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Google Inc. et la Sarl Google France ont commis au préjudice de la société Louis Vuitton Malletier des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et d’avoir prononcé à leur encontre diverses mesures de condamnation,
Aux motifs, d’une part, que «les sociétés Google France et Google Inc. soutiennent que l’usage qu’elles font des termes “Louis Vuitton’ “Vuitton” et “L V” ne serait pas effectué à titre de marque dès lors que ces expressions seraient déconnectées de tout contexte dans la mesure où elles ne seraient associées à aucun produit ou service ;
mais qu’en premier lieu, il convient de relever que les articles L. 713-2 et L. 7 13-3 du code de la propriété intellectuelle, dont la société Louis Vuitton Malletier demande l’application ne retiennent pas exclusivement, comme acte matériel constitutif de la contrefaçon, la mention de la marque sur un produit ou un service, celle-ci pouvant résulter d’une reproduction ou de l’imitation de la marque de quelque manière que ce soit ou encore du simple usage ; que, au demeurant, l’article 5-3 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dispose qu’il peut notamment être interdit (…) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité” ;
qu’il est établi, par l’ensemble des procès-verbaux qui ont été dressés et qui, régulièrement versés aux débats, sont relatés, en détail, par le tribunal, relation à laquelle la cour fait expressément référence, que l’outil de suggestion de mots clés, mis en oeuvre par les sociétés appelantes, fait usage, reproduit et imite les termes “Louis Vuitton “, “Vuitton” et « L V” ;
qu’ainsi il est, notamment, mentionné au constat dressé, le 18 juin 2003, par l’agence pour la protection des programmes que, en cas d’inscription dans l’outil de suggestion de mots clés : * des lettres “LV”, apparaît la suggestion de “lv inspired handbants”, * des termes “Vuitton” et “Louis Vuitton “, apparaissent successivement les suggestions suivantes :
“fake louis vuitton handbags, replica louis vuitton handbags et louis vuitton replica bags”;
que, en outre, il est, également, justifié par les constatations effectuées par l’agence pour la protection des programmes que, en opérant une recherche à partir de la marque “Louis Vuitton” apparaît un écran composé de la manière suivante : en face de la liste des résultats de la recherche (partie gauche et centrale), en tête de laquelle apparaît le site officiel de la société Louis Vuitton Malletier à l’adresse www.vuitton.com, figurent dans la colonne de droite intitulée “liens commerciaux” plusieurs sites commercialisant ouvertement des contrefaçons, tels que www.designerimpression.com annonçant dans sa publicité même “Fine Replica handbangs ; lnspired by LV, Gucci, Dior, Prada” ou encore www.desiqns.ito.com, annonçant comme titre de la publicité “Louis Vuitton Replica” ;
que la reproduction et l’usage ainsi opérés, par l’intermédiaire de l’outil de suggestion, créé à l’initiative des sociétés Google et mis à la disposition des internautes candidats à la rédaction d’annonces publicitaires, sont, comme le relève avec pertinence la société intimée, en relation directe avec les produits visés par les marques dont elle est titulaire ; que, en tout état de cause, ces marques sont, ainsi qu’il en est justifié par les pièces produites à la procédure, des marques de renommée, circonstance, au demeurant, non sérieusement contestée ;
que l’usage des marques “Louis Vuitton“, “Vuitton” et “L V” par les sociétés Google, dans les conditions précédemment relevées, concernant des produits ou services qui ne procèdent pas de l’activité de la société Louis Vuitton Malletier, constitue un acte fautif, d’une part en raison de leur reproduction ou, dans certains cas, de leur imitation entraînant un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, respectivement au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, et, d’autre part, en causant un préjudice direct au propriétaire de ces marques qui, au surplus, génère, du fait de leur renommée, un profit injustifié aux sociétés Google France et Google Inc. » (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 5 et ss. et p. 11, alinéas 1 à 5) ;
Et que «en deuxième lieu, pour s’exonérer de toute responsabilité, les sociétés appelantes prétendent que les mots clés qu’elles suggèrent par l’intermédiaire de l’outil générateur de mots clés, en reproduisant les trois marques en cause, auraient une “vocation purement informative” et seraient “générés automatiquement sur des critères statistiques” ;
mais que l’outil mis en place par les sociétés Google a pour finalité de proposer des publicités pour des produits autres que ceux offerts à la vente par la société Louis Vuitton Malletier et que la participation des sociétés appelantes n’est pas, contrairement à leur argumentation, purement passive puisque, ainsi que le démontre avec pertinence le tribunal lors de la rédaction de toute annonce, en particulier par le recours au système AdWords, ces sociétés accompagnent la démarche du candidat annonceur selon un processus comprenant plusieurs étapes ; qu’ainsi, à l’étape 2 du processus, intitulée “Créez des groupes d’annonces”, elles proposent I’utilisation du générateur de mots clés de nature à améliorer la rédaction de l’annonce en ces termes : “Utilisez votre Générateur de mots clés pour vous aider à choisir les mots les plus pertinents” ;
que l’on peut, aussi, relever que si le terme “Vuitton” est inscrit dans le générateur de mots clés, la réponse suivante apparaît : “Louis vuitton replicas, Fake louis vuitton bags, Replicat louis vuitton handbags, Imitation Louis vuitton, Louis vuitton inspiredt, Louis vuitton replica bags, Louis vuitton copies” ;
qu’est inopérant l’argument avancé par les sociétés appelantes selon lequel l’utilisation de l’outil générateur de mots clés est facultatif, dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci est effectivement utilisé par des internautes, de même que celui tiré de la circonstance selon laquelle les sociétés Google ne commercialisent pas personnellement les produits et services contrefaisants dans la mesure où il leur est imputé à faute, non pas des actes de commercialisation, mais des prestations publicitaires » (arrêt attaqué, p. 10, § 6 et ss., p. 11 et 12, § 1 à 4) ;
1°/ Alors que le fait que l’automate statistique du contrat de la société Google Inc., dans lequel les termes des marques “Vuitton” ont été entrés, ait indexé les 7 locutions mentionnées par la cour d’appel – parmi 173 autres qui correspondaient toutes à des recherches d’internautes ayant inclus lesdits termes, et qui n’ont été répertoriés machinalement que pour cette raison lexicale – ne constitue pas, par lui-même, un usage illicite de marque, dès lors que ces mots susceptibles de correspondre à des recherches documentaires ne sont en eux-mêmes le signe distinctif d’aucune marchandise qu’ils identifieraient aux yeux du public dans le cadre d’une publicité dont elles feraient l’objet ; qu’en se bornant à déduire la contrefaçon de la reprise des termes des marques invoquées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1, L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ Alors qu’en relevant de même que certains des sites référencés – qui doivent impérativement rédiger l’annonce du lien commercial avant de pouvoir accéder au générateur de mots clés – auraient eux-mêmes rédigé leurs annonces avec des termes similaires à ceux précités, indiquant qu’ils commercialisaient des copies des produits “Vuitton”, la cour d’appel a caractérisé de leur part un acte de contrefaçon qui est insusceptible d’établir que l’outil statistique du contrat d’indexation serait distinctement et en lui-même un acte de contrefaçon propre et personnel des sociétés Google ; qu’en statuant par ce motif inopérant, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ Alors qu’en décidant, par voie d’affirmations générales, que le générateur de mots clés reproduirait, imiterait ou porterait atteinte à la renommée des marques “Vuitton”, protégée par les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ Alors qu’en se bornant à affirmer l’existence d’une reproduction ou d’une imitation ou d’une atteinte à la renommée des marques “Vuitton”, sans procéder à la comparaison d’ensemble des signes supposés contrefaisants avec chacune des marques supposées contrefaites, sans analyser en quoi ils en seraient une reproduction à l’identique pour désigner des biens identiques, ou en quoi leurs similitudes ou celles des biens sur lesquels ils porteraient seraient telles qu’un consommateur d’attention moyenne qui ne les aurait pas en même temps sous les yeux pourrait les confondre, sans indiquer quels signes contrefaisants auraient désigné ces produits que les marques “Vuitton” n’auraient pas énumérés à leurs dépôts, ni indiquer en quoi leur exploitation pour ces biens aurait constitué une exploitation injustifiée des marques alléguées, la cour d’appel a privé sa décision des base légale au regard des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ Alors que le fait, pour l’outil statistique du contrat d’indexation, d’afficher des requêtes de recherche d’internautes ayant inclus les termes des marques “Vuitton”, n’est pas en lui-même constitutif d’un acte de concurrence déloyale susceptible de provoquer dans l’esprit des consommateurs auxquels il n’est pas destiné une quelconque confusion sur la personne, le commerce ou le site internet de la société Louis Vuitton Malletier, que l’outil de la société Google Inc. ne désigne pas au public par les mots des recherches documentaires des internautes, qui sont répertoriés machinalement à partir du mot que le contractant a lui-même sélectionné ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
Et aux motifs, d’autre part, qu’ «en deuxième lieu, pour s’exonérer de toute responsabilité, les sociétés appelantes prétendent que les mots-clés qu’elles suggèrent par l’intermédiaire de l’outil générateur de mots clés, en reproduisant les trois marques en cause, auraient une « Vocation purement informative” et seraient “générés automatiquement sur des critères statistiques” ;
mais que l’outil mis en place par les sociétés Google a pour finalité de proposer des publicités pour des produits autres que ceux offerts à la vente par la société Louis Vuitton Malletier et que la participation des sociétés appelantes n’est pas, contrairement à leur argumentation, purement passive puisque, ainsi que le démontre avec pertinence le tribunal lors de la rédaction de toute annonce, en particulier par le recours au système AdWords, ces sociétés accompagnent la démarche du candidat annonceur selon un processus comprenant plusieurs étapes ; qu’ainsi, à l’étape 2 du processus, intitulée “Créez des groupes d’annonces”, elles proposent l’utilisation du générateur de mots clés de nature à améliorer la rédaction de l’annonce en ces termes : “Utilisez votre Générateur de mots-clés pour vous aider à choisir les mots les plus pertinents” ;
que l’on peut, aussi, relever que si le terme “Vuitton” est inscrit dans le générateur de mots clés, la réponse suivante apparaît : “Louis vuitton replicas, Fake louis vuitton bags, Replicat louis vuitton handbags, Imitation Louis vuitton, Louis vuitton inspiredt, Louis vuitton replica bags, Louis vuitton copies” ; qu’est inopérant l’argument avancé par les sociétés appelantes selon lequel l’utilisation de l’outil générateur de mots clés est facultatif, dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci est effectivement utilisé par des internautes, de même que celui tiré de la circonstance selon laquelle les sociétés Google ne commercialisent pas personnellement les produits et services contrefaisants dans la mesure où il leur est imputé à faute, non pas des actes de commercialisation, mais des prestations publicitaires » (arrêt attaqué, p. 11, dernier §, et p. 12 ; § 1 à 4) ;
6°/ Alors qu’il résulte des procès-verbaux des 18 juin, 27 juin et 24 juillet 2003 que le générateur de mots clés est un outil statistique facultatif interne au contrat d’indexation conclu en ligne, qui interdit tout emploi des marques des tiers et auquel le contractant ne peut accéder qu’après avoir lui-même sélectionné les pays et les langues des sites Google concernés et enregistré le lien commercial comprenant le texte d’une annonce pour la rédaction de laquelle aucune aide n’est disponible ; que le générateur de mots clés ne peut être actionné qu’à l’occasion de l’étape suivante, et permet de signaler instantanément au contractant que ses annonces “s’afficheront lors des recherches suivantes” des internautes ayant inclus le mot qu’il a choisi, et qui sont automatiquement répertoriées selon le critère lexical, de sorte qu’averti de l’extrême diversité des recherches pouvant la déclencher, il est invité à spécifier l’indexation qu’il contracte, au besoin “en retenant” comme “en excluant” les mots susceptibles ou pas de correspondre à la recherche documentaire qu’il a en vue, en fonction de leur “pertinence”, que l’outil statistique et lexical ne peut lui-même apprécier ; qu’à la suite de la saisie des termes des marques “Vuitton”, ce sont ainsi 180 locutions qui ont été affichées ; qu’en retenant que le générateur de mots clés “proposait de manière active” “d’améliorer la rédaction de l’annonce” avec les 7 locutions qu’il mentionnait et qu’il incitait “fortement” à utiliser en réponse au terme “Vuitton”, la cour d’appel a dénaturé les procès-verbaux susvisés en violation de l’article 1134 du code civil ;
7°/ Alors qu’en retenant que le générateur de mots clés aurait pour finalité de promouvoir des produits contrefaisant les modèles “Vuitton”, sans constater que cet outil fait partie de la conclusion du contrat conclu avec la société Google Inc., qu’il est destiné à améliorer la pertinence de l’indexation faisant l’objet de l’accord des parties, que les conditions générales du contrat interdisent au souscripteur, qui a l’entière maîtrise des termes de son annonce qu’il rédige seul, de faire la promotion des produits illicites, de choisir les marques des tiers comme mots clés ou de violer le droit pénal ou les droits des tiers, notamment sur leurs marques, que les annonces mentionnées par l’arrêt attaqué ont été enregistrées en violation des stipulations du contrat et que celui-ci commandait bien d’exclure les 7 locutions susmentionnées dont il était constant qu’elles n’ont d’ailleurs jamais été sélectionnées comme mots clés, la cour d’appel a violé l’article 1134, alinéas 1 à 3, du code civil.
Quatrième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Google Inc. et la Sarl Google France ont commis des actes de concurrence déloyale envers la SA Louis Vuitton Malletier et d’avoir prononcé diverses mesures de condamnation,
Aux motifs que «les sociétés Google France et Google Inc. critiquent le jugement déféré en ce que, selon elles, le tribunal aurait qualifié d’actes de concurrence déloyale des faits qu’il a par ailleurs qualifiés de contrefaçon ;
mais que, contrairement à une telle affirmation, les premiers juges ont, justement, retenu que le comportement de ces sociétés ne portait pas seulement atteinte aux marques dont la société Louis Vuitton Malletier est titulaire, mais également à la dénomination sociale “Louis Vuitton Malletier”, à l’enseigne “Louis Vuitton” et au nom de domaine www.vuitton.com, circonstances qui caractérisent, en raison des risques de confusion qu’elles engendrent pour le consommateur d’attention moyenne, des actes de concurrence déloyale ;
qu’en effet, lorsqu’un terme, objet d’une marque et d’une dénomination sociale, est utilisé sans droit par un tiers, un tel comportement est constitutif, d’une part, de contrefaçon, et, d’autre part, d’une faute distincte résultant de l’usurpation de la dénomination sociale ; qu’il en va de même lorsque ce terme est également utilisé comme signe distinctif à titre d’enseigne ou de nom de domaine ;
que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que, en tout état de cause, elles ne sauraient être condamnées sur le fondement de la concurrence déloyale dès lors qu’elles ne sont pas en situation de concurrence avec la société Louis Vuitton Malletier ;
qu’en effet, si ces sociétés ne commercialisent pas de sacs ou des produits de maroquinerie, il est établi qu’en faisant un usage illicite des signes distinctifs précédemment rappelés, elles en ont tiré profit dans le cadre de leurs activités publicitaires, au préjudice de la société intimée» (arrêt attaqué, p. 13 les 6 derniers paragraphes et p14 § 1 à 3) ;
1°/ Alors qu’en se bornant à affirmer que l’atteinte à la dénomination sociale, à l’enseigne et au nom de domaine de la société Louis Vuitton Malletier constituait un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon à raison des risques de confusion chez le consommateur d’attention moyenne, sans constater en quoi l’utilisation des termes des marques “Vuitton” dans le générateur de mots clés à titre de supposés signes désignant des biens aurait provoqué un risque de confusion particulier et distinct de celui généré par l’atteinte à la garantie d’origine de la marque, sur la personne même de la société Louis Vuitton Malletier, son commerce ou son nom de domaine, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
2°/ Alors qu’en condamnant les sociétés Google pour avoir commis des actes de concurrence déloyale envers la société Louis Vuitton Malletier, tout en constatant qu’elles n’auraient pas la même activité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales des ses constatations et a violé l’article 1382 du code civil.
Cinquième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Google Inc. et la Sarl Google France ont commis des actes de publicité trompeuse envers la société Louis Vuitton Malletier et de les avoir condamnées au paiement de la somme de 150 000 euros,
Aux motifs que, « en droit, selon les dispositions de l’article L. 115-33 du code de la consommation, “les propriétaires de marques de commerce de fabrique ou de services peuvent s’opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l’utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi” et que, aux termes de celles de l’article L. 121-1 du même code, “est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent notamment sur la nature, l’origine, la composition et les qualités substantielles (…) des biens et services qui font l’objet de la publicité” ;
que, en l’espèce, les sociétés Google France et Google Inc critiquent le jugement déféré en ce qu’il a estimé qu’en diffusant des liens AdWords sous la bannière « liens commerciaux » elles auraient, au sens des articles précités, commis des actes de publicité trompeuse ; qu’à cet effet elles font valoir que l’utilisation de l’expression “liens commerciaux” ne serait pas trompeuse dès lors qu’elle aurait pour finalité d’informer l’internaute, en toute transparence, et que les liens indexés par le service AdWords seraient distincts des liens référencés par son moteur de recherche ;
mais que les premiers juges ont, par une motivation pertinente, justement retenu, après avoir relevé que dans l’offre de services publicitaires il était mentionné, après l’expression “la clarté des publicités affichées sur les pages de résultats Google” la précision “votre publicité au format texte clairement affichée en haut et page de résultats de recherche Google… dépourvue de tout artifice, peut générer des taux de clic de cinq à dix fois supérieurs au standard du marché », que la mention “liens commerciaux”, sous laquelle sont regroupés les sites litigieux, est trompeuse en elle-même, dès lors qu’elle laisse entendre que le site, affiché en partie gauche de l’écran, entretient des rapports commerciaux avec ceux qui apparaissent sous cette rubrique de sorte que, en l’espèce, le site de la société Louis Vuitton Malletier apparaît être, aux yeux d’un internaute, en relation commerciale avec les sites litigieux dont le caractère publicitaire n‘est pas contestable, de sorte que ce dernier peut ainsi penser, en s’adressant à une entreprise inscrite sous la rubrique « lien commercial » que celle-ci dispose de produits authentiques ;
qu’une telle pratique est, en outre, manifestement contraire aux dispositions de l’article 20 de la loi du 21 juin 2004, relative à la confiance dans l’économie numérique, qui précise que “toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée” ;
que, par ailleurs, le tribunal a justement jugé que si les sociétés appelantes ne participent pas directement à la rédaction des messages publicitaires, il n’en demeure pas moins qu’elles les font apparaître sous la rubrique liens commerciaux dont l’intitulé est, pour les motifs précédemment retenus, particulièrement trompeur» (arrêt attaqué, p. 14, § 5 et s., p. 15, §1 à 3) ;
1°/ Alors qu’en décidant que l’intitulé “liens commerciaux” serait par lui-même trompeur en ce qu’il conduirait l’internaute à penser que les sites ainsi référencés auraient des rapports commerciaux avec la société Louis Vuitton Malletier mentionnée à gauche, sans identifier les publicités prétendument trompeuses, ni analyser d’une façon concrète l’ensemble des éléments les caractérisant, la cour d’appel n’a pas justifié que les consommateurs auraient pu être trompés sur l’existence de relations contractuelles avec les sites dont elle constate, au contraire, qu’ils présentaient ostensiblement leurs productions comme des contrefaçons des modèles “Vuitton”, ce qui prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 115-33 et L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et l’article 1382 du code civil ;
2°/ Alors que le caractère trompeur d’une publicité doit être apprécié en fonction de l’attente présumée d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif ; qu’en décidant que l’intitulé “liens commerciaux” serait par lui-même trompeur en conduisant l’internaute à penser que les sites référencés auraient des rapports commerciaux avec les résultats placés à gauche, sans rechercher si un consommateur moyen de l’internet ne se serait pas normalement attendu à ce que ce vocable désigne ce qu’ils sont, savoir de simples liens référencés à titre commercial, dès lors en effet que le terme de lien renvoie à sa désignation technique sur les réseaux numériques, que le moteur de recherche consulté est un instrument de recherche documentaire qui indexe des liens de n’importe quel type sans relation contractuelle entre eux, qu’ils constituent une pratique courante d’indexation payante en usage dans tous les domaines d’activités, que la diversité et l’hétérogénéité des liens commerciaux excluent qu’une relation contractuelle commerciale puisse être raisonnablement présumée avec les autres résultats, que cet intitulé est la désignation générique usuelle de cette forme d’indexation, qu’il forme ainsi le titre officiel de la recommandation que lui a consacrée le Forum des droits sur l’internet, que la présentation à part des liens commerciaux, en marge des résultats de la recherche dans une colonne bleutée séparée de ces résultats indique clairement qu’il s’agit de liens distincts et séparés, et que cette présentation habituellement pratiquée par les autres moteurs de recherche identifie ordinairement une indexation payante à titre commercial, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Sixième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Google Inc. et la Sarl Google France ont commis des actes de contrefaçon de marques, de concurrence et de publicité déloyales et d’avoir prononcé à leur encontre diverses mesures de condamnation,
Aux motifs que « le tribunal ajustement retenu, pour apprécier l’importance du préjudice subi par la société Louis Vuitton Malletier, la notoriété non contestée des marques et signes Vuitton, l’importance que joue le site internet de cette société dans son dispositif tant de communication que de publicité et pour lequel elle a investi des sommes substantielles afin de présenter une image conforme aux produits de luxe qu’elle commercialise ;
qu’en outre, la société intimée, qui déploie des moyens financiers particulièrement conséquents au service de sa politique de lutte contre la contrefaçon de ses produits, la voit mise, pour partie, en échec par le comportement des sociétés appelantes qui ont, ainsi que précédemment retenu, joué un rôle particulièrement actif dans la divulgation de sites proposant la commercialisation de produits contrefaisant ceux diffusés sous les marques dont la société Louis Vuitton Malletier est titulaire ;
que les sociétés Google France et Google Inc. tentent vainement de minimiser leurs responsabilités en soutenant qu’elles auraient déréférencé au fur et à mesures les sites litigieux divulgués sous la rubrique “liens commerciaux”, de sorte que ceux-ci ne seraient apparus que pour une période de temps limitée ;
mais que la société Louis Vuitton Malletier justifie qu’elle a été dans l’obligation d’adresser de nombreuses mises en demeure, au demeurant restées sans réponse à l’exception d’un simple accusé de réception du 21 juin 2003, avant que les sociétés intimées ne mettent en oeuvre, alors qu’elles étaient à même de concevoir, ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, les procédés techniques appropriés pour mettre fin aux actes délictueux dont la société intimée était victime (lettres A.R. des 6 février, 11 juin, 9 octobre, 10 octobre 2003) ;
(…) que, contrairement aux allégations des sociétés intimées, il est établi qu’elles étaient à même de concevoir et de développer des moyens techniques de nature à éviter les actes illicites qui leur sont imputés ; qu’en effet, il résulte, d’une part, d’un article paru dans le quotidien Washington Post, daté du 1er décembre 2003, que Google a décidé d’elle-même d’empêcher l’apparition de publicités générées par des mots clés relatifs à des produits pharmaceutiques pouvant avoir des effets de dépendance et notamment certains mots clés correspondant à des noms de produits et que, d’autre part, elle a accepté, à la demande des autorités chinoises, de “blacklister” certains termes, jugés non politiquement corrects, dans le but d’avoir accès au marché publicitaire de ce pays » (arrêt attaqué, p. 15, dernier §, p. 16, §1 à 3, et p.13, §1) ;
1°/ Alors que les sociétés Google faisaient valoir, dans leurs conclusions d’appel, qu’il n’existait pas de lien causal entre le fonctionnement du générateur de mots clés et le préjudice allégué par la société Louis Vuitton Malletier, dès lors que «la preuve de l’utilisation de cet outil par les annonceurs des liens AdWords litigieux tels qu’identifiés dans les différents procès-verbaux de constat versés aux débats n’est (…) pas rapportée», que les expressions telles que “replica Louis Vuitton”, “Louis Vuitton replicas”, “fake Louis Vuitton” ou “Louis Vuitton replica handbags” «n’ont jamais été choisies en tant que telles par un annonceur à titre de mot clé ou autrement» et que «l’outil de mots clés est sans incidence sur la rédaction du titre et de la description des sites constituant le contenu proprement dit des liens Ad Words» (conclusions des sociétés Google, p. 28 et 29) ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner les sociétés Google à réparation, qu’elles auraient joué un rôle actif dans la divulgation de sites proposant la commercialisation de produits contrefaisants, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ Alors que l’obligation in solidum n’oblige à répondre pour le tout du dommage causé à autrui que ceux par le fait desquels le dommage est arrivé ; que la société Google France faisait valoir qu’elle était uniquement chargée de veiller en France au respect de la législation par le site Google France, mais qu’elle n’avait en revanche aucune attribution dans l’exploitation des autres sites Google à travers le monde, ce qu’avait d’ailleurs reconnu la société Louis Vuitton Malletier, qui avait constaté que l’ensemble des sites Google était géré par la société Google Inc. «avec en France le relais commercial de la société Google France» ;
qu’en se bornant à relever que les sociétés Google auraient commis des actes illicites, sans rechercher dans quelle mesure la société Google France aurait participé à la commission des faits dommageables perpétrés sur chacun des autres sites Google pour la réparation desquels la condamnation in solidum était prononcée à son encontre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1383 du code civil ;
3°/ Alors qu’en se bornant à relever de manière inopérante que les sociétés Google n’auraient adressé aucune réponse aux courriers de la société Louis Vuitton Malletier à l’exception d’un simple accusé de réception, sans procéder à aucune analyse de ces courriers, sans rechercher s’ils ne contestaient précisément pas des affichages de sites différents entre-temps désactivés et sans rechercher, comme le demandaient les sociétés Google, s’il ne résultait pas des pièces versées au débat que les liens contestés avaient été supprimés au fur et à mesure des plaintes adressées aux sociétés Google, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1383 du code civil ;
4°/ Alors qu’en décidant que les sociétés Google n’auraient pas répondu à deux lettres des 9 et 10 octobre 2003, dont ne se prévalait pas, dans ses conclusions, la société Louis Vuitton Malletier, qui soutenait seulement avoir mis deux sociétés ayant fait paraître des annonces en demeure de cesser leurs activités contrefaisantes, la cour d’appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ;
5°/ Alors qu’en se bornant à affirmer que les sociétés Google se seraient abstenues de mettre en oeuvre la procédure mentionnée par un article du Washington Post du 1er décembre 2003, rapportant l’annonce d’une mesure de blocage aux Etats-Unis pour des médicaments, sans rechercher si cette mesure n’était précisément pas celle que les sociétés Google avaient engagée dès le 3 novembre 2003 et dont la mise en place en France avait requis une intervention technique de trois mois nécessaire à sa totale effectivité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1383 du code civil.
La Cour : Mme Favre (président), Mme Farthouat-Danon (conseiller référendaire rapporteur), Mme Garnier (conseiller doyen), Mmes Tric, Betch, MM. Petit, Jenny, Mmes Pezard, Levon-Guérin (conseillers), Mmes Beaudonnet, Farthouat-Danon, Michel-Amsellem, MM. Pietton Salomon, Mme Maitrepierre, M. Gadrat (conseillers référendaires), M. Jobard (avocat général)
Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent,
Voir Cour de cassation du 27/1/2009
En complément
Maître SCP Piwnica et Molinié est également intervenu(e) dans les 75 affaires suivante :
En complément
Maître SCP Thomas Raquin et Benabent est également intervenu(e) dans les 28 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Farthouat-Danon est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Favre est également intervenu(e) dans les 32 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.