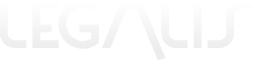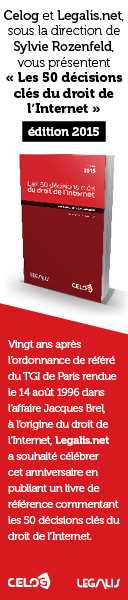Jurisprudence : Marques
Cour de cassation Chambre commerciale, financière et économique Arrêt du 20 mai 2008
Google / Viaticum Luteciel
marques
Statuant sur le pourvoi formé par la société Google France, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris, contre l’arrêt rendu le 10 mars 2005 par la cour d’appel de Versailles (12ème chambre civile, section 1), dans le litige les opposant
1°/ à la société Viaticum,
2°/ à la société Luteciel,
ayant toutes deux leur siège à Paris, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Google France propose aux annonceurs un service dénommé “Adwords” leur permettant, moyennant la réservation de mots-clés, de faire apparaître de manière privilégiée, sous la rubrique liens commerciaux, les coordonnées de leur site en marge des résultats d’une recherche sur internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux contenus dans la requête adressée au moteur de recherches de cette société sur internet ; que cette société propose à l’opérateur, pour améliorer le choix des mots-clés, d’avoir recours à un générateur de mots-clés ; que les sociétés Viaticum et Luteciel, qui exploitent un site internet pour leur activité de prestations de services de tourisme, ont poursuivi la société Google en contrefaçon de marques dont elles sont titulaires, déclinant les expressions “bourse des vols”, “bourse des voyages” et “BDV », au motif que la présence de telles expressions dans une requête privilégiait, en raison de la réservation de tels mots-clés, le contact avec des sites concurrents ;
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche
Vu l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu que l’arrêt retient que la société Google France a commis des actes de complicité de contrefaçon, et condamne cette société pour contrefaçon, aux motifs que cette dernière doit être en mesure d’interdire l’utilisation de mots-clés manifestement illicites, tels ceux qui sont contraires aux bonnes moeurs ou qui contrefont des marques notoires ou connues d’elles, qu’elle connaissait ou aurait dû connaître les marques des sociétés plaignantes, clientes de son programme Adwords, et qui les utilisent dans le cadre de leurs campagnes publicitaires, et que, lors même que la société Google France l’aurait légitimement ignoré, elle ne pouvait pas proposer des mots-clés reprenant les marques, sous prétexte qu’ils figuraient parmi les plus souvent demandés, sans s’être livrée à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur ces mots ;
Attendu que se trouvent ainsi posées diverses questions relatives à l’existence d’une contrefaçon de marque en cas d’utilisation par un tiers non autorisé d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée, afin de proposer sur internet des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de cette marque, et, corrélativement, à une possible complicité du prestataire de services de référencement payant sur internet, dans la mesure où il serait ainsi fait un usage de la marque que son titulaire serait habilité à interdire, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et sous b) de la première Directive 8911041CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
Attendu qu’il est constant que le prestataire de service de référencement payant ne fait pas usage du mot-clé reproduisant ou imitant la marque pour désigner ses propres produits et services ;
Attendu, en outre, qu’il n’est pas prétendu que les sites désignés par les liens commerciaux incriminés proposent à la vente des produits ou services sous le signe reproduisant ou imitant la marque dont la protection est réclamée ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé dans l’arrêt Adam Opel (25 janvier 2007, C-48/05), que l’interprétation selon laquelle les produits et services visés à l’article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive sont ceux commercialisés ou fournis par le tiers, découle du libellé même de cette disposition, en particulier des termes “usage pour des produits ou des services”, et que l’interprétation contraire aboutirait à ce que les termes “produits et services” employés à l’article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive désignent le cas échéant les produits ou les services du titulaire de la marque, alors même que les termes “produit” et “service” figurant dans l’article 6, paragraphe 1, sous b) et sous c) de la directive visent nécessairement ceux commercialisés ou fournis par le tiers, conduisant ainsi, contre l’économie de la directive, à interpréter les mêmes termes de façon différente selon qu’ils figurent à l’article 5 ou à l’article 6 ; que la question de savoir si les produits ou services pouvaient être ceux d’un autre tiers n’a pas été posée ;
Attendu que la Cour a par ailleurs décidé (11 septembre 2007, Céline, C-17/06), que, même en l’absence d’apposition, il y a usage “pour des produits ou des services”, au sens de l’article 5 paragraphe 1, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers, et que l’usage par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ; qu’en l’espèce cependant, le signe n’a pas été utilisé à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne ;
Attendu qu’il existe une difficulté sérieuse quant au point de savoir si le prestataire qui propose un service de référencement payant sur internet, tel que celui décrit ci-dessus, fait un usage de marque que le titulaire est habilité à interdire sur le fondement des articles 5, paragraphe 1, sous a) et sous b) de la directive ;
Attendu que l’article 5 de la directive procédant à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et définissant ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marque dans la Communauté (CJCE, 20 novembre 2001 Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C416/99, et la jurisprudence citée) cette question, qui se pose en termes similaires dans tous les Etats membres, reçoit des réponses divergentes ;
Qu’il convient donc de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle ;
Et sur le quatrième moyen
Vu l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu que les juges du fond ont en outre dénié à la société Google France le bénéfice des dispositions de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information ;
Attendu que la société Google France soutient cependant, d’une part, que cette directive ne distinguerait pas entre les catégories d’intermédiaires, et serait applicable aux activités de stockage de données, et, d’autre part, que le complice ne répond de la contrefaçon commise par celui auquel il a fourni le moyen de la commettre que s’il a agi en connaissance de cause du caractère illicite du projet de contrefacteur ;
Attendu que ces questions sont intimement liées à celle qui vient d’être évoquée, puisqu’elles supposent que le régime de la responsabilité du prestataire de référencement payant sur internet soit précisé, au regard de la connaissance par ce dernier des faits de contrefaçon éventuellement caractérisés dans le chef de son client ;
Qu’il convient de compléter en ce sens la précédente question préjudicielle ;
DECISION
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
. Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :
1°/ L’article 5, paragraphe 1, sous a) et sous b) de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?
2°/ Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur ?
. Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à décision de la Cour de justice des Communautés européennes ;
. Réserve les dépens ;
. Dit qu’une expédition du présent arrêt ainsi qu’un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, Avocat aux Conseils,
pour la société Google France
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande d’annulation des marques des sociétés Viaticum et Luteciel, dit que la société Google France avait commis des actes de contrefaçon des marques «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» et «BDV», condamné la société Google France au paiement de dommages et intérêts, interdit sous astreinte à la société Google France d’afficher des annonces au profit d’entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques précitées « lors de la saisie sur le moteur de recherche d’une requête reproduisant lesdites marques » et d’avoir ordonné une mesure de publication,
Aux motifs que les mots “vols” ou “voyages” sont certes descriptifs de l’activité des sociétés Viaticum et Luteciel, mais que tel n’est en revanche pas le cas du terme “bourse” qui s’entend de tout lieu où s’échangent ou se revendent certaines marchandises ; que dans le cas d’espèce, la qualification de bourse s’appliquerait au site internet de la société Viaticum si, sur celui-ci, compagnies aériennes et «tour-opérateurs» vendaient directement leurs billets d’avions et leurs circuits touristiques aux passagers et touristes, la société Viaticum n’intervenant alors que comme prestataire technique et non pas comme agence de voyages relevant de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ; que tel n’étant pas le cas, et le terme “bourse” n’étant pas destiné à désigner une agence de voyages même travaillant exclusivement sur internet, c’est vainement que la société Google France soutient que les expressions “bourse des voyages” ou “bourse des vols” désigneraient une caractéristique de l’activité des sociétés intimées (arrêt attaqué, p. 10, § 3, 4 et 5) ;
1°/ Alors qu’en soulevant d’office le moyen tiré de ce que l’activité consistant à centraliser les offres des compagnies aériennes et des voyagistes ne serait pas une activité d’agence de voyages relevant de la loi n° 92-645 du 23 juillet 1992, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ Alors que les sociétés Viaticum et Luteciel reconnaissaient expressément se livrer «à l’activité consistant à rassembler sur une même plate-forme commerciale un grand nombre d’offres émanant de compagnies aériennes et de voyagistes multiples» (conclusions, p. 55, § antépénultième) ; qu’en décidant que la société Viaticum n’aurait pas eu l’activité de réunir les offres émanant directement de compagnies aériennes et de voyagistes, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ Alors qu’en tout état de cause, en se bornant à décider que l’activité pour laquelle les dénominations “bourse des vols” ou “bourse des voyages” étaient purement descriptives n’était pas celle de la société Viaticum ni celle d’agence de voyage, sans rechercher si cette activité n’était cependant pas incluse dans les services liés au tourisme pour la désignation desquels les marques précitées avaient été globalement enregistrées et dont elles pouvaient servir à décrire une des qualités, la cour d’appel a violé l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande en déchéance des marques des sociétés Viaticum et Luteciel, dit que la société Google France avait commis des actes de contrefaçon des marques «Bourse des Vols », «Bourse des Voyages» et «BDV», condamné la société Google France au paiement de dommages et intérêts, interdit sous astreinte à la société Google France d’afficher des annonces au profit d’entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques précitées « lors de la saisie sur le moteur de recherche d’une requête reproduisant lesdites marques» et d’avoir ordonné une mesure de publication,
Aux motifs que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu’il était justifié d’une exploitation réelle et sérieuse des marques litigieuses pendant plus de cinq ans, étant ajouté que la société Google France était irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, à contester la validité des marques en ce qu’elles avaient été déposées pour des produits ou services autres que ceux liés aux activités touristiques, pour lesquels elle n’était pas actionnée en contrefaçon ou, en tout cas, n’était pas susceptible de l’être valablement, puisque les faits de contrefaçon allégués se situent exclusivement dans le domaine touristique (arrêt attaqué p. 10, § dernier) ;
1°/ Alors qu’en relevant d’office la fin de non-recevoir tirée de ce que la société Google France aurait été irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à contester le maintien en vigueur des marques en ce qu’elles avaient été déposées pour des produits ou services autres que ceux pour lesquels elle était poursuivie en contrefaçon, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Aux motifs adoptés que l’exploitation des marques « Bourse des Vols », «Bourse des Voyages» et «BDV»
vaut exploitation des différentes combinaisons de ces marques, puisqu’au terme de l’alinéa 2b) de l’article précité, «l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif» est assimilé à l’usage de la marque ; que l’existence des sites internet de ventes de billets et de séjours et leur fréquentation ainsi que le volume d’affaires réalisé attestent que les sociétés Viaticum et Luteciel exploitent sérieusement les marques en question pour vendre des billets, des voyages, et des séjours touristiques, et donc pour tous les produits similaires ;
2°/ Alors qu’en application de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la similitude entre les produits ou services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux qui n’ont pas été exploités ne fait pas obstacle à la déchéance que le déposant a encourue au regard des produits ou services pour la désignation desquels il ne justifie pas d’un usage sérieux ; qu’en décidant que l’exploitation de la marque devait donc valoir pour les produits ou services similaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
3°/ Alors qu’en se bornant à relever la réalité des sites internet de vente de billets de voyages et de séjours touristiques, sans rechercher si les sociétés Viaticum et Luteciel, qui reconnaissaient se contenter de rassembler un grand nombre d’offres émanant de compagnies aériennes et de voyagistes, justifiaient d’un usage effectif de leurs marques pour désigner des prestations d’organisation de voyages et de « visites touristiques » et d’«accompagnement de voyageurs» qui étaient en tant que telles revendiquées à leur dépôt, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Google France avait commis des actes de contrefaçon des marques « Bourse des Vols », «Bourse des Voyages» et «BDV », condamné la société Google France au paiement de dommages-intérêts, interdit sous astreinte à la société Google France d’afficher des annonces au profit d’entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques précitées «lors de la saisie sur le moteur de recherche d’une requête reproduisant lesdites marques » et d’avoir ordonné une mesure de publication,
Aux motifs qu’il est attesté par les constats de I’A.P.P. qu’ont été utilisés les mots-clés “bourse de voyages”, “bourse des vols” et “bdv” permettant de voir afficher les liens commerciaux des concurrents des sociétés Viaticum et Luteciel ; que ces mots-clés sont la reproduction des marques “BDV”, “la bourse des vols”, “La Bourse des Vols” et “la Bourse des Voyages”, dès lors que l’omission de l’article ou l’emploi de lettres minuscules ou majuscules sont des détails insignifiants aux yeux du consommateur moyen ; qu’il y a imitation des autres marques dès lors que l’omission des chiffres “3615” ou des lettres “com” que tout consommateur rattache, les premiers à un service Minitel, les seconds à un service internet, ne peut, surtout lorsque les signes contrefaisants sont employés sur l’un de ces moyens de communication, qu’induire le public en erreur sur les liens entre ces signes et les marques ; que la contrefaçon par imitation est pareillement établie, alors même que l’une des marques (3615 Bourse des Vols) est une marque semi-figurative, la confusion dans l’esprit du public existant de la même manière ; qu’il s’ensuit que l’élément matériel de la contrefaçon est établi (arrêt attaqué, p. 11, Sur la contrefaçon, § 3 à 7) ;
Que l’intention frauduleuse de la société Google France, laquelle n’est pas l’auteur principal du délit, mais le complice par fourniture de moyens, ne peut résulter du seul fait que l’élément matériel est constitué ; que la société Google France qui ne peut opposer aux titulaires des marques contrefaites aucune contrainte économique ou technologique, laquelle résulte de son propre choix, a commis des fautes à trois niveaux ; qu’en premier lieu, elle est fautive pour n’avoir effectué aucun contrôle préalable des mots-clés réservés par ses clients (…) ;
qu’elle doit être en mesure d’interdire l’utilisation de mots-clés manifestement illicites, tels ceux qui sont contraires aux bonnes moeurs ou qui contrefont des marques notoires ou connues d’elle ; que dans le cas présent, elle connaissait ou aurait dû connaître les marques des sociétés intimées, lesquelles sont clientes de son programme Adwords et utilisent leurs marques dans le cadre de leurs campagne publicitaires ; qu’en second lieu, la société Google France, alors même qu’elle aurait légitimement ignoré que les sociétés Viaticum et Luteciel étaient titulaires des marques litigieuses, ne pouvait pas proposer dans son outil de suggestion de mots-clés l’achat des mots-clés “bourse aux voyages” ou “bourse de voyages” ou encore “bdv.com”, sous prétexte qu’ils figuraient parmi les plus souvent demandés, sans s’être livrée à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur ces mots ;
qu’en troisième lieu, la société Google France avait l’obligation, dès lors qu’il lui était signalé l’utilisation de mots-clés frauduleux, de mettre un terme sans délai et complètement, aux agissements contrefaisants ; qu’en fait, la société Google France, prétextant qu’elle ne pouvait pas interdire l’usage de mots tels que « vol » ou “voyage”, ce qui est vrai, a beaucoup tardé, ce qui a permis que, même après le jugement du 13 octobre 2003, il était encore possible à partir des mots-clés à peine modifiés (un singulier à la place du pluriel par exemple) d’entrer en contact avec les liens commerciaux des concurrents des sociétés Viaticum et Luteciel ; que les fautes de la société Google France sont ainsi avérées et qu’elle ne doit donc pas être exonérée de sa responsabilité dans la contrefaçon commise (ibid p. 12 et 13) ;
1°/ Alors qu’en constatant que la société Google France aurait été la complice par fourniture de moyens d’une reproduction de marques permettant le référencement de sites internet concurrents de ceux de leurs titulaires, tout en condamnant la société Google France pour avoir commis des actes de contrefaçon, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ Alors qu’en décidant que la société Google France avait commis des actes de contrefaçon tout en constatant que son rôle avait été celui d’un complice par fourniture de moyens, la cour d’appel a violé l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
3°/ Alors que la responsabilité de la contrefaçon qui incombe au tiers complice suppose que celui-ci ait fourni à son auteur le moyen de commettre un fait légalement répréhensible ; qu’en déduisant l’existence de la contrefaçon dont la société Google France aurait été la complice et qu’elle lui a enjoint de faire cesser, du seul fait que des mots-clés reproduisant ou imitant les marques litigieuses permettaient d’obtenir le référencement de sites internet concurrents de ceux des déposants, lorsqu’ils étaient saisis sur la requête du moteur de recherche Google, sans constater qu’il n’y a pas de contrefaçon lorsque les mots-clés sont le fait des utilisateurs du site Google qui définissent librement les termes de leur recherche documentaire dépourvue de toute fonction distinctive d’une marque, sans être tenus de requérir l’autorisation de quiconque, la cour d’appel a violé l’article L.71 3-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
4°/ Alors que le moteur de recherche du site Google est accessible à tout usager de l’internet qui cherche à obtenir les références des ressources de toute nature disponibles sur le web, accessibles par un lien hypertexte et pouvant avoir un rapport quelconque avec chacun des mots du thème de sa recherche documentaire ; que la reproduction à cette fin de termes correspondant à une marque comme “bourse des vols”, qui n’a pas pour objet de distinguer des produits, est insusceptible de constituer une reproduction contrefaisante dont la société Google France aurait été la complice ;
qu’il importe peu que cette recherche ait pour résultat, en soi licite, de fournir à l’internaute une liste de sites internet concurrents du déposant, mais référencés sous leurs propres noms au titre d’un référencement payant que des mots comme “vols” ou “bourse” suffisent à déclencher, dès lors qu’il n’en résulte pas que les intéressés aient commis un fait propre et personnel de contrefaçon de la marque à titre de marque, distinctement accompli auprès du public destinataire des services dont elle a pour fonction de garantir l’origine, afin de désigner des services concurrents ou de les assimiler à eux ; qu’en décidant du contraire la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
5°/ Alors que les procès-verbaux de l’A.P.P. des 12 et 13 novembre 2002, 25 et 28 novembre 2002, 7 février 2003 ou du 14 avril 2003, ne comportent aucune constatation de la reproduction des mots “bourse des vols” à titre de mots-clés sélectionnés par les sociétés référencées ; que les procès-verbaux des 26, 27, 28 novembre 2003 et des 1, 2, 3 décembre 2003, postérieurs au jugement entrepris, ne constatent pas davantage que les marques litigieuses aient été sélectionnées à titre de mots-clés par les sociétés référencées ; qu’il en résulte qu’aucune contrefaçon ne pouvait, à ce titre, être reprochée, de sorte que la cour d’appel n’a pu en décider autrement qu’en dénaturant lesdits procès-verbaux, en violation de l’article 1134 du Code civil.
Quatrième moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Google Frange avait commis des actes de contrefaçon des marques « Bourse des Vols », «Bourse des Voyages» et «BDV», condamné la société Google France au paiement de dommages et intérêts, interdit sous astreinte à la société Google France d’afficher des annonces au profit d’entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques précitées « lors de la saisie sur le moteur de recherche d’une requête reproduisant lesdites marques» et d’avoir ordonné une mesure de publication,
Aux motifs que l’intention frauduleuse de la société Google France, laquelle n’est pas l’auteur principal du délit, mais le complice par fourniture de moyens, ne peut résulter du seul fait que l’élément matériel est constitué ; que la société Google France, qui ne peut opposer aux titulaires des marques contrefaites aucune contrainte économique ou technologique, laquelle résulte de son propre choix, a commis des fautes à trois niveaux (ibid., p. 12, § 7 et 8) ; qu’en premier lieu, elle est fautive pour n’avoir effectué aucun contrôle préalable des mots-clés réservés par ses clients (…) ;
qu’elle doit être en mesure d’interdire l’utilisation de mots-clés manifestement illicites, tels ceux qui sont contraires aux bonnes moeurs ou qui contrefont des marques notoires ou connues d’elle ; que, dans le cas présent, elle connaissait ou aurait dû connaître les marques des sociétés intimées, lesquelles sont clientes de son programme Adwords et utilisent leurs marques dans le cadre de leurs campagnes publicitaires (ibid., p. 12, § dernier et p. 13, § 3 et 4) ; qu’en second lieu, la société Google France, alors même qu’elle aurait légitimement ignoré que les sociétés Viaticum et Luteciel étaient titulaires des marques litigieuses, ne pouvait pas proposer dans son outil de suggestion de mots-clés l’achat des mots-clés “bourse aux voyages” ou “bourse de voyages” ou encore “bdv.com” sous prétexte qu’ils figuraient parmi les plus souvent demandés, sans s’être livrée à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur ces mots ;
qu’en troisième lieu, la société Google France avait l’obligation, dès lors qu’il lui était signalé l’utilisation de mots-clés frauduleux, de mettre un terme sans délai et complètement, aux agissements contrefaisants ; qu’en fait, la société Google France, prétextant qu’elle ne pouvait pas interdire l’usage de mots tels que “vol” ou “voyage”, ce qui est vrai, a beaucoup tardé, ce qui a permis que, même après le jugement du 13 octobre 2003, il était encore possible à partir des mots-clés à peine modifiés (un singulier à la place du pluriel par exemple) d’entrer en contact avec les liens commerciaux des concurrents des sociétés Viaticum et Luteciel ; que les fautes de la société Google France sont ainsi avérées et qu’elle ne doit donc pas être exonérée de sa responsabilité dans la contrefaçon commise (ibid., p. 13, § 5 à 8) ;
1°/ Alors que l’article 6-l-2 de la loi n°2004-575 du 2 juin 2004 qui a introduit en droit interne la disposition de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information ne distingue pas entre des catégories d’intermédiaires, mais est applicable aux activités de stockage de données qu’il définit et qui peuvent être le fait de tout prestataire intermédiaire ; qu’en écartant l’application de ce texte au seul motif que la société Google France était poursuivie en qualité de prestataire de positionnement payant, sans rechercher si les faits de contrefaçon reprochés ne résultaient pas du stockage des données permettant l’affichage du lien hypertexte, exclusivement créées par les sociétés référencées, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
2°/ Alors que le complice ne doit répondre de la contrefaçon commise par celui auquel il a fourni le moyen de la commettre que s’il a agi en connaissance de cause du caractère illicite du projet de contrefacteur ; qu’en se bornant à relever, d’une manière inopérante, que la société Google France n’aurait effectué aucun contrôle préalable des mots-clés réservés par les sociétés référencées, qu’elle aurait dû vérifier les droits éventuels des tiers sur les mots dont elle aurait proposé l’achat, et que même après le jugement du 13 octobre 2003, la reproduction des marques litigieuses avait permis le référencement des concurrents, sans constater qu’antérieurement audit jugement, la société Google France avait su le caractère illicite de la contrefaçon qui lui était imputée, et qui tient à la seule reproduction par l’internaute de termes correspondant aux marques litigieuses permettant le référencement de sites concurrents de leurs déposants, quels que soient les mots sélectionnés par les sociétés référencées, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 1382 du Code civil ;
3°/ Alors au surplus qu’en se bornant à relever que la société Google France aurait dû contrôler préalablement la sélection des mots-clés des sociétés référencées et mettre un terme aux agissements dénoncés dès leur signalement, sans rechercher en quoi la sélection des termes litigieux aurait dû lui apparaître manifestement illicite, eu égard de surcroît au caractère descriptif des expressions “bourse des vols” ou “bourse des voyages” et au refus par les sociétés Viaticum et Luteciel de mettre en oeuvre la procédure de plainte prévue au programme Adwords auquel elles avaient souscrit pour référencer leurs sites internet, et qui aurait permis à la société Google France de vérifier la réalité et l’étendue des droits prétendument violés sur leurs marques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
4°/ Alors qu’il résulte du procès-verbal de constat des 12 et 13 novembre 2002 que le générateur de mots-clés est un automate purement facultatif que le candidat au référencement est libre d’utiliser afin d’affiner sur le champ la sélection de ses mots-clés, qu’il a l’obligation contractuelle de choisir dans le respect des droits des tiers ; que cette aide à la décision l’informe instantanément des recherches qui peuvent provoquer l’affichage de son site en lui fournissant une liste de centaines de locutions – les plus récemment employées par les internautes – incluant le mot sélectionné par l’intéressé et qui suffit pour provoquer son référencement, de sorte que selon «la pertinence» de ces recherches, il lui est loisible de «supprimer» de sa sélection les mots trop génériques, ou d’y «ajouter» comme d’en «exclure» les expressions mentionnées ; qu’en se bornant à affirmer que la société Google France aurait demandé d’acheter « bourse aux voyages », « bourse de voyages » ou «bdv.com», la cour d’appel a dénaturé le procès-verbal décrivant le fonctionnement de son outil et violé l’article 1134 du Code civil ;
5°/ Alors qu en décidant que la suggestion des mots-clés susvisés constituait une faute en l’absence de «vérifications sérieuses sur les droits éventuels des tiers» sur ces mots, tout en constatant qu’ils pouvaient être légitimement ignorés, sans analyser le fonctionnement de cet outil, sans constater que la société Google France était fondée à informer un candidat au référencement de toutes les recherches ayant inclus les mots qu’il entendait sélectionner afin qu’il puisse parfaire le ciblage de son référencement et sans même relever que la mention des mots susvisés aurait été suivie par leur sélection effective, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.
Cinquième moyen de cassation
II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 octobre 2003 à la somme de 9000 euros et d’avoir condamné la société Google France à payer cette somme aux sociétés Viaticum et Luteciel,
Aux motifs qu’aux termes du jugement du 13 octobre 2003 assorti de l’exécution provisoire, il était interdit à la société Google France d’afficher des annonces publicitaires au profit d’entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques “bourse des vols”, “bourse des voyages” et “bdv”, lors de la saisie sur le moteur de recherches d’une requête reproduisant les marques précitées, et ce sous peine d’astreinte de 1500 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ; que ce jugement a été signifié le 14 octobre 2003 ;
que s’il est exact qu’à la date du 15 novembre 2003, la société Google France avait supprimé les requêtes sur l’orthographe exacte des marques, il suffisait d’ajouter ou de retrancher un “s” final sur le mot-clé pour voir réapparaître les publicités des concurrents des sociétés Viaticum et Luteciel ; que les premiers juges ont ainsi à juste titre considéré que la société Google France n’avait pas satisfait à l’interdiction, dès lors que le simple fait que le mot-clé soit au pluriel plutôt qu’au singulier ou inversement ne lui enlevait pas son caractère contrefaisant (arrêt attaqué, p. 14 et 15) ;
Alors que la cour d’appel a constaté que le jugement du 13 octobre 2003, qu’elle a confirmé, avait fait interdiction à la société Google France «d’afficher des annonces publicitaires au profit d’entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques “bourse des vols”, “bourse des voyages” et “bdv” lors de la saisie sur le moteur de recherches d’une requête reproduisant les marques précitées» ; qu’elle a également constaté qu’«à la date du 15 novembre 2003, la société Google France avait supprimé les requêtes sur l’orthographe exacte des marques» ;
que dès lors, en énonçant qu’il suffisait d’ajouter ou de retrancher le “s” final sur le mot-clé pour voir réapparaître les publicités des concurrents des sociétés Viaticum et Luteciel», pour en déduire que la société Google France «n’avait pas satisfait à l’interdiction», la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d’où il résultait que la société Google France avait satisfait à l’obligation de désactiver les liens conduisant à l’affichage d’annonces publicitaires au profit d’entreprises concurrentes des sociétés Viaticum et Luteciel lors de la saisie, sur le moteur de recherches, d’une requête reproduisant les marques litigieuses, violant ainsi les articles 33 et 36 de la loi du 9 juillet 1991.
La Cour : Mme Favre (président, M. Sémériva (conseiller référendaire rapporteur), Mme Garnier (conseiller doyen), Mmes Tric, Betch, MM. Petit, Jenny, Mmes Pezard, Levon-Guérin (conseillers), Mmes Beaudonnet, Farthouat-Danon, Michel-Amsellem, MM. Pietton, Salomon, Mme Maitrepierre, M. Gadrat (conseillers référendaires), M. Jobard (avocat général) ;
Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan,
Voir arrêt cour d’appel de versailles
Voir Cour de cassation du 27/1/2009
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Farge et Hazan est également intervenu(e) dans les 55 affaires suivante :
En complément
Maître SCP Piwnica et Molinié est également intervenu(e) dans les 75 affaires suivante :
En complément
Maître SCP Waquet est également intervenu(e) dans les 55 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Favre est également intervenu(e) dans les 32 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Sémériva est également intervenu(e) dans les 11 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.